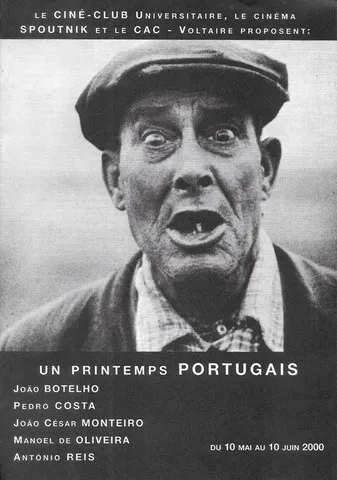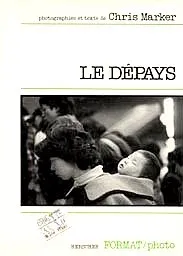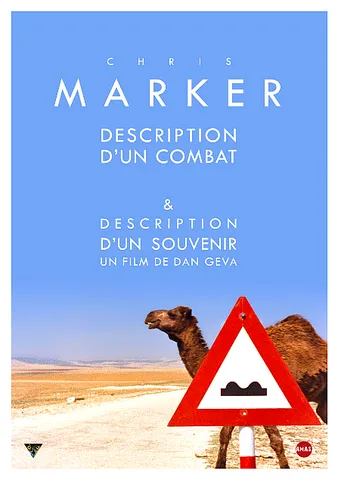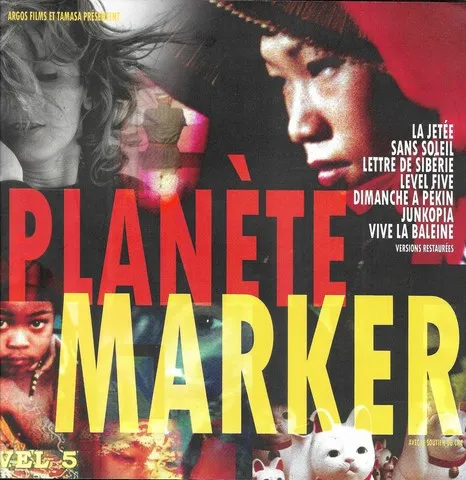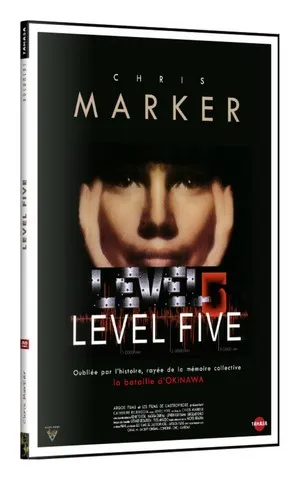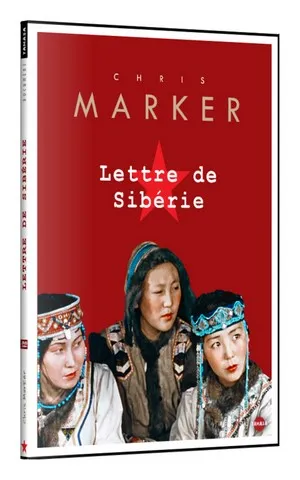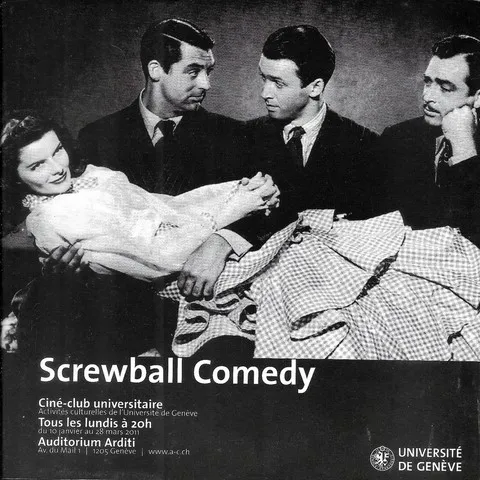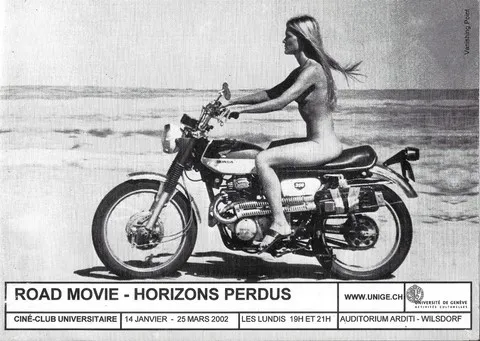Cinéma
- Avant propos
- Le dépays de Chris Marker: kesako? (2020)
- Sans soleil - Ed. Potemkine (2020)
- Chris Marker, l'art du bricolage numérique (2018)
- Chris Marker, magicien du flou (2017)
- Description d'un combat (2017)
- Planète Marker (2013)
- Level Five - Junkopia (2013)
- Lettre de Sibérie - Dimanche à Pékin (2013)
- Coeur de chat: si Chris Marker m'était conté (2011)
- Screwball comedy (2011)
- Wim Wenders (2010)
- "Anna" de Pierre Koralnik (2008)
- Road Movie (2002)
"Mourir est tout au plus l'antonyme de naître.
L'antonyme de vivre reste à trouver."Chris Marker, Le coeur net (1949)
Avant propos
Les premières armes ont été faites à travers le Ciné-club universitaire de Genève, le plus important ciné-club de Suisse. Les débuts furent laborieux, surtout à cause de la présence d'indécrotables dinosaures qui refusaient d'accepter l'extinction et persistaient à garder leur monopole de la pensée, disons-le, quasi unique qui était la leur. Heureusement, le Temps ayant finalement raison de tout, l'extinction s'est concrétisée, et ce fut la libération.
La machine à écrire a alors pu être enclenchée grâce au soutien et à la gentillesse indéfectible d'Annie Lefèvre, directrice des Activités culturelles de l'Université de Genève, que nous ne saurions assez remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous tous.
Le premier cycle auquel nous avons pleinement participé était "Un printemps portugais", cycle qui s'est tenu du 10 mai au 10 juin 2000. Malheureusement notre participation ne comprenant aucun texte de notre main, mais juste l'élaboration du cycle, la sélection des films et la recherche d'articles de presse sur les films présentés, nous n'avons pas été crédité. Peu importe! L'expérience fut extraordinaire grâce à la découverte des oeuvres de João Botelho, Pedro Costa, João César Monteiro et Manoel de Oliveira, ainsi que António Reis. Les multivers étaient enfin à portée... Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, Orson Wells, René Clair, Sergei Eisenstein, Iakov Protazanov, Jacques Feyder, Chris Marker, Andrei Tarkovski, Jacques Tati, David Cronenberg, Hou Hsiao-hsien, Terence Malick, Wim Wenders, Jim Jarmush, Nagisa Oshima, Takeshi Kitano, Tran Ahn Hung, Kim Ki Duk, Wong Kar Wai, Claude Goretta, Alain Tanner, Sofia Coppola, Katsuhiro Ōtomo, Satoshi Kon, Mamoru Oshii, Hayo Miyazaki, Johan van der Keuken, Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda... suivirent et d'autres encore.
Les cycles se succédèrent alors, parfois collectif comme les cycles "L'amour fou" ou "Cinéma helvétique". Ce dernier nous a permis de découvrir le cinéma suisse et de rencontrer les réalisateurs tels qu'Alain Tanner, Claude Goretta ou Jean Louis Roy.
Notons cependant que les séances du comité du CCU étaient toujours très animées, car nous étions tous passionnés et après quelques années, les filles sont arrivées en nombre rééquilibrant la balance et apportant avec elles un nouveau lot d'idées âprement discutées. Il y a réellement une différence entre homme et femme. Et tant mieux au final. Des années de bonheur infini, malheureusement à jamais enfouies dans le passé...
Après plus de dix ans au sein du comité du CCU, nous avons achevé notre participation à l'automne 2011, avec le projet "Spirale, autour de Chris Marker". Devenir un dinosaure n'a rien de bon. Aux jeunes de prendre la relève... D'autres voies s'ouvrent, de toute manière, si on le souhaite.
Aussi ce fut le point de départ d'un nouveau projet: chrismarker.ch, un site entièrement dédié à l'oeuvre de l'artiste dont nous sommes devenus l'un des principaux spécialistes à ce jour. Outre les catalogues d'exposition et de rétrospectives qui se sont succédés depuis, nous avons participé à plusieurs livrets de coffret de DVD / Blu-ray.
C'est là, dès lors, l'essentiel de notre travail d'écriture sur le cinéma, dont voici ci-dessous le détail.
REMARQUE: pour toutes reproductions partielles ou complètes de ces textes, il est impératif de contacter les éditeurs, afin d'obtenir les autorisations nécessaires.
En attendant: bonne lecture!
Le dépays de Chris Marker: kesako? (2020)
Ce texte n'a pas été publié. Il a été rédigé à l'occasion de la réalisation du livre accompagnant la réédition de Sans soleil et du Dépays de Chris Marker par les Éditions Potemkine.
Le Dépays De Chris Marker: Kesako?
Le 15 avril 1982 sortait des presses un livre de photographies composé par Chris Marker: Le dépays. Intégré à la collection "Format / photo" des éditions parisiennes Herscher1, qui comprend entre autre des livres de Duane Michals (Changements – 1981), de Dieter Appelt (Morts et résurrections de Dieter Appelt – 1981) ou encore de Jean Sagne (Delacroix et la photographie - 1982), l’ouvrage de Marker mêle, en guise d’essai littéraire, trois brefs textes à 56 photographies sur le Japon2. En tout début de son ouvrage, dans son "Avertissement au lecteur", Marker précise: "le texte ne commente pas plus les images que les images le texte. Ce sont deux séries de séquence à qui il arrive bien évidement de se croiser et de se faire signe, mais qu’il serait inutilement fatigant d’essayer de confronter. Qu’on veuille donc bien les prendre dans le désordre, la simplicité et le dédoublement, comme il convient de prendre toutes choses au Japon". On peut suivre cet avertissement ou, en markerien averti, s’en passer. Dans ce second cas, on découvrira que la majeure partie des photographies correspondent en plein aux descriptions faites dans le texte, mais dans un ordre peu rigoureux.
Cela dit, si on s’attache au contenu écrit du livre, on peut, d’une part, dire que le titre trouve son explication dans les dernières lignes du troisième texte: "Telles sont les choses de mon pays, mon pays imaginé, mon pays que j’ai totalement inventé, totalement investi, mon pays qui me dépayse au point de n’être plus moi-même que dans ce dépaysement. Mon dépays". Marker nous parle d’un dépaysement formateur de l’être, ce qui est le propre à tout voyage, qu’il soit physique ou métaphysique.
D’autre part, les trois textes sont fortement découpés (séparés) par les photographies. Leur thématique reprend les trois phases de la découverte de soi qui s’applique lors d’un voyage initiatique. Tout d’abord, on s’immerge dans le pays d’accueil. On prend ses marques de la manière la plus naturelle qui soit en confrontant son expérience propre et ses connaissances aux éléments que l’on rencontre durant ses déambulations. On apprend un mot ou deux de la langue locale, par politesse et comme marque personnelle de son implication dans la découverte, sa volonté de dépasser le seul "voir et y être". Qu’on se souvienne d’Hiroshima mon amour: "Tu n’as rien vu à Hisoshima…". Pour Marker, par exemple, c’est la prononciation et l’écriture de neko, soit "chat". Dynamique jeu de miroir, de similarités, qui permet de ne pas se noyer ni de se perdre irrémédiablement, mais de bâtir une base commune sur laquelle établir la comparaison initiale, inaliénable, de tout voyage. C’est le rôle de tous ces chats dans le premier texte de Marker. Au Japon, comme ailleurs, ils sont un lien, un relais fidèle et rassurant sur lequel l’auteur peut s’appuyer sans crainte. Il n’y a rien de plus similaire d’un chat européen qu’un chat africain ou un chat asiatique. Ils sont tous pareils malgré leurs innombrables différences. Il en va tout autrement des humains que nous disséquons à l’extrême car reflets de nous-mêmes. On ne parle pas des différentes cultures, langues ou couleurs de poil des chats, de leurs visions du monde, mais on le fait pour les humains. Un Japonais, ce n’est pas un Français. Couleur de peau, traits du visage, langue, écriture, expressions corporelles, normes, politesse extrême contrepoint d’une xénophobie absolue mais assumée, etc., tout est sujet à comparaison, à controverse. Pas chez les chats, mis à part qu’ils sont les derniers à être arrivés, en retard, à la mort de Bouddha!
Le deuxième texte développe l’idée de "l’entre-deux" purement asiatique, pour ne pas dire japonais. Marker explique clairement cet aspect de la culture nippone qui embarrasse le visiteur dès son arrivée, car il ne sait pas trop comment l’appréhender. "Alors cet entre-deux, cet entre-chat-et-loup, cet innomé réparti entre les huit cents huit dieux qui ont la garde du troupeau des rêves, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas bien comment s’adresser à lui, mais du moins on peut être poli. D’où la politesse à l’égard des ancêtres, d’où la politesse envers les bêtes (…). Finalement, la civilisation matérialiste du Japon est peut-être obsédée par l’esprit de la même façon que la civilisation chrétienne l’était par la chair". Au Japon, monde réel et monde imaginaire ou parallèle ou invisible, ne sont qu’un seul monde, contrairement à l’Europe. On ne s’y pose pas la question de les dissocier. On vit avec. Et donc, de ce fait, "un Japon peut en cacher un autre". Et Marker de préciser que lorsque l’on visite un pays comme le Japon, il ne faut pas se poser trop de questions, surtout les cartésiennes qui n’ont pas lieu d’être ici. La comparaison a un temps certains, mais elle a surtout une fin. Lorsqu’on voyage, c’est peut-être l’élément le plus important à comprendre et à appliquer.
Ce qui nous amène au troisième texte: le dépaysement comme élément constitutif du moi. Les voyages forment la jeunesse a-t-on pour habitude de lire ou d’entendre, avec la célèbre fable de l’enfant prodigue. Mais lorsque l’on voyage dans un pays aussi opposé à la culture européenne que l’est le Japon, le changement peut-être plus profond encore, car le pays du Soleil Levant apprend plus que tout autre (peut-être) à "lâcher prise", à oublier ce que l’on sait pour vraiment découvrir un autre monde. Et de là, un autre moi.
Ce texte ayant vocation d’introduction, il ne nous est pas loisible de développer à plein ces thématiques et de leurs donner toute leur ampleur. D’autres le feront peut-être.
Ce qu’il nous reste cependant à faire, c’est de resituer la place du Dépays par rapport à une autre œuvre contemporaine de Chris Marker, qui elle aussi parle du Japon: Sans soleil. Le film documentaire est sorti sur les écrans en janvier 1983, mais a été achevé quelques mois auparavant. Autrement dit, alors que Marker réalisait son film, il écrivait son livre ("de septembre 1979 à janvier 1981" nous précise l’auteur). Et de ce fait, on retrouve beaucoup de similarités entre les deux œuvres, qu’elles soient thématiques (réel – imaginaire, mono no aware, etc.) ou référentielles (temple des chats de Go To Ku Ji, révolte de Narita, takenoko, M. Akao, Flash Gordon, etc.). Mais le but n’est pas le même. Les deux œuvres ne sont autres que "complémentaires", ne serait-ce que parce que Sans soleil ne parle pas seulement du Japon. Dans Le dépays, Marker décrit son rapport à la Culture japonaise dans son ensemble et les conséquences sur sa propre existence, sa conception du monde. Dans Sans soleil, il se pose la question de l’existence des êtres, de ce qui vaut la peine de vivre, de ce pourquoi au final, on vit malgré l’horreur de devoir mourir un jour.
Christophe Chazalon
Cap Vert, août 2020
1 Georges Herscher, directeur au Chêne de 1970 à 1980, était un grand amateur de photographies. On lui doit l’édition de nombreux ouvrages de photographes.
2 Notons au passage que les PDF du Dépays accessibles sur le web sont TOUS incomplets.
Sans soleil - Ed. Potemkine (2020)
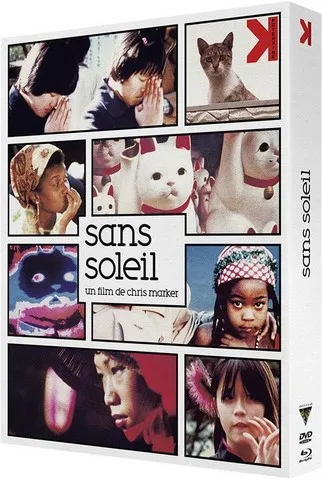
À l'occasion de la réédition de Sans soleil et du Dépays de Chris Marker par les Éditions Potemkine, nous avons été amené à co-réaliser le livre du coffret avec Natacha Missoffe. Ce sont pas moins de six textes au total que nous avons rédigés en à peine deux semaines, dont un seul n'a pas été retenu car portant sur Le dépays et non sur Sans soleil. Nous l'avons cependant reproduit séparément ci-dessus.
"Qu'est-ce que Sans soleil ?"
(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020. p. 87-95)
« Mourir est tout au plus l’antonyme de naître.
L’antonyme de vivre reste à trouver. »
Chris Marker, Le Coeur Net (1949)
Documentaire atypique, Sans soleil s’appréhende d’abord par l’inconscient et le ressenti. Ainsi le souhaitait l’auteur. Ainsi les spectateurs et les critiques l’ont généralement compris. Dans le dossier de presse du film, Chris Marker propose un extrait de la préface écrite par André Beaujard aux Notes de chevet de Sei Shônagon qui lui ont servi ici de modèle. Cet extrait peut (et doit ?) être appliqué à Sans soleil : "On ne sera pas surpris de voir les sujets les plus divers se succéder immédiatement. On ne s’étonnera point d’y trouver des passages qui se répètent et d’autres qui se contredisent; on ne s’attardera pas à chercher pourquoi l’auteur parle en tel endroit de ceci ou de cela, encore que l’on puisse deviner parfois comment se lient ses idées". On regardera Sans soleil et on se laissera submerger par le flot d’images et de texte dit en voix off avec célérité, non pas parce que Chris Marker a tant à dire, mais parce qu’il ne veut pas que la pensée du spectateur s’accroche trop aux mots et aux choses qu’il montre. L’inconscient doit supplanter la conscience, la soumettre. Il faut se laisser emporter par la vague, fruit du génie de l’inconscient poétique même de l’auteur. Et alors, enivré ou saoulé, on sort de la projection changé. Quelque chose s’est passé, quelque chose de fort, mais d’indiscernable, d’indéchiffrable. La magie Marker a opéré presque à chaque fois, quelques récalcitrants mis à part. Voilà ce qu’il faut attendre, dans un premier temps, de Sans soleil. Le reste appartient à chacun, en propre, et ne peut être généralisé à tous. Chacun y trouvera ce qu’il y voudra, ce qu’il y aura apporté, ce qu’il y aura cherché.
Cette vision un peu idéaliste n’en est pas moins vraie. Cependant, l’intention de l’auteur que tout un chacun comprendra n’est pas forcément l’intention unique. Sans soleil est une oeuvre forte, le chef-d’oeuvre de Chris Marker, et sa portée est loin d’être seulement destinée au seul ressenti. L’homme est un créateur, passé maître dans l’art de la narration. Il a créé un style, reconnaissable entre tous, à l’époque tout du moins, car il a fait école depuis et les imitations sont devenues légions.
En tant qu’oeuvre d’art, on peut donc appréhender Sans soleil d’une manière plus traditionnelle, plus méthodique, plus scientifique, afin d’en chercher le sens, le motif, le but. Rares sont ceux qui s’y sont risqués, pour ne pas dire personne, tant la structure du film est dense et hardie. Les lignes qui suivent ont cette ambition. Elles veulent expliquer de manière précise et concrète ce qui est au centre du film, le thème principal. On s’apercevra alors que Sans soleil est loin d’être une esquisse dont "l’auteur a jeté sur le papier, en laissant aller son pinceau, toutes les idées, les images, les réflexions qui lui sont venues en l’esprit".
Question, donc: de quoi parle Sans soleil? Critiques, journalistes, spécialistes universitaires ou passionnés ont répondu, nous y compris: la Mémoire, l’Histoire, le cinéma, les rêves, le Japon... Ce n’est pas faux. Mais ce n’est pas suffisant. De quoi parle réellement Sans soleil? Quel est le sujet central de Sans soleil? Une de nos amies nous a écrit: "ce qui est dans Sans soleil, sont les questions essentielles de notre être-là empreintes d’une infinie poésie". Sans soleil parlerait-il de la Vie et de la Mort, de l’existence humaine? Oui, c’est vrai. En fait, Marker essaie de nous amener à prendre conscience que ce qui fait la vie, celle qui nous conduit inévitablement à la mort, ce sont, pour reprendre les mots de Sei Shônagon, "les choses qui font battre le coeur". Autrement dit, non pas le Bonheur dans son absolu (même si l’Amour y a une place), mais les milliers de petits bonheurs quotidiens qui peuvent apporter une échappatoire face à l’Horreur à laquelle nous serons tous confrontés un jour: la mise à mort, qu’elle soit naturelle ou par accident, due à un virus, un rocher, un autre être humain, tout ce que vous voudrez. Car l’Horreur, qu’on le comprenne bien, ce n’est pas la Mort en elle-même. Comme le précise Marker, on ignore ce qui se passe lorsqu’on ne vit plus. L’Horreur, c’est le fait que tout être vivant naît en étant irrémédiablement conditionné à mourir. Il n’y a pas de choix. Il n’y a pas d’alternatives. C’est inévitable et c’est la plus grande injustice qui soit. Mais est-ce bien vrai ? En fait, il faut distinguer l’humain de l’humanité, l’individu de l’espèce. La mort injuste du premier sert en fait à la seconde. Sans la mort de l’homme, l’humanité (et d’une manière plus large, la Vie) ne pourrait se perpétuer. Dans l’ouvrage collectif La plus belle histoire du monde: les secrets de nos origines, à la question "Peut-on dire que la mort est une nécessité de la vie?", Joël de Rosnay répond simplement: "Absolument. C’est une logique du vivant. À mesure que les cellules se divisent, elles multiplient les erreurs de leurs messages génétiques qui s’accumulent avec le temps. Finalement, il y a tellement d’erreurs que l’organisme se dégrade et meurt. C’est un phénomène inéluctable. La mort n’est certes pas un cadeau pour l’individu, mais c’est une prime pour l’espèce: elle lui permet de conserver son niveau de performances optimal". Plus encore, il précise: "la mort est aussi importante que la sexualité: elle remet en circulation les atomes, les molécules, les sels minéraux dont la Nature a besoin pour continuer à se développer. Elle procède à un gigantesque recyclage des atomes, dont le nombre reste constant depuis le Big Bang. Grâce à elle, la vie animale peut se régénérer"[1]. Ce n’est autre que la vision ancestrale de la réincarnation ou la loi d’Antoine de Lavoisier: "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" (1775). Ainsi, la mort, aussi injuste soit-elle à nos yeux d’être humain, est un prérequis indispensable pour la survie de l’espèce. La Vie procède au cours des temps à des milliards de milliards de milliards d’essais et fait de chaque être vivant, de chacun de nous, un cobaye. Cela s’appelle l’Évolution, qui se complexifie plus le temps avance. Et plus on survit à notre milieu, plus notre ADN a des chances de poursuivre son évolution dans le temps infini de l’univers. Les dinosaures étaient les grands maîtres de la planète il y a 200 millions d’années et puis un météorite est tombé. Bien qu’ils fussent les plus forts en leur temps, ils sont tous morts. Par contre, les petits lémuriens, mammifères insignifiants au premier abord, ont pu survivre, car ils ont été capables de s’adapter en se terrant dans des grottes. La morale de l’histoire, en abusant un peu: "ce n’est pas la loi du plus fort qui prévaut dans la Nature, mais bien celle de celui qui sait survivre et s’adapter". Et dans le monde moderne actuel, qu’ils vivent au Japon, au Cap Vert / Guinée-Bissau, les pôles extrêmes de la survie pour Marker, ou n’importe où ailleurs, peu importe, les enfants ont toute leur chance.
C’est pourquoi, Marker commence son film par l’image des trois enfants en Islande, suivie par du noir: si vous n’avez pas vu le bonheur dans l’image, au moins vous verrez le noir! L’enfance, c’est l’innocence. Les enfants ne se posent pas la question de la Mort. Ils l’imaginent, la rêve, la jouent pour se relever une minute plus tard, comme si de rien n’était. Marker précise même: "Ce que j’ai lu le plus souvent dans les yeux de ceux qui allaient mourir, c’était la surprise. Ce que je lis en ce moment dans les yeux des enfants japonais, c’est la curiosité. Comme s’ils essayaient, pour comprendre la mort d’une bête, de voir à travers la cloison". Les enfants n’ont pas besoin d’apprendre à rédiger la liste des choses qui font battre le coeur. Elle est en eux, naturellement. Elle jaillit au cours des événements de la journée. Un enfant rit en moyenne 400 fois par jour, un adulte 5 à 20 fois. C’est pourquoi Marker apprécie tant les takenoko du parc Yoyogi, ces jeunes martiens qui repoussent leur entrée dans le monde de l’âge adulte et sa réalité morbide. Cette jeunesse "qui se rassemble tous les week-ends à
Shinjuku sait d’évidence qu’elle n’est pas sur une rampe de lancement pour la vraie vie, qu’elle-même est une vie, à consommer tout de suite, comme les groseilles. C’est un secret très simple, les vieux essaient de le masquer, tous les jeunes ne le connaissent pas. (…) Le rock est un langage international pour propager le Secret. (…) Pour tous les takenoko, vingt ans est l’âge de la retraite". De même, lorsqu’il suit les jeunes femmes en kimono qui sont célébrées non pour leur beauté, mais parce qu’elles sont arrivées à l’âge officiel de la maturité, vingt ans, par quoi il faut comprendre celui d’être une femme et une mère modèle, cellule centrale de la famille et de la société japonaise, soumise et discrète. C’est le but premier, ce pourquoi elles sont enfantées. Fini l’innocence de l’enfance. À elles de produire maintenant.
Mais attention cependant, la jeunesse peut s’égarer aussi à trop idéaliser les choses. Ainsi Marker d’écrire: "ce dont Narita me renvoyait un fragment intact, comme un hologramme brisé, c’était l’image de la génération des Sixties. Si c’est aimer que d’aimer sans illusion, je peux dire que je l’ai aimée. Elle m’exaspérait souvent, je ne partageais pas son utopie qui était d’unir dans la même lutte ceux qui se révoltent contre la misère et ceux qui se révoltent contre la richesse, mais elle poussait le cri primordial que des voix mieux ajustées ne savaient plus, ou n’osaient plus crier... (…) Le Mouvement a eu comme partout ses histrions et ses arrivistes – y compris, car il y en a, des arrivistes du martyre – mais il a emporté tous ceux qui disaient avec le Che Guevara qu’ils "tremblaient d’indignation chaque fois qu’une injustice se commet dans le monde". Ils voulaient donner un sens politique à leur générosité, et leur générosité aura eu la vie plus longue que leur politique. Voilà pourquoi je ne laisserai jamais dire que vingt ans n’est pas le plus bel âge de la vie".
Aussi pourquoi Marker veut-il réaliser un film sur les petits bonheurs de la vie? Il faut peut-être là s’inspirer du texte du premier chant du Sans soleil (1870) de Modeste Moussorgski, écrit par Arseny Golenishchev-Kutuzov[2]:
Une petite chambre, calme, agréable,
Une obscurité impénétrable, une obscurité sans réponse,
Une pensée profonde, un chant triste,
Dans un coeur qui bat un espoir précieux.
Un vol rapide de moment en moment,
Un regard fixé sur un bonheur lointain,
Beaucoup de doutes, beaucoup de patience,
Ainsi est ma nuit, ma nuit de solitude.
Les désillusions sur le monde qui l’environne, qu’il pensait pouvoir être changé, grâce au socialisme, en un monde meilleur, il en a fait son deuil à travers son film-somme Le Fond de l’air est rouge. Il laisse dès lors le rêve à d’autres. Il n’y croit plus. Marker a 60 ans lorsqu’il tourne Sans soleil et, fait plus important encore, qu’on n’a pu comprendre que récemment grâce aux dernières recherches, le numérique naissant l’attire irrémédiablement, tel un trou noir, un puits sans fond. Il entrevoit de suite les innombrables possibilités que cela offre. Il s’y plonge à corps perdu, programme, bidouille, échange avec d’autres geeks fanatiques, les vrais Hayao Yamaneko. Et jusqu’à sa mort survenue en 2012, il poursuivra sa quête enthousiaste et avide de découvertes. Car s’il ne croit plus dans le socialisme, Marker a toujours foi en l’homme, en sa possible rédemption, même partielle. Enfermé dans la solitude du penseur qu’il est, il a toujours des choses à dire, à raconter, à transmettre. Il ne peut se taire, se refréner. Il doit agir, dire ce qui lui paraît être juste, utile.
Aussi Marker termine-t-il son film sur une image bidouillée par son alias Hayao Yamaneko: le regard de la femme capverdienne au marché de Praia. Et de conclure: "au fond, son langage me touche parce qu’il s’adresse à cette part de nous qui s’obstine à dessiner des profils sur les murs des prisons. Une craie à suivre les contours de ce qui n’est pas, ou
plus, ou pas encore. Une écriture dont chacun se servira pour composer sa propre liste des choses qui font battre le coeur, pour l’offrir, ou pour l’effacer. À ce moment-là, la poésie sera faite par tous, et il y aura des émeus dans la Zone"[3].
Avec Sans soleil, Marker, plus qu’un exemple, veut offrir un catalyseur, un déclencheur qui permettra à tout un chacun, à l’image de Sei Shônagon, de faire le premier pas, de franchir la ligne qui le sépare d’une vie simple, mais épanouie, emplie de mille et un petits bonheurs quotidiens. Car faute de cela, on ne peut éviter l’ennui et le vide d’une vie tels que les chante Moussorgski, dans le 4e chant de son Sans soleil:
Ennuie-toi. De la naissance à la tombe
Ta route est tracée à l’avance.
Goutte à goutte tu dépenseras ta force,
Ensuite tu mourras et que Dieu soit avec toi,
Et que Dieu soit avec toi !
Notes
[1] Le Seuil, Paris, 1996, p. 98.
[2] Voir ci-après dans le livret, p. 179.
[3] Nous soulignons
"Les principales thématiques du film"
(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020, p. 97-115)
Lorsqu’on étudie un film, la première chose qu’il convient de faire, c’est simplement d’analyser son titre. Aussi, que signifie "sans soleil"? Sous un angle purement factuel, pragmatique, l’absence de soleil, entraîne l’obscurité, ce qu’on pourrait appeler "la nuit", telle qu’on la connaît tous les jours. Tout est noir, à part quelques étoiles qui brillent au firmament. La lune est invisible. L’absence de soleil sur le long terme implique la mort de toute vie sur Terre. Les plantes ne peuvent plus faire la photosynthèse indispensable à leur survie, les températures chutent, etc. La "nuit" devient la mort, le néant. Dans ce sens, le titre du film de Marker donne déjà une idée précise de son contenu si on le reporte à la première séquence du
film des trois enfants en Islande et de l’amorce noire. La voix off dit alors: "Si on n’a pas vu le bonheur dans l’image, au moins on verra le noir". Le message est clair. Pour Chris Marker, le soleil équivaut au bonheur, ou du moins à sa présence possible. Et sans bonheur, on ne peut pas vivre. Ceux qui ne le voient pas vivent dans le noir et l’ennui. Une idée qui fait écho à l’oeuvre de Moussorgski.
En 1874, Modeste Moussorgski met en musique six poèmes de son ami Arseny Golenishchev-Kutuzov, intitulés "Entre quatre murs", "Tu ne m’as pas reconnu dans la foule", "Terminé est le jour vide, bruyant", "Ennuie-toi", "Élégie" et "Sur la rivière". Le titre du cycle est Sans soleil, dont on peut trouver la traduction française dans ce livret. Cette oeuvre est associée à deux autres: Enfantines (1868-1872) et Chants et danses de la mort (1875-1877). Dans une conférence donnée en septembre 2013 sur ces trois cycles, la musicologue Mathilde Reichler décrit Sans soleil de Moussorgski en ces termes:
Le titre du cycle annonce d’emblée la couleur: ce sont des nocturnes que nous allons entendre – des nocturnes, mais loin de toute exaltation romantique. Des nuits marquées par la solitude et l’insomnie; des nuits blanches, qui incitent à tourner les pages du passé. (…)
Même si les deux dernières pièces s’ouvrent sur de plus vastes dimensions, ce cycle, aux antipodes des Chants et danses de la mort, notamment, est un cycle intime, intérieur, secret. La poétique de l’instant, du fugitif, la condensation et l’économie des moyens soulignées par la musique, confèrent à l’ensemble une irrépressible atmosphère de mélancolie.
En dehors du souvenir et du passé, du bonheur perdu, des fantômes qui peuplent ces nuits telles des ombres muettes, les poèmes évoquent aussi l’ennui et l’oisiveté, l’agitation futile et la vanité du jour – thématiques très russes pour un cycle au lyrisme tout pétersbourgeois. Car ces nuits ont beau être "sans soleil", elles rappellent beaucoup l’ambiance blafarde des nuits blanches de Saint-Pétersbourg, lorsque le soleil ne se couche jamais, précisément[4].
Elle mentionne alors en note Les Nuits blanches : roman sentimental (souvenir d’un rêveur) de Fédor Dostoïevski, paru en 1848, qui raconte les déambulations nocturnes d’un jeune homme dans les rues de Saint-Pétersbourg, pour tromper son ennui et sa solitude. Il rencontre un soir une jeune femme dont il tombe amoureux et qu’il aura, un bref instant, l’espoir d’épouser, alors qu’elle en aime un autre. Deux jours passent et l’autre réapparaît emportant avec lui la jeune femme. Ce qui est intéressant ici, c’est la double interprétation de "nuits blanches". En effet, tout le monde se souvient des nuits blanches de sa jeunesse où l’on ne se couche pas, ou celles passées au chevet de son enfant malade, à veiller. Mais pour Saint-Pétersbourg, une des villes les plus septentrionales du monde, les "nuits blanches" sont particulières. Chaque année, de fin mai à début juillet, la nuit ne tombe jamais ou presque, juste 3h ou 4h, et encore. Mais ce qui est valable pour l’été, l’est inversement pour l’hiver où sévissent ce qu’on pourrait appeler les "nuits noires". Des nuits qui n’en finissent pas de durer (18h en moyenne) et affectent le métabolisme humain. Malgré tout, la vie doit poursuivre son cours.
Or, il est commun de penser que la vie active est réservée au jour, alors que le rêve et la vie festive (qui n’est autre qu’un complément de la vie quotidienne) sont l’apanage de la nuit. Lorsqu’on ne dort pas la nuit, comme le héros de Nuits blanches ou de Sans soleil (en particulier dans "Entre quatre murs"), on ne peut rêver, donc on est conscient plus facilement de sa propre solitude, de la vacuité de son existence, alors que le temps défile lentement, laissant l’esprit s’empêtrer dans la conscience d’une vie emplie d’ennui, tel que décrit dans "Ennuie-toi", le quatrième poème de Moussorgski. Alors on se souvient. La mémoire devient le dangereux compagnon, incontournable et impassible, à la franchise tranchante. Si on a aimé, ou si on a connu le Bonheur, on peut s’y replonger, essayer d’égayer les minutes qui s’égrainent sans énergie. Et Moussorgski de composer:
Les pensées courent sans but et sans fin,
Parfois, transformées en les traits d’un visage aimé,
Elles m’appellent, faisant renaître à nouveau dans mon âme des
rêves du passé,
Parfois, combinées en une obscurité noire, pleines de menace
muette,
Elles effraient avec la bataille du futur mon esprit timide,
Et j’entends au loin le bruit dissonant de la vie,
Le rire de la foule sans coeur, le murmure d’une animosité perfide,
Le chuchotement impossible à étouffer de la banalité de la vie,
La triste sonnerie de la mort !...
C’est là un peu de la teneur du Sans soleil de Chris Marker qui, d’un côté, insiste sur l’importance des petits bonheurs dans une vie, savoir être heureux de choses simples pour ne pas sombrer dans la fascination de l’Horreur, et qui, de l’autre, réfléchit sur le brouillage des frontières entre monde réel et mondes imaginaires qui remplissent nos vies pour le meilleur ou pour le pire, à l’image du troisième poème "Terminé est le jour vide, bruyant"de Moussorgski.
Découpage thématique de Sans soleil de Chris Marker
La seconde étape dans l’étude d’un film est de s’attacher à sa structure. Quelle est-elle? La réponse se trouve en partie dans un billet du Blindlibrarian sur le site reconnu comme officiel, chrismaker.org[5]. Ce billet du 23 mai 2008 propose une "carte géo-temporelle" du film, datée de 1990 et découverte au Pacific Film Archive de Berkeley, en Californie, où Marker aimait à passer du temps à visionner des films, à lire, à rencontrer des gens.
On peut facilement penser que Marker en est l’auteur, non seulement parce que cette carte est rédigée en français ("ouverture" (OUV), en anglais, se dit "opening" et "n.s." signifie "non situé", entre autre), mais surtout parce que cette "carte" ne correspond que partiellement au découpage réel du film. Or, si un "chercheur" l’avait dessinée, il se serait nécessairement senti obligé d’être le plus précis et le plus fidèle possible. Marker, lui, voulait juste illustrer à grands traits son propos, avoir (plus qu’offrir à la connaissance des autres) une vision de la structure de son film, rapide et claire. Nous suggérons cela car nous avons réalisé de notre côté une telle carte, avec un découpage seconde par seconde [6 - pdf]. Et le résultat est bien plus complexe et bien moins graphique que la carte proposée ici.
Quoi qu’il en soit, ce découpage a un autre intérêt: le chapitrage. Ce dernier a été repris dans l’édition du commentaire par la revue française Trafic [7], avec une modification concernant l’ouverture que Marker place entre la 6e et la 7e minute du film, et non après le noir d’amorce succédant à la séquence des enfants en Islande.
Aussi, Sans soleil est-il découpé en quatre chapitres précis. On est très loin de l’idée initiale d’un film fourre-tout qui ne respecterait aucun plan prédéfini. Mais peut-être est-il bon ici de rappeler la méthode de travail de Chris Marker. Quand il réalise un film, et tout particulièrement pour Sans soleil, il n’a qu’une vague idée en tête, un point de départ, qui rarement se trouve à l’arrivée. Il s’agit juste d’un déclencheur qui le pousse à faire, à créer. Pour Le Fond de l’air est rouge (1977), l’idée de départ est venue de la monteuse Valérie Mayoux qui, faisant du rangement dans l’arrière-boutique de la société de production ISKRA, s’est rendue compte que toutes les bobines déposées et abandonnées depuis un certain temps pourraient être le sujet d’un film. Elle soumet l’idée à Marker, qui se jette à corps perdu dans l’aventure. De même, pour Chats perchés (2004): c’est la découverte des innombrables M. Chat peints par Thoma Vuille sur les murs de Paris qui a servi de fil rouge à la réalisation du film, parce que Marker a été "touché par l’humanisme du sourire du chat"[8]. Le film porte en fait sur "les événements français et internationaux qui ont marqué sa mémoire depuis le 11 septembre 2001" et devait s’intituler à l’origine "Avril inquiet".
Autrement dit, lorsque Chris Marker se lance dans un nouveau projet de film, il n’y a pas de scénario préétabli, ni de plan de tournage. Tout juste en rédige-t-il un pour le producteur, histoire de le rassurer, mais ce dernier sait très bien au fond de lui que le résultat final sera tout autre. Contrat et argent en poche, Marker part à la découverte du monde, voyage, filme, photographie, lit, écoute de la musique. Et, petit à petit, le film prend forme. L’idée se développe. Une fois devant la table de montage, il se lance, essaie, visionne et retouche, ou fait retoucher, selon des directives tout à la fois précises et libres. Valérie Mayoux explique la procédure: "Pour lui, le montage est vraiment la recherche de la nécessité de ce que disent deux plans quand ils se rencontrent — et qui peut passer, chose très importante chez lui, par l’humour. C’est une alchimie qu’il est le seul à pouvoir trouver, avec son allié le hasard, qui n’existe pas d’ailleurs: il peut confier à d’autres, ses "petites mains", le montage d’une séquence, mais c’est à peine plus que le hasard… Sur La Bataille des dix millions (1970), il lui est
arrivé de partir en me disant: "Valérie, je vous laisse monter la séquence" et j’étais absolument saisie d’épouvante, parce que naturellement il ne soufflait pas mot de ce qu’il entendait par là. D’ailleurs, il ne peut pas le dire d’avance, comme un alchimiste ne connaît pas d’avance la formule de son expérience. C’est pour cela que l’apparition de la vidéo, de l’informatique et autres synthétiseurs a été une telle jouissance pour lui, parce que ça lui permet vraiment de jouer avec une souplesse formidable"[9].
La réalisation de Sans soleil, encore pour une bonne part en pellicule 16 mm, répond pleinement à cette méthode. Le film prend peu à peu vie, lentement une structure se dessine, la juxtaposition des images fait sens et le commentaire se greffe dessus, ou parfois l’inverse. Dans Sans soleil, le commentaire est si dense qu’on ne peut l’appréhender en entier, en une projection. C’est pourquoi le film a été perçu avant tout par le ressenti. Film réalisé en 1982, le commentaire n’en a été édité dans sa version intégrale en français qu’en 1993, en italien en 1996, alors qu’en allemand, il est publié en 1984, ainsi qu’en anglais, de façon quasi complète. Les critiques et les journalistes ne pouvaient donc que difficilement étudier
avec rigueur et précision le film et sa structure à sa sortie. Aujourd’hui, cela est possible, mais l’entreprise semble toujours effrayer. Aussi, après une lecture attentive, la comparaison entre versions française et anglaise, plusieurs visionnages, nous avons dégagé les thématiques suivantes :
• Chap. 1 : le regard
• Chap. 2 : la frontière réalité / imaginaire
• Chap. 3 : la mémoire
• Chap. 4 : la « poignance » des choses
Elles ne sont pas absolues. C’est une proposition. On pourrait en trouver d’autres. Par ailleurs, la thématique d’un chapitre n’est pas exclusivement réservée à ce chapitre. Marker en parsème l’ensemble du film, donnant volontairement l’illusion d’un melting-pot. Cependant, la thématique d’un chapitre est celle qui prédomine, ce pourquoi nous la retenons.
Le regard
D’après la carte spatio-temporelle ci-dessus, Marker débute son film à la séquence sur le quai de Fogo, juste après les laissés pour compte de Tokyo. On dira, sans prétention aucune, qu’il y a une erreur et qu’en fait, il faut commencer le film sur ces derniers. En effet, l’ouverture débute avec les enfants d’Islande et le bonheur qu’ils inspirent ou doivent inspirer. Suit une liste, une énumération des choses qui font battre le coeur de Marker, précédées pour la plupart des mots "il m’écrivait…" et que l’on retrouvera en bonne partie à la toute fin du film.
Arrivent alors les "recalés du monde" et la voix off de dire: "il n’aimait pas s’attarder sur le spectacle de la misère". Marker décrit en quelques phrases la situation de ces humains déchus, qui attendent que la vie passe comme passent les saisons, et leur offre une tournée au bistrot de Namidabashi. "Ce genre d’endroit permet l’égalité du regard. Le seuil au-dessous duquel tout homme en vaut un autre, et le sait". Car ces hommes, bien que vivant et faisant partie intégrale de la société japonaise, sont purement et simplement ignorés, rejetés, effacés du monde des vivants. Les Japonais refusent de les voir, volontairement. Ils en deviennent des vivants invisibles dans une société qui a tout, ultra riche et futuriste. En contre point, Marker va alors opposer le Cap-Vert et des gens qui attendent, eux aussi, sur la jetée du port de Fogo. Mais contrairement
aux SDF et autres losers japonais, les Capverdiens n’ont pas besoin qu’on leur paie une tournée pour oser affronter le regard de l’autre (ou Marker). Spontanément, ils le font. Ces êtres à la pauvreté extrême, qui connaissent la faim et la misère la plus grande, poursuivent leur chemin, attendent le moment qui doit venir, patiemment, tels des chats. Tous, Japonais ou Capverdiens, connaissent la survie et l’affrontent au quotidien, mais le milieu dans lequel ils vivent diffèrent totalement.
On pourrait reprendre séquence par séquence:
• "Le Sahel n’est pas seulement ce qu’on en montre quand il est trop tard. C’est une terre où la sécheresse s’engouffre comme l’eau dans un bateau qui fait eau".
• Le petit groupe d’oisifs de la cour de l’Empereur à l’époque de Sei Shônagon "a laissé dans la sensibilité japonaise une trace autrement profonde que toutes les imprécations de la classe politique, en apprenant à tirer de la contemplation des choses les plus ténues une sorte de réconfort mélancolique…"
• "Il me décrivait ses retrouvailles avec Tokyo. Comme un chat rentré de vacances dans son panier se met tout de suite à inspecter ses endroits familiers. Il courait voir si tout était bien à sa place".
• "Il m’écrivait: "Tokyo est une ville parcourue de trains, cousue de fils électriques, elle montre ses veines"".
• "Il me disait qu’à bien observer les gestes de M. Yamada et sa façon de mélanger les ingrédients, on pouvait méditer utilement sur des notions fondamentales…"
La journée est passée et Marker poursuit en racontant une autre journée vouée au regard, celui accordé au seul poste de télévision de sa chambre d’hôtel et des émissions qui défilent toute la journée, jusqu’au bout de la nuit. Car la télévision, c’est la boîte à souvenirs. Or, il commence son texte par le haïku de Takarai Kikaku (et non de Basho, son maître): "Le
saule contemple à l’envers l’image du héron". Ce n’est rien d’autre qu’une métaphore du spectateur et de la télévision. Tout au long de ce chapitre, Marker joue sur le fait que le spectateur regarde, mais qu’il est lui-même l’objet de regards, regardé par ce qu’il regarde, par ce qui l’entoure.
On pourrait continuer à décrire pas à pas toutes les références au "regard" de ce chapitre, mais il y en a trop et cela n’est pas essentiel. En fait, Marker oppose ici Occident et reste du monde. Pour lui, l’Occident ne sait plus voir, il a perdu la magie du regard, il s’est abandonné corps et âmes au culte de Saint Matthieu et son "je ne crois que ce que je vois". Tout ce qui n’est pas visible, donc l’imaginaire, le fantastique, le sacré, le philosophique, le surnaturel, le poétique… est banni, rejeté comme étant futile. Le réel seul règne, et si possible mercantile. En cela, le Japon diffère. Bien que totalement inclus dans le mode de vie occidental, par la richesse qui le caractérise et son avancée technologique indéniable (dans les années 1980, c’était le pays de l’innovation par excellence), le Japon ne s’est pas détourné de l’invisible; au contraire, ce dernier fait partie intégrante de la vie quotidienne. "Les temples sont comblés de visiteurs qui viennent jeter leur pièce de monnaie et prier à la japonaise: une prière qui se glisse dans la vie sans l’interrompre". La culture japonaise, au contraire de la culture occidentale, accepte pleinement ce qu’elle ne connaît pas comme étant un possible. Par contre, comme pour les Burakumin, elle ne se gêne pas pour rejeter les membres de la population qui lui font honte selon des préceptes du Moyen Âge. Aussi, au Japon, le regard est partout. Il peut émaner de toute chose (de la télévision, des affiches, des peintures murales, etc.), pas seulement des êtres vivants. "Plus on regarde la télévision japonaise, plus on a le sentiment d’être regardé par elle. Que la fonction magique de l’oeil soit au centre de toutes choses, même le journal télévisé en témoigne". Pour les émissions pour adultes, les sexes sont cachés. Or Marker précise que "la censure n’est pas la mutilation du spectacle, elle est le spectacle". Par contre, pour le musée de Jozankei, sur l’île d’Hokkaido, les sexes sont ostensiblement montrés, tel ce pénis-fontaine que les femmes viennent caresser pour obtenir la réalisation de leur voeux touchant à la sexualité ou à la fertilité. Au Japon, "un sexe n’est visible qu’à condition d’être séparé d’un corps".
Pour l’Afrique, continent pauvre parmi les plus pauvres, il en va tout autrement qu’en Occident. Les peuples, bien que condamnés aux religions chrétiennes ou musulmanes par la volonté des colonisateurs, y restent fortement animistes. Le magique y a autant sa place que le réel. On regarde les choses sans se soucier uniquement des normes occidentales. Aussi, le regard des femmes sur les marchés guinéens ou capverdiens sont-ils francs et directs. Aujourd’hui encore, cela surprend. Dans le jeu futile, mais si plaisant, de la séduction, on est étonné de la puissance insoumise et fière du regard des femmes capverdiennes. Il ne se détourne pas. Il vous fixe. Et vous dit: "Je te plais, tu me regardes, tu me veux. Soit, alors montre-le-moi, si tu n’es pas trop lâche". Et bien sûr, l’homme occidental de détourner le regard, désarçonné par tant de malice et d’es pièglerie. Avec le temps, ayant saisi les règles, il parvient à jouer et alors les échanges de regards prennent une tout autre tournure, mais toujours avec une pointe d’humour et de jeu, ce qui en font de purs moments de délice.
En conclusion, c’est par les yeux, le premier de nos sens, que nous appréhendons le monde. Or, la civilisation moderne s’est imposée une norme qui la prive d’une part de ce que la vie offre, de bon comme de mauvais. À l’époque de Sans soleil, les pays pauvres, en particulier d’Afrique, semblaient pouvoir être les garants d’un regard plus ouvert. Le Japon, lui, se situe entre les deux. Comme l’écrit Marker, "la poésie japonaise ne qualifie pas". Les choses sont ce qu’elles sont, même si on ne
peut en saisir toute l’essence.
La frontière réel / imaginaire.
À partir de ce postulat, Marker va offrir tout un panel d’exemples essentiellement japonais qui illustrent la fragile (et probablement irraisonnée) séparation entre les mondes réel et imaginaire. Pour lui, l’histoire du chien Hachiko n’a rien à envier à celle de la vie de M. Akao, président du parti patriotique japonais, qui officie depuis des dizaines d’années. Lorsqu’il parle de la lutte contre la construction de l’aéroport de Narita, qui a été un des moments les plus forts des révoltes populaires et estudiantines des années 1960 au Japon, Marker la compare à la comédie musicale Brigadoon, qui raconte l’histoire de ce village écossais qui réapparaît un jour tous les cent ans, si bien que ses habitants vivent au XVIIIe siècle. Plus encore, à force de parcourir Tokyo de long en large, un jour il écrit: "Description d’un rêve… De plus en plus souvent, mes rêves prennent pour décor ces grands magasins de Tokyo, les galeries souterraines qui les prolongent et qui doublent la ville. (…) Tout le folklore du rêve y est tellement à sa place que le lendemain, réveillé, je m’aperçois que je continue de chercher dans le dédale des sous-sols la présence dérobée de la nuit précédente. Je commence à me demander si ces rêves sont bien à moi, ou s’ils font partie d’un ensemble, d’un gigantesque rêve collectif dont la ville tout entière serait la projection (…) Le train peuplé de dormeurs assemble tous les fragments de rêves, en fait un seul film, le film absolu.
Les tickets du distributeur automatique deviennent des billets d’entrée".
Le rêve et le réel se mêlent et s’entremêlent, réparant la fracture injustement créée par la société occidentale moderne. Le problème pour Marker, c’est que les images d’aujourd’hui prétendent être ce qu’elles ne sont pas, ni ne seront jamais: une transcription précise de la réalité. Les images sont toujours une création pour au moins deux raisons: tout d’abord ce qui est saisi durant le 24e de seconde que dure la prise de vue n’est plus, mais aussi parce que toute image est soumise à interprétation dépendante du contexte socio-politique, de la culture du spectateur à l’époque même où il la regarde, etc. C’est pourquoi Marker introduit le bidouilleur Hayao Yamaneko et sa Zone (nommée en hommage au film Stalker de Andreï Tarkovski, sorti sur les écrans quelques années auparavant). Cet alias de Marker modifie les images pour leur retirer la majeure partie de leur intérêt représentatif, soit "des images moins menteuses, dit-il avec la conviction des fanatiques, que celles que tu vois à la télévision. Au moins, elles se donnent pour ce qu’elles sont, des images, pas la forme transportable et compacte d’une réalité déjà inaccessible".
En extrapolant, on pourrait dire que la réalité n’existe pas. Tout comme la vérité, il y en a autant que de protagonistes. De ce fait, si la réalité n’est pas, comment peut-on rejeter l’imaginaire, qu’il s’agisse de rêves, de visions, de créations, de souvenirs… ? Peut-être faut-il du courage, pour un Occidental, pour accepter cette idée. Comme dans Stalker, on a le monde normal. Et puis, il y a la Zone, cet espace mystérieux interdit d’accès par les autorités et cerné par la police. Elle contient un secret: un espace (la Chambre) qui permet de réaliser tous les souhaits. Tenter de s’y rendre nécessite donc beaucoup de courage et de volonté. Et pour y parvenir, il faut l’aide des "stalkers", soit des passeurs, des guides qui seuls peuvent comprendre les règles qui y règnent et éviter les dangers. Mais les "stalkers" ne peuvent entrer dans la Chambre. Or dans le film, le professeur et l’écrivain, bien qu’arrivés à la Chambre, ne rentrent pas pour y exaucer leur voeu. En fait, la véritable question de Stalker, c’est de savoir: la Zone existe-t-elle vraiment? Rien ne le prouve. Se pourrait-il, en fin de compte, que les "stalkers" ne soient que de fantastiques raconteurs d’histoires, capables de faire croire par leur seule conviction à l’existence d’un monde inexistant?
Quoiqu’il en soit, Marker finit ce chapitre avec la séquence sur le jeu Pac-Man. "Peut-être qu’il est la plus parfaite métaphore graphique de la condition humaine. Il représente à leur juste dose les rapports de force entre l’individu et l’environnement, et il nous annonce sobrement que s’il y a quelque honneur à livrer le plus grand nombre d’assauts victorieux, au bout du compte, ça finit toujours mal". Et poursuit, "j’ai entendu cette phrase: "la cloison qui sépare la vie de la mort ne nous paraît pas aussi épaisse qu’à un Occidental". Ce que j’ai lu le plus souvent dans les yeux de ceux qui allaient mourir, c’est la surprise. Ce que je lis en ce moment dans les yeux des enfants japonais, c’est la curiosité. Comme s’ils essayaient, pour comprendre la mort d’une bête, de voir à travers la cloison". Clôturant ainsi son chapitre sur la "fausse" séparation entre le réel et l’imaginaire, qui ne touche que peu les enfants, mais soumet les adultes au dictat du "je ne crois que ce que je vois", Marker semble embrayer sur la thématique de la Mort. Il insère ici la séquence du film Mort d’une girafe (1970) de Danièle Tessier. Et entame son 3e chapitre par la phrase: "je reviens d’un pays où la Mort n’est pas une cloison à franchir, mais un chemin à suivre".
La mémoire
En fait, Marker va faire une digression par la mémoire et ses défaillances. Pour cela, il quitte le Japon pour l’Afrique, et plus précisément le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. À partir d’images d’archives et d’images de documentaires empruntées pour l’occasion, il retrace le voyage de départ d’Amílcar Cabral des îles Bijagos, puis l’arrivée de son demi-frère, Luís Cabral, qui deviendra président du Conseil d’État de la République de Guinée-Bissau en 1974. Enfin, suivent les images de remise de médailles à des guérilleros du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), dont le commandant Nino qui pleure. Et Marker de préciser: "Et maintenant la scène se transporte à Cassaca, le 17 février 1980 – mais pour bien la lire, il faut encore avancer dans le temps: dans un an, Luís Cabral, le président, sera en prison, et l’homme qu’il vient de décorer et qui pleure, le commandant Nino, aura pris le pouvoir. Le Parti aura éclaté, Guinéens et Capverdiens séparés se disputeront l’héritage d’Amílcar. On apprendra que, derrière cette fête de remise des grades qui perpétuait aux yeux des visiteurs la fraternité de la lutte, il y avait toutes les amertumes des lendemains de victoire, et que les larmes de Nino ne disaient pas l’émotion de l’ancien guerrier, mais l’orgueil blessé du héros qui ne s’estime pas assez distingué des autres. Et sous chacun de ces visages, une mémoire. Et là où on voudrait nous faire croire que s’est forgée une mémoire collective, mille mémoires d’hommes qui promènent leur déchirure personnelle dans la grande déchirure de l’Histoire".
Pour Marker, il n’existe pas de mémoire collective, seulement des mémoires individuelles, empreintes de solitude. Il poursuit en disant: "Je vous écris tout ça d’un autre monde, un monde d’apparences. D’une certaine façon, les deux mondes communiquent. La mémoire est pour l’un ce que l’Histoire est pour l’autre. Une impossibilité. Les légendes naissent du besoin de déchiffrer l’indéchiffrable. Les mémoires doivent se contenter de leur délire, de leur dérive. Un instant arrêté grillerait, comme l’image d’un film bloquée devant la fournaise du projecteur. La folie protège, comme la fièvre. J’envie Hayao et sa Zone. Il joue avec les signes de sa mémoire, il les épingle et les décore comme des insectes qui se seraient
envolés du Temps et qu’il pourrait contempler d’un point situé à l’extérieur du Temps – la seule éternité qui nous reste. Je regarde ses machines, je pense à un monde où chaque mémoire pourrait créer sa propre légende".
À ces derniers mots, on pense immédiatement à La Jetée, mais c’est Vertigo d’Alfred Hitchcock qui apparaît, le "seul film qui avait su dire la mémoire impossible, la mémoire folle", un film qu’il avait alors vu 19 fois. Pour se souvenir, il a même effectué un pèlerinage à San Francisco où le film d’Hitchcock a été tourné. Il nous montre alors des séquences de chacune de ses visites sur les lieux du film, comme autant de preuves, notant au passage ce qui avait été créé de toute pièce par Hitchcock et ce qui était préexistant.
Cela fait, Marker nous raconte la genèse de Sans soleil, du moins une version qui n’est pas la véritable, mais qui pourrait l’être pour ceux qui ne connaissent pas les détails de cette genèse originale. Il s’agissait, au départ, de l’idée d’un voyage dans le futur, en 4001, date à laquelle le cerveau humain est parvenu au stade du plein emploi. "Tout fonctionne à la perfection, de ce que nous autres laissons dormir, y compris la mémoire. Conséquence logique: une mémoire totale est une mémoire anesthésiée. Après beaucoup d’histoires d’hommes qui avaient perdu la mémoire, voici celle d’un homme qui a perdu l’oubli... – et qui, par une bizarrerie de sa nature, au lieu d’en tirer orgueil et de mépriser cette humanité du passé et ses ténèbres, s’est pris pour elle d’abord de curiosité, ensuite de compassion. Dans le monde d’où il vient, appeler un souvenir, s’émouvoir devant un portrait, trembler à l’écoute d’une musique ne peuvent être que les signes d’une longue et douloureuse préhistoire. Lui veut comprendre. Ces infirmités du Temps, il les ressent comme une injustice, et à cette injustice, il réagit comme le Che, comme les jeunes des Sixties, par l’indignation. C’est un tiers-mondiste du Temps, l’idée que le malheur ait existé dans le passé de sa planète lui est aussi insupportable qu’à eux l’existence de la misère dans leur présent". Il appellera ce film Sans soleil en rapport à l’oeuvre de Moussorgski. Et il termine son propos par: "bien sûr, je ne ferai jamais ce film". Faux souvenirs, fausse mémoire de l’auteur, faux-semblants…
En fait, Marker est tout du long hanté par la mélancolie. Il a le sentiment que les sociétés futures, trop fixées sur la vitesse et le gain, auront franchi l’ultime pas: celui où la mémoire disparaîtra et sera remplacée par des bases de données factuelles ou des ersatz de mémoire, sans valeur spirituelle ou morale, juste des attractions touristiques des moments du passé, des temps anciens. Nouvelles mythologies? Comme il le dit, parlant du XXe siècle, "la cassure de l’Histoire a été trop violente. J’ai touché cette cassure au sommet de la colline, comme je l’avais touchée au bord de la fosse où deux cents filles s’étaient suicidées à la grenade, en 1945, pour ne pas tomber vivantes aux mains des Américains. Les gens se font photographier devant la fosse. En face, on vend des briquets-souvenirs, en forme de grenades".
La "poignance" des choses
Le 4e chapitre peut s’ouvrir. L’Horreur décrite dans Apocalypse Now (comprenez, l’Apocalypse maintenant), ou dans le reportage sur les Khmers rouges du Cambodge, deux versions (fiction et réel) d’une même histoire, nous l’avons dit, c’est la mise à mort. Il était un temps où les esprits des morts veillaient sur les vivants et où les vivants honoraient les morts. Aujourd’hui, tout tend à disparaître. La mémoire des "passeurs" même, les religieux dont les Noro, est vouée tout prochainement à disparaître, alors que jusque-là, elle était garantie par la transmission de Noro à Noro.
Dans le monde d’aujourd’hui, la mort, outre la douleur, c’est avant tout et surtout une cérémonie consensuelle, apparat sans âme, où médisance et propos convenus se côtoient dans l’attente du qu’en dira-t-on et de la répartition de l’héritage. L’aspect religieux, mystique de la cérémonie tend à disparaître, s’il n’a pas déjà disparu. Tels les kamikazes japonais, les humains d’aujourd’hui deviennent des machines sans âme, soi-disant indifférents face à la mort. Mais Ryoji Uehara nous rappelle, par l’intermédiaire de Marker, qu’un humain reste un humain, qu’au fond de lui, quoi qu’on en dise, quoi qu’on fasse, il veut… vivre ! Seuls ceux qui tuent machinalement, massacrent les populations sans émotion, tels les Khmers rouges ou les soldats de l’Apocalypse, ne sont autres que des fantômes sans âme.
Marker écrit alors: "Tout d’un coup, on est dans le désert comme dans la nuit. Tout ce qui n’est pas lui n’existe plus. Les images qui se proposent, on ne veut pas les croire". À partir de là, il rebondit. La solution, ou du moins ce qui peut aider les humains à ne pas se perdre, à rester humain, ce n’est autre que la "poignance" des choses, si fortement ancrée dans la société japonaise. Tout comme la poésie japonaise ne qualifie pas, la société japonaise prend les objets comme ils sont, mais en plus elle leur accorde une âme. Ainsi, même les débris de fête ont droit à leur cérémonie, à leur Dondo-yaki. Et la voix off de dire: "Il faut que l’abandon soit une fête, que le déchirement soit une fête, que l’adieu à tout ce que l’on a perdu, cassé, usé, s’ennoblisse d’une cérémonie". Autrement dit, l’Occidental doit, à l’image des Asiatiques et des Africains, revenir, ou plutôt ne pas perdre le mystique, le sacré. Non pas le sacré qu’on expose dans des vitrines, tel un monstre de foire, mais le mystique qui échappe à la raison, qu’on ne peut saisir et qui fait que les choses sont vivantes, et qui rend la vie meilleure, car supportable. Ainsi, Marker, montrant l’exemple, prend-il le temps de s’arrêter pour honorer les esprits des lettres déchirées, des lettres non envoyées, des voitures cassées, dans le but de vaincre "l’insupportable vanité de l’Occident, qui n’a pas cessé de privilégier l’être sur le non-être, le dit sur le non-dit".
"À ce moment-là, la poésie sera faite par tous, et il y aura des émeus dans la Zone".
Notes
[4] http://www. liedetmelodie.org/wp-content/uploads/2013/10/Conf%C3%A9rence-MOUSSORGSKI_version-site-internet.pdf
[5] "Officiel" parce que Marker envoyait régulièrement des infos à son concepteur Daniel L. Potter.
[6] téléchargez le "pdf".
[7] N° 6, 1993, 79-97.
[8] Thoma Vuille, M. CHAT, 2010, Paris, éd. Alternatives, p. 30.
[9] "Témoignage de Valérie Mayoux: monteuse" (recueilli par Olivier Khon et Hubert Niogret), Positif, n° 433, mars 1997, p. 93-95. Remarque (hors livret): Catherine Belkhodja avait donné, en réponse à un post de Matthew O'Toole daté du 19 décembre 2017 sur le groupe Chris Marker de Facebook, une description intéressante de la technique du montage chez Marker: "Chris ne montait pas ses films de façon traditionnelle. Naturellement, il sélectionnait quand même une partie parmi les rushs, mais il avait la technique particulière de "monter utile" directement. Il ne séparait pas le montage visuel du montage sonore. Au contraire, les deux étaient parfaitement imbriqués puisque Chris fonctionnait par intuition. Disposant d'une mémoire très précise, il se souvenait d'un instant précis T sur un rush déjà visionné et savait précisément à quelle place le retrouver pour l'accoler à l'image précédente. Sa remarquable théorie sur les commentaires (réf. Lettre de Sibérie) l'incitait à rester prudent sur le fait de commenter des images déjà organisées. Il tricotait ainsi de façon très subtile l'image et le son, sans que l'un prédomine sur l'autre, mais avançant toujours en minutes utiles."
"La genèse du film"
(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020, p. 117-126)
À la fin de l’année 1977, sort sur les écrans parisiens Le Fond de l’air est rouge, un film-somme réalisé par Chris Marker, d’une durée alors de 4 heures. Outre le fait que ce film a nécessité beaucoup d’énergie et de temps, il se veut un bilan sur le socialisme, auquel Chris Marker, jusqu’alors fervent socialiste, ne croit plus.
C’est dans ce cadre que voit le jour Sans soleil, entre mélancolie et illusions perdues. Aussi, la genèse de ce nouvel opus est longue, et pour cause: avec ce film, qui est considéré par la plupart comme son chef-d’oeuvre, Chris Marker va aller encore plus loin et tourner une page, comme il l’explique très bien dans une lettre adressée à des admirateurs américains, à la fin des années 1990. "Ah, et le film m’a-t-il changé? Eh bien, peut-être vous rappelez-vous le moment où j’évoque l’année du chien. Je venais d’avoir soixante ans à l’époque, ce qui signifie que les différentes combinaisons entre les douze animaux de l’année et les quatre éléments sont épuisées et que l’on entame une toute nouvelle vie. Je n’avais pas réalisé cela en commençant, mais j’ai compris à ce moment-là que le film entier était une manière d’exorciser ces soixante années passées sur cette planète véreuse, et une façon de prendre congé d’elles. On peut certainement parler d’un changement"[10]. Et de fait, Sans soleil marque une césure nette dans l’oeuvre de Marker, ouvrant la porte à ce que l’on a depuis coutume de considérer comme la dernière période de son travail, axée sur le numérique et sur la mémoire.
Dans la même lettre, Marker précise: "Le tournage s’est étalé de 1978 à 1981, au gré de mes différents voyages alternativement au Japon et à Bissau (…) et je ne saurais dire à quel moment ces fragments disparates ont commencé à prendre la forme d’un véritable film".
En contrepoint, on serait tenté de se fier à ce qui est dit de la genèse du film dans le film lui-même. Il ne faut pas! Marker s’amuse plus que jamais à y mystifier le Temps, voire se trompe totalement. Sans soleil commence par: "La première image dont il m’a parlé, c’est celle de trois enfants sur une route, en Islande, en 1965". Plus avant dans le film, il continue: "En Islande, j’ai posé la première pièce d’un film imaginaire. Cet été-là, j’avais rencontré trois enfants sur une route, et un volcan était sorti de la mer. Encore un coup de l’Ensemblier". Le paysage désertique d’Islande devient alors le point de départ d’un possible film racontant l’histoire d’un homme venant du futur, de l’an 4001 (petit clin d’oeil au 2001 de Kubrick). Le titre en serait tiré d’une oeuvre de Moussorgski intitulée… Sans soleil. Et la voix off d’ajouter: "Bien sûr je ne ferai jamais ce film!". Enfin, avant de clore son vrai film, Marker revient sur l’image du début et la voix off de poursuivre: "Et c’est là que, d’eux-mêmes, sont venus se greffer mes trois enfants d’Islande. (…) La ville d’Heimaey s’étendait au-dessous de nous et lorsque, cinq ans après, Haroun Tazieff m’a envoyé[11] ce qu’il venait de tourner au même endroit, il ne me manquait que le nom pour apprendre que la nature fait ses propres Dondo-yaki. Le volcan s’était réveillé. J’ai regardé ces images, et c’était comme si toute l’année 65 venait de se recouvrir de cendres". En fait, ce passage laisserait penser que Marker savait déjà ce qu’il allait faire en 1965, ce qui n’est bien évidemment pas le cas. De même, les images envoyées par Tazieff ne sont pas tournées à l’intention de Marker en 1970, comme le stipule le générique de fin, car l’éruption de l’Eldfell survint le 23 janvier 1973. Quoiqu’il en soit, l’éruption pris fin en juillet de la même année et une partie de la ville fut ensevelie, au profit du port qui assurait la survie économique de l’île, dont la vie reprit tout simplement une fois le volcan calmé.
On pourrait également citer les passages sur les émeus de l’Île-de-France. Ceux-ci n’auraient pas été filmés spécifiquement pour Sans soleil. En est-on sûr? Lorsqu’on cherche dans les articles, études ou autres interviews, il apparaît à chaque fois que les émeus de l’Île-de-France utilisés par Chris Marker ont été filmés dans le cadre de la réalisation
d’un clip vidéo intitulé Getting Away With It pour le groupe Electronic[12], en 1989. D’après Marker lui-même, c’est Yves Angelo, le chef opérateur rencontré sur le tournage de son film Mémoire pour Simone, en 1984, qui aurait tourné ces images[13]. Dans une interview de Catherine Belkhodja ("héroïne" du clip et du film Level Five) accordée à Nicolas Rioult pour la revue Première et parue en novembre 2013[14], celle-ci confirme les dires, précisant au passage qu’il s’agissait de la Réserve zoologique du château de Sauvage, à Émancé, au sud-ouest de Paris[15]. Or, si la rencontre avec Yves Angelo a lieu en 1984 et Getting Away With It date de 1989, comment ces images pouvaient-elles être insérées dans Sans soleil qui, pour rappel, a été achevé à la fin de l’année 1982? Aussi, au final, on peut dire que les images des émeus de l’Ile-de-France insérées dans Sans soleil sont probablement de Marker lui-même, de même que celles concernant le tombeau / cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau sur l’île aux peupliers à Ermenonville, et la tour en ruine du château de Montépilloy, tous deux situés au nord-est de Paris, à quelques kilomètres de Senlis. En conclusion, lorsqu’on étudie une oeuvre de Chris Marker, il faut toujours être attentif et sur ses gardes, toujours tout vérifier, même le plus anodin, car le maître vit sa vie comme il crée ses oeuvres: un pas dans le réel, un pas dans l’imaginaire et le rêve.
Quoiqu’il en soit, c’est à la demande de Mário de Andrade que Marker se rend en Guinée-Bissau, afin d’y former les futurs professionnels de l’audiovisuel de ce pays tout fraîchement indépendant et où tout est alors à faire. Nous avons pu avoir plus de détails sur cette collaboration jusqu’alors extrêmement mal connue grâce au récent travail de l’artiste Filipa César. En effet, en 2017, elle s’intéresse à l’Institut national du cinéma guinéen, dont l’avenir semble aujourd’hui très sombre, et réalise un documentaire intitulé Spell Reel, diffusé sur la plateforme mubi.com. Dans ce dernier, elle y interviewe plusieurs participants du projet initial, dont Sana Na N’Hada qui décrit son expérience en ces termes: "La personne qui a mis les quatre réalisateurs16 en contact avec le monde extérieur a été l’Angolais Mário de Andrade, un des co-fondateurs du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA). Avec lui, nous avons fondé l’Institut national du film. Dans ce contexte, Chris Marker est venu en Guinée-Bissau en 1979, avec Sarah Maldoror[17] qui est venue avec son équipe pour tourner un film ici et au Cap-Vert[18]. Nous sommes restés trois mois avec Chris Marker, apprenant le montage. Andrade avait demandé à Marker de tester notre connaissance du cinéma afin de savoir si nous pouvions être ou non réalisateurs. Il semble que personne ne croyait que nous pouvions faire du cinéma par nous-mêmes en Guinée. Aussi, il délivra un rapport sur son travail avec nous durant ces trois mois et il me remit une copie devant Mário de Andrade. C’est à ce moment-là que nous avons compris que nous avions été testés. Le futur du cinéma guinéen était entre les mains de Chris Marker. Plus tard, il partit et revint avec un projecteur 16mm, du matériel vidéo noir et blanc, et une collection de films à étudier par nous, de ses films et d’autres films. Puis, j’ai tourné Le Carnaval de Bissau. Marker a pris les bobines et les a utilisées dans le film Sans soleil".
Dans ce court extrait, Sana Na N’Hada nous apprend également que Marker a fait au moins deux séjours en Guinée-Bissau. C’est probablement dans le même temps qu’il visita le Cap-Vert, à savoir les îles de Sal, Fogo et Santiago. Accompagnait-il Sarah Maldoror ou profitait-il de l’escale imposée à l’aéroport international de Sal? Nul ne le sait. Mais au final, Marker ne semble pas avoir beaucoup filmé dans ce pays car l’essentiel de ce qu’il intègre à Sans soleil consiste en de longues contemplations du désert de Sal et de ses plages vides, une multitude de "portraits" figés de gens qui attendent au port, inébranlables et indifférents face au temps qui passe, ou ceux de femmes qui vendent sur les marchés locaux le peu de
produits disponibles, l’indispensable pour la survie.
Pour le reste, notons qu’on ne sait pas trop comment Mário de Andrade et Chris Marker sont entrés en contact. Peut-être par l’entremise du réseau de la revue française Présence africaine, dont Andrade avait été secrétaire général dans la seconde moitié des années 1950 (alors qu’il étudiait à la Sorbonne) et qui avait aussi commandité, en 1950, Les Statues
meurent aussi à Alain Resnais et Chris Marker. Par ailleurs, cette aventure pédagogique n’est pas sans nous rappeler celle des Groupes Medvedkine, qui débuta en 1967 et durant laquelle Marker et d’autres professionnels français du cinéma initièrent les ouvriers en grève des usines Rodhiaceta à la pratique cinématographique, développant ce que l’on appellera dès lors le "cinéma militant".
Pour le Japon, nul doute qu’il y a effectué plusieurs voyages. Marker aime le Japon pour le dépaysement qu’il provoque et ce depuis qu’il y a tourné Le Mystère Koumiko à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Tout en tournant des rushes pour Sans soleil, il prend également des photos. Et dans le même temps que sort le film, Marker publie aux éditions Herscher, à Paris, un ouvrage atypique: Le dépays, dont l’avertissement au lecteur, comme le souligne Florence Delay dans son interview intégrée au bonus de cette édition, résonne fortement avec le film. "Le texte ne commente pas plus les images que les images n’illustrent le texte. Ce sont deux séries de séquences à qui il arrive bien évidemment de se croiser et de se faire signe, mais qu’il serait inutilement fatigant d’essayer de confronter. Qu’on veuille donc bien les prendre dans le désordre, la simplicité et le dédoublement, comme il convient de prendre toutes choses au Japon".
Mais désireux de préciser sa pensée et ses inspirations, Marker nous offre un autre texte, dans le dossier de presse de Sans soleil (ci-après dans ce livret), tiré de l’introduction d’André Beaujard aux Notes de chevet de Sei Shônagon, du début du XIe siècle, qui décrit avec simplicité le cheminement (et donc la structure apparente) de Sans soleil: "Les sôshi, comme les nikki, sont des écrits intimes; mais, à la différence des journaux, ils ne respectent pas d’ordre chronologique ni, d’une manière générale, aucun plan: il s’agit d’esquisses dont l’auteur a jeté sur le papier, "en laissant aller son pinceau", toutes les idées, les images, les réflexions qui lui sont venues en l’esprit, et c’est bien ainsi, d’après Sei elle-même, qu’elle écrivit ses Notes. // On ne sera pas surpris de voir les sujets les plus divers se succéder immédiatement. On ne s’étonnera point d’y trouver des passages qui se répètent et d’autres qui se contredisent; on ne s’attardera pas à chercher pourquoi l’auteur parle en tel endroit de ceci ou de cela, encore que l’on puisse deviner parfois comment se lient ses idées: un mot, dans l’une de ces énumérations auxquelles Sei accorde tant de place, lui rappelle une anecdote qu’elle prend dans ses souvenirs personnels ou dans ses lectures; ou bien, au contraire, en faisant un récit elle pense à telle chose ou à telle personne, et dans son esprit elle en rapproche d’autres, dont elle donne la liste. // Elle arrive ainsi à parler à peu près de tout."
Il faut dire que le Japon et sa mystique singulière et extrême imprègne toute l’oeuvre de Chris Marker. Il ne s’en lasse pas. Après Sans soleil, il tournera encore Level Five, un long métrage de fiction réalisé en 1996 et qui reprendra une partie des thèmes de Sans soleil pour les développer, une interview d’Akira Kurosawa intitulée A.K. (1985) réalisée sur le tournage de Ran, mais aussi des courts métrages tels que Tokyo Days (1986) ou Bullfight in Okinawa (1992), qu’il insérera dans son installation vidéo Zapping Zone : proposals for an imaginary television (1990-1994).
Avant d’achever ce bref résumé de la genèse de Sans soleil, il faut encore préciser l’influence importante de deux autres oeuvres cinématographiques contemporaines. La première, franco-japonaise, n’est autre que Le Labyrinthe d’herbes de Shuji Terayama. En effet, ce film fortement érotique et esthétisant, sorti en 1979, marqua sans aucun doute la réalisation
de Sans soleil. Non seulement, il est produit par Pierre Braunberger, directeur des Films du Jeudi, avec lequel Marker a beaucoup travaillé[19], mais en plus on y retrouve, pour la version française, la voix off de Florence Delay. Est-ce là tout? Non! La version française est créditée à un certain Boris Villeneuve qui n’est autre que… Chris Marker, de son vrai nom
Christian Bouche-Villeneuve. La boucle est bouclée.
L’autre film, germano-russe, est également sorti en 1979. Il est le fruit d’un esprit reconnu comme génial qui non seulement influencera Marker jusqu’au bout, mais plus encore qui sera un ami, voire un mentor. Il s’agit d’Andreï Tarkovski. Avec son film Stalker, adaptation d’un roman d’Arcadi et Boris Strougatski, Tarkovski marque au fer rouge l’esprit de Marker, si bien que ce dernier n’hésite pas à nommer "la Zone" l’ensemble des images de Hayao Yamaneko, le responsable des effets spéciaux du film, qui n’est autre que Chris Marker lui-même. Comme on le voit, Sans soleil est un grand melting-pot inséré, ou plutôt mis en abîme dans un autre gigantesque melting-pot qui est l’oeuvre de Chris Marker et la culture prodigieuse qui s’y rattache. Loin d’être fouillis, l’artiste peaufine, création après création, ses idées, ses doutes, ses mémoires et ses rêves qu’il offre alors au public, afin non pas que ce dernier se cultive à son tour, mais afin qu’il lui prenne l’envie de faire de même dans et pour sa propre existence. "À ce moment-là, la poésie sera faite par tous et il y aura des émeus dans la Zone". Chris Marker, plus qu’un montreur ou un pédagogue, est avant tout et surtout un passeur, que seuls les plus hardis ou téméraires oseront rapprocher des "stalkers" de Tarkovski!
Notes
[10] La lettre n’est pas datée précisément, mais Marker y mentionne l’éclatement de la guerre civile en Guinée-Bissau la même année, or celle-là a éclaté en juin 1998. La traduction française de la lettre est éditée dans le livret.
[11] L’amitié entre Marker et Tazieff date du tournage du film Le Volcan interdit, en 1966, dont Marker avait écrit le commentaire.
[12] Le groupe est composé de Bernard Summer, du groupe New Order, de l’exguitariste des Smiths, Johnny Marr, et du chanteur des Pet Shop Boys, Neil Tennant, et le clip est produit par Michael H. Shamberg, pour lequel Marker réalisera des
images infographiques intégrées au long métrage Souvenir, en 1997.
[13] Chris Marker, "Je ne me demande jamais si, pourquoi, comment..." (propos recueillis par Jean-Michel Frodon), Le Monde, 20 février 1997, p. 31. Une partie des rushes sera utilisé également dans le film Level Five (1996) de Marker.
[14] "À la rencontre de Chris Marker", Première, 20 novembre 2013.
[15] La Réserve a été fermée au public par la mairie au printemps 2017.
[16] Les quatre réalisateurs guinéens sont Sana Na N’Hada, Flora Gomes, José Bolama Cobumba et Josefina Crato. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/22/chris-marker-et-l-afrique-le-pouvoir-de-la-camera-au-service-ducontinent_5319759_3212.html
[17] Sarah Maldoror est une réalisatrice française, d’origine guadeloupéenne. Elle est également la compagne de Mário Pinto de Andrade. En 1970, elle a déjà réalisé Des fusils pour Banta, un long métrage de fiction tourné en Guinée-Bissau. En 1979, elle réalise deux courts-métrages documentaires sur le Cap-Vert: Fogo, ile de feu et Un carnaval dans le Sahel. En 1980, sortira le documentaire Carnaval en Guinée-Bissau.
[18] La monteuse Anita Fernández est aussi du voyage et c’est elle qui reprendra un temps les rênes du projet au départ de Marker qui devait se rendre au Japon pour y assister aux élections législatives de juin 1980.
[19] Pierre Braunberger a en particulier produit Cuba si de Chris Marker en 1961.
"Références culturelles choisies"
(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020, p. 129-140)
Les oeuvres de Chris Marker sont réputées depuis le départ pour être savantes, érudites, voire précieuses (dans le sens péjoratif du terme tel qu’illustré par Molière en son temps). La culture de Marker est immense et il ne se prive pas pour en imprégner chacune de ses réalisations, de manière tout à la fois intuitive et naturelle, non dans un but pédant comme on le lui a souvent reproché, mais dans celui plus noble d’enrichir son exposé d’exemples célèbres et donc reconnus. Autrement dit, chaque référence proposée est intégrée pour faire sens. La gentillesse de Marker fait que ceux qui ne sauraient pas retrouver ces références ni ne les auraient intégrées à leur propre culture générale, peuvent sans aucun problème aller de
l’avant et visionner le film. Elles ne sont pas un prérequis indispensable et absolu pour comprendre ce dernier, juste un plus pour saisir son propos et l’inscrire dans un ensemble plus vaste. Quelques fois, elles ne sont qu’un simple jeu.
Sans soleil n’y fait pas exception. On y trouve au moins trois types de références: littéraires, cinématographiques et pour le Japon, culturelles. On pourrait probablement ajouter les références musicales, mais c’est là un domaine que nous ne maîtrisons pas, aussi nous nous abstenons. Libre à d’autres de se lancer dans l’aventure.
Précisons encore que nous n’avons pas pu trouver toutes les références, dont, par exemple, celle de la flûte indienne et la musique chez Godard et Shakespeare, ou encore les citations d’Amílcar Cabral sur la traversée du fleuve et celle de Miguel Torga sur la "sublimation de sa propre image".
Références littéraires
La première mention est celle essentielle de Sei Shônagon, écrivaine japonaise du XIe siècle, soit, pour rappel, l’époque où apparaissent les premiers écrits de langues vulgaires en France, période des vies de saints, des chansons de geste et autres romans courtois, en plein coeur du Moyen Âge. Marker donnant l’essentiel de l’information dans son film, nous ne nous y arrêterons pas.
La deuxième référence est plus surprenante. Elle apparaît aux vingt premières minutes du film, lorsque Marker parle de l’invention du cinémascope par les Japonais dix siècles avant le cinéma. Les héroïnes de bande dessinée s’échappent et apparaissent sur les murs de Tokyo, "toute la ville est une bande dessinée. C’est la planète Mongo". Qu’est-ce donc que cela? En fait, Marker parle de bande dessinée et les amateurs de comics américains ont immédiatement saisi la référence. La planète Mongo appartient à l’univers de Flash Gordon. Et si Marker la mentionne ici, c’est parce qu’en décembre 1980, sortait sur les écrans un film de Mike Hodges, intitulé Flash Gordon, adaptation de la bande dessinée dans laquelle le héros affronte, sur la dite planète Mongo, le maléfique empereur Ming qui fait tout son possible pour détruire la Terre.
La référence suivante ne lasse pas d’étonner. En effet, elle comporte une double erreur, ce qui est rare chez Marker. Matsuo Bashō vécut à Edo (actuel Tokyo) de 1644 à 1695, soit au XVIIe siècle (non le XVe, comme dit par les voix off française et anglaise). Figure majeure de la poésie japonaise, il écrivit le haïku suivant: "Sous la pluie d’été / Raccourcissent / Les pattes du héron". Le haïku "Le saule / Contemple à l’envers / L’image du héron" est en fait de la main de Takarai Kikaku, l’un
des disciples les plus accomplis de Bashō, vivant entre 1661 et 1707 dans la même ville.
Par ailleurs, Chris Marker avait déjà utilisé l’oeuvre de Christophe pour son premier film sur le Japon, Le Mystère Koumiko, réalisé en 1965. La famille Fenouillard et ses aventures au Pays du Soleil-Levant y avait même servi de prélude. Dans Sans soleil, il s’agit avant tout d’un clin-d’oeil, même si l’extravagant M. Fenouillard visite un Japon réel tout en étant empli d’un Japon imaginaire, à bien des égards plus prégnant dans son esprit.
Suivent immédiatement Nerval et Rousseau. Deux auteurs français majeurs dont la place ici est loin d’être anodine. Gérard de Nerval (1808-1855) est un écrivain névrosé dont la vie de cigale finit par lui brûler les ailes. On ignore s’il s’est suicidé ou s’il fut assassiné. Le mystère demeure. À la fin de sa vie, il connaît la misère et jongle avec la folie. Mais c’est précisément à cette période qu’il rédige deux de ses chefs-d’oeuvre: Sylvie (1853) et Aurélia ou le rêve et la vie (1855). Les deux textes sont écrits parallèlement alors que Nerval est pris par des vagues de crises psychiques qui lui valent d’être interné à plusieurs reprises. L’intrigue de l’oeuvre est la suivante: un jeune provincial venu à Paris, vit un amour chimérique avec une actrice de théâtre prénommée Aurélie. Un soir, il décide de retourner sur sa terre natale. Chemin faisant, il se souvient des moments de sa jeunesse, ses amours passées, le bonheur qu’il a laissé filé au profit de fantasmes parisiens. Tout du long du récit, se mêlent les frontières entre monde réel et monde imaginaire. De son coté, Aurélia est un récit inachevé qui avait pour but de décrire l’état dans lequel l’auteur se trouve psychiquement, entre rêve (ou folie) et vie, comme l’indique le sous-titre. L’intrigue et la structure sont cependant différentes de celle de Sylvie. Nerval y décrit les folles pensées d’un homme qui, apprenant la mort de la femme de sa vie, se persuade de l’imminence de sa propre mort, décrivant et commentant tout à la fois ses rêves. Aussi le texte mêle différents types de narration, un peu comme Marker dans Sans soleil, se livrant à l’écriture de ses pensées, de ses rêves, de ses doutes, de ses peurs, pêle-mêle, jonglant sans difficulté
entre réalité et imaginaire.
Qui ne connaît pas Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)? Tout à la fois écrivain, philosophe et musicien genevois, l’homme fascine. Marker y fait ici référence en mémoire au "promeneur solitaire". En effet, dans Sans soleil, Marker insère des images du tombeau / cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau, situé sur l’île aux peupliers, à Ermenonville, à l’ouest de Paris, où l’écrivain passa les derniers mois de sa vie, poursuivant la rédaction d’un ouvrage célèbre, mais posthume: Les Rêveries du promeneur solitaire, qui paraîtront en 1782, à Lausanne, en Suisse. Rousseau finit sa vie guère mieux que Nerval, entre solitude et paranoïa. Ses Rêveries sont un mélange d’autobiographie et de réflexion philosophique. Composé de 10 sections (les "promenades"), l’ouvrage traite de la nature de l’être humain et de son esprit, tout en développant une vision philosophique du Bonheur, possible surtout grâce à un état de solitude et de contemplation, à une déambulation mentale tout autant que physique dans la nature qui l’environne. Par assimilation, les Rêveries invitent le lecteur à se transposer dans le monde de Rousseau, de telle sorte que le dit lecteur finit inévitablement par partir à la découverte de lui-même. Les Rêveries apparaissent dès lors comme une invitation au voyage vers une introspection personnelle. Transposez "Rousseau" par "Marker" et "Rêveries" par "Sans soleil", et le tour est joué!
Notons au passage que, dans le même genre d’oeuvre littéraire, Marker aurait pu mentionner Théophile Gautier et son Arria Marcella (1852), ou encore Wilhelm Jensen et sa Gradiva (1903) qui marqua profondément Freud et les Surréalistes.
Poursuivant notre visionnement de Sans soleil, Marker y fait référence à Claude Lévi-Strauss qui aurait nommé quelque part
"la poignance des choses", le secret japonais. Après de nombreuses recherches, nous n’avons rien trouvé sur la dite "poignance des choses" et son rapport à Lévi-Strauss qui daterait d’avant 1982. La notion n’apparaît, semble-t-il, qu’à partir de 1993, dans son ouvrage Regarder, écouter, lire. Par contre, il est un auteur français qui traite du sujet à travers 143 poèmes. Il s’agit de Jacques Roubaud, ami de Queneau et membre de l’Oulipo, qui publie Mono no aware - Le Sentiment des choses en 1970. On y apprend que l’autre traduction de l’expression japonaise "mono no aware" n’est autre que la "poignance des choses". Gérard Fouquet, dans son article "La notion d’art dans les arts martiaux", le mentionne en ces termes: "En second lieu, [la notion de ippon] est liée au rapport que les guerriers médiévaux établissaient avec la nature, exprimant dans leur poésie l’émotion que suscite le spectacle des phénomènes éphémères. Traduit par "le sentiment des choses" ou "la poignance des choses", ce rapport est associé à l’idée selon laquelle celui qui éprouve une émotion est impliqué, à l’instant où il l’éprouve, dans le même devenir que les choses qui causent son émotion"[20].
À quelques minutes de la fin de Sans soleil, Marker mentionne encore Henry de Montherlant (1895-1972) et son voeu: que le divorce soit un sacrement. Le "French writter" du commentaire anglais était opposé non pas tant au mariage qu’à ce qu’il représente dans la société: un gage de respectabilité et de moralité. Sur ce sujet, il écrivit entre autre un cycle intitulé "Les jeunes filles", composé de 4 romans: Les Jeunes filles (1936), Pitié pour les femmes (1936), Le Démon du bien (1937) et
Les Lépreuses (1939). Du troisième opus a été tiré une citation devenue célèbre: "Le mariage sans divorce, le mariage chrétien, est, pour l’homme une monstruosité. La contre-nature même. Le génie de l’homme est de se lasser par l’habitude: on veut qu’il reste fidèle à une femme qui, à chaque mois, perd un peu plus d’attrait", ou, en un mot, "de l’impermanence des choses" selon Chris Marker!
Références cinématographiques
Si Vertigo (1958) et Stalker (1979) sont les plus connues des références cinématographiques présentent dans Sans soleil (et sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici), Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (que Marker connaissait personnellement) est la première qui est mentionnée dans le commentaire du film. Tout comme Stalker de Tarkovski, Apocalypse Now est une oeuvre récente par rapport au nouveau projet de Marker, qui obtient même la Palme d’or au festival de Cannes en 1979. Donc, si on ajoute le Flash Gordon de Mike Hodges sorti fin 1980 et mentionné ci-dessus, on
s’aperçoit que Marker s’inspire de films contemporains et de ce fait, il inscrit Sans soleil dans une lignée précise, un sous-mainstream sur les mondes imaginaires, la folie, les rêves... Pour le reste, de quoi parle Apocalypse Now? De la guerre. De la guerre du Vietnam et, plus précisément, de l’horreur ultime, comme le titre l’indique (le titre canadien C’est l’apocalypse est plus éloquent peut-être). Quoi qu’il en soit, c’est aussi le slogan de ce monde sans loi dominé par le personnage de Marlon Brando, un monde où la vie ne vaut rien, du moins pas plus que la mort. Tout comme au Japon, au final, "la cloison qui sépare la vie de la mort (n’y) paraît pas aussi épaisse qu’à un Occidental". Et le fait que Marker cite dans le même passage les Khmers rouges, n’est pas anodin non plus. Le monde fantastique de Brando, au fin fond de la jungle, se trouve à la frontière du Cambodge. Dirigeants maoïstes du pays de 1975 à 1979, les Khmers rouges de Pol Pot ont pratiqué parmi les
pires horreurs que l’homme puisse imaginer. Ils torturaient et exécutaient tout ce qui vivait, hommes, femmes, enfants, bébés, vieillards de la pire manière qui soit, sans aucune justice. La fiction d’Apocalypse Now trouve alors simplement son écho dans la réalité politique d’un petit pays oublié du sud-est asiatique et ce, alors que Marker imagine son film Sans soleil.
Après 30 minutes de film, Marker mentionne Brigadoon, la comédie musicale de Vincente Minnelli sortie en 1954. L’histoire en est la suivante: deux Américains venus chasser en Écosse, découvrent un village frappé d’une malédiction: Brigadoon, qui n’apparaît qu’une fois par siècle, si bien que ses habitants vivent encore au XVIIIe siècle. Malgré tout, nos deux protagonistes se plaisent dans ce village. L’un d’eux, Tommy, tombe amoureux d’une habitante prénommée Fiona, qui lui rend son amour. Malheureusement, aucun habitant ne peut quitter le village sous peine que ce dernier ne disparaisse à jamais. Leur séjour touchant à sa fin, nos deux chasseurs retournent à New York, mais Tommy ne cesse de penser à Fiona,
si bien qu’il retourne sur les lieux de son bonheur perdu. Or, contrairement à la malédiction, le village réapparait et Tommy peut rejoindre sa bien-aimée Fiona avec laquelle il vivra pour l’éternité à Brigadoon. Faut-il plus d’explication pour savoir pourquoi Marker mentionne ce film dans Sans soleil?
Quelques images plus loin, la voix off parle d’une voix familière, "comme à la fin des Visiteurs du soir". Ce film de Marcel Carné, sorti en 1942, est un film fantastique qui se déroule en 1485. Afin de semer malheur et destruction sur Terre, Satan délègue deux de ses suppôts, Dominique et Gilles, auprès du baron Hugues. Dominique réussit sa mission auprès du baron et Renaud, son futur gendre, mais Gilles échoue en tombant amoureux de la fille du baron, Anne. Satan furieux, décide alors de prendre lui-même les choses en main. Accueilli par le baron, il fait en sorte que Gilles et Anne soient surpris ensemble. Gilles est alors roué de coups et jeté au cachot. Or, Satan est à son tour subjugué par la pureté d’Anne. Il utilise tous les stratagèmes à sa disposition pour la conquérir et pour qu’elle oublie Gilles. Malgré toutes les tentatives du Diable, Anne ne peut cesser d’aimer le prisonnier dont elle entend continuellement la voix qui l’appelle du fin fond du château.
Le dernier film mentionné n’est autre que l’Arsène Lupin (Hachi ichi san) de Kenji Mizoguchi, réalise en 1923. Si Marker y fait allusion, c’est parce que ce film muet, bien que connu, n’est plus visible depuis longtemps, à la suite d’un incendie. À première vue, il n’en reste que quelques très rares photos. C’est d’ailleurs le lot des 47 autres films que Mizoguchi a tournés pour la compagnie Nikkatsu, entre 1922 et 1931. Des fantômes…
Références culturelles japonaises
Le champion de sumo Chiyonofuji Mitsugu (1955-2016) est considéré comme un des plus grands lutteurs de l’Après-Guerre. Il est le premier lutteur de sumo à avoir atteint le seuil des milles victoires. Il était le champion incontesté dans les années 1980 et ce, malgré un petit gabarit (1m83 pour 127 kg). Pouvait-il cependant réellement rivaliser avec Michel
Platini?
On ne sait pas grand-chose de Natsume Masako (1957-1985) dont Marker vénère "la beauté absolue". Elle débute à la télévision dans des séries, puis s’adonne également au cinéma. Sa filmographie n’est pas très étendue, mais elle commence à être célèbre fin 1970-début 1980. Elle décède d’une leucémie à l’âge de 27 ans. On ignore pourquoi Marker la
mentionne dans Sans soleil. Une recherche reste à faire.
Le Daruma, esprit porte chance, est le nom japonais de Bodhidharma, par dérivation phonétique. Dans Sans soleil, Marker explique seulement que le politicien vainqueur dessine l’oeil blanc restant de son Daruma. L’idée est beaucoup plus complexe et métaphysique, dans un sens, on pourrait dire typiquement japonaise. En effet, dans cette culture, le Daruma vise à réaliser des voeux, à porter chance et prospérité. Le rituel qui lui est associé est assez simple en lui-même. On achète un Daruma dans un temple. Puis de retour chez soi, on dessine un des deux yeux tout en prodiguant son voeu. Après quoi, on dépose le Daruma dans un endroit de la maison, bien mis en évidence, afin de se souvenir du voeu, mais surtout
pour rappeler que c’est "un appel à l’action et non une attente de réalisation divine: le Daruma ne réalise pas directement le voeu mais est un moyen pour l’homme de réaliser son voeu par lui-même". C’est un peu le "Aide toi toi-même et le Ciel t’aidera" occidental. "Si le souhait se réalise, on dessine alors la seconde pupille et on écrit la façon dont le voeu s’est réalisé. Ceci a, au-delà des superstitions, l’avantage d’apporter une réflexion sur la façon d’accomplir ce qui est désiré"[21].
Dans sa réponse à des cinéphiles américains, à la fin des années 1990, Marker confirme que Sandor et Michel Krasna, Hayao Yamaneko et Dolores Walfish, sont tous des alias de lui-même. La question qui se pose avec "Koichi Samura" c’est: n’en aurait-il pas oublié un? En effet, le seul personnage de ce nom que nous ayons trouvé sur le Web est mentionné par un site russe, qui le rattache à une importante entreprise de coutellerie japonaise du nom de Samura. Toutes les autres mentions sont directement liées à la citation de Marker dans Sans soleil, les gens n’ayant même pas pris la peine de trouver la source de ce texte, ne serait-ce que pour découvrir l’oeuvre de Koichi Samura qui les fascine tant. C’est exactement le même cas de figure que pour Dolores Walfish. De là à dire qu’on a un nouvel alias, il n’y a qu’un pas.
Les Burakamin désignent une minorité au Japon, divisée en deux groupes: les Eta ("pleins de souillures") et les Hinin ("non humains"). Constitués à l’époque féodale, ces derniers "désignaient les marginaux tels les gens du spectacle, les saltimbanques, les condamnés et les pauvres, réduits à mendier et à occuper des emplois "sales": s’occuper des prisonniers
ou devenir bourreaux, croque-morts ou espions. Les Eta étaient eux des parias héréditaires, en cela similaires aux intouchables indiens, qui avaient le monopole des métiers liés au sang et à la mort des animaux: équarrisseur, boucher, tanneur, abatteur d’animaux". On estime leur population à environ 2,5 millions au Japon. "Certaines personnes issues de cette minorité tentent d’effacer les traces de ces origines, et de s’intégrer à la société normale (passing). Cette stratégie est souvent mise en échec par l’existence des annuaires (chimei sokan), officiellement interdits, qui recensent les personnes issues de cette minorité". À noter que "selon Mitsuhiro Suganuma, un ancien membre de la Public Security Intelligence Agency, 60% de l’ensemble des yakuzas (la mafia japonaise) sont des burakamin "[22]. Si Marker cite cette communauté, c’est parce que bien qu’existant, les Japonais ne les voient pas, refusent de leur accorder une réalité physique. C’est un des points extrêmes dans Sans soleil: exister physiquement mais être inexistant par le seul pouvoir, la seule volonté de l’esprit. C’est l’inverse du rêve. En leur offrant à boire au début du film, Marker, plus que son désaccord avec cette vision des choses (qu’il juge à n’en pas douter comme une injustice), veut exprimer le fait que l’on soit vivant, mort-vivant ou vivant mort, réel ou imaginaire, on est tous dans le même bateau, voguant au final vers le même horizon. C’est ce qu’il exprime par l’expression "l’égalité du regard".
Le dernier élément culturel japonais que nous relèverons n’est autre que la lettre du kamikaze Ryoji Uehara (et non Uebara comme on le trouve dans le commentaire). Écrite à ses parents la veille de sa mission mortelle du 11 mai 1945, elle a été publiée après la guerre et est considérée aujourd’hui encore, comme une oeuvre majeure de la littérature japonaise du temps de guerre. En février 2014, le Japon souhaitait d’ailleurs la voir inscrite, avec celles d’autres kamikazes, au patrimoine
de l’Unesco[23]. Notons que la transcription proposée par Marker est une adaptation "libre", en particulier parce que la lettre de Uehara est écrite à la première personne. On peut trouver une version en anglais sur le site Wikipédia[24]. Et fait étonnant par rapport au sujet de Sans soleil, Marker passe complètement sous silence un passage, marqué par les « … » après le mot "passions", qui pourtant fait écho à la quasi-totalité des références qu’il cite. " Quand la femme que j’aimais tant est morte, je suis mort, émotionnellement, avec elle. L’idée qu’elle m’attend au Paradis, où nous serons réunis, fait que la mort n’est pas particulièrement effrayante pour moi, puisqu’elle survient sur le chemin qui me mène au Ciel."
Notes
[20] https://www.persee.fr/docAsPDF/insep_1241-0691_2005_num_36_1_1884.pdf: article publié en 2005 dans Les cahiers de l’INSEP, numero 36.
[21] https://fr.wikipedia.org/wiki/Daruma
[22] https://fr.wikipedia.org/wiki/Burakumin
[23] https://www.lefigaro.fr/international/2014/02/27/01003-20140227ARTFIG00335-le-japon-veut-faire-entrer-des-lettres-de-kamikazes-a-lunesco.php
[24] https://en.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%8Dji_Uehara
"La réception critique"
(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020, p. 145-152)
Dès la sortie de Sans soleil, la critique est favorable et ce, malgré le fait que le film soit complexe et dégage une impression de fouillis, de melting-pot savant. C’est peut être Annie Coppermann, des Échos, qui décrit le mieux la situation: "Un film très riche, trop, dont on sort un peu assommé, on n’en retient d’abord qu’un regard, celui d’une jeune
Africaine, ou d’une Japonaise en imperméable priant pour son chat, mais on y repense ensuite, et souvent, tout étonné, malgré l’éclectisme confus de ce patchwork qui inclut même la technique vidéo, avec ses déformations d’images longuement, trop longuement exploitées, de se sentir un peu plus intelligent, un peu plus informé, un peu plus concerné". Et de poursuivre "alors pourquoi Sans soleil n’est-il visible que dans un seul tout petit cinéma, même avec deux salles?"[25]. Ce qui nous pousse à nous rappeler, si besoin était, que malgré sa qualité indéniable, le documentaire de Chris Marker est tout sauf un blockbuster, un film grand public.
Quoi qu’il en soit, preuve de cette bonne réception, Sans soleil obtient trois récompenses, l’année de sa sortie, dans des festivals de renom:
• Grand Prix au Festival du peuple de Florence[26]
• Prix Sutherland au Festival du film de Londres[27]
• Prix de la critique internationale au même festival
Seconde preuve: l’abondance des critiques dans les périodiques et plus tard, des études scientifiques (dont des thèses de doctorat). Tous types confondus, on en dénombre plus de 120 aujourd’hui, mais un grand nombre reste encore à découvrir. Elles sont écrites aussi bien en français qu’en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais...
Dans le cas de Sans soleil de Chris Marker, les critiques journalistiques parues sont très similaires les unes aux autres. Considérant que Marker a déjà une carrière cinématographique artistique d’une trentaine d’années, les critiques comparent généralement ce nouvel opus avec les précédents et de ce fait, elles n’hésitent pas à reprendre les mêmes
généralités:
• Le mode "poétique" typique de Marker, ou son "style", à savoir la richesse de sa culture, son érudition atypique, et surtout la qualité incomparable de son écriture. Celle-ci est tantôt saluée, tantôt dénigrée au profit des images. Pour Michel Perez, du Matin, "Marker a beau saluer l’avènement de l’image électronique (…), il n’en demeure pas moins fidèle au pouvoir des mots, dont il sait jouer comme personne (…). Il est vrai qu’on a parfois envie d’arrêter l’image, en cours de projection, non pas tant pour le plaisir de la regarder aussi longtemps que l’on veut, mais pour celui de retenir les mots qui l’accompagnent, de se repaître de l’idée qu’ils transmettent"[28]. Pour Didier Goldschmidt, du Cinématographe, au contraire, "on ne peut s’empêcher d’éprouver un certain agacement à l’écoute de ce verbe trop bien fait, énoncé de manière si sûre, si indifférente et flegmatique, pharisienne et parisienne. (…) Le plan très court et granuleux de trois enfants surgissant au coeur du long noir d’ouverture est à la fois plus efficace et plus pénétrant que bien des propos élaborés; sous la graisse des mots, la limpidité des images n’en jaillit que plus évidente. (…) On eût souhaité néanmoins que le discours subisse la même éclipse"[29].
• Le mode narratif épistolaire, autre marque de fabrique de Marker, qui pourrait, comme l’a écrit ironiquement, en d’autres temps, François Weyergans des Cahiers du cinéma, intituler ses films "Chris à Pékin, Chris en Sibérie, Chris en Giralducie, Chris en Corée, Chris en Israël…"[30]. Michel Bouju, des Nouvelles littéraires, lui, commence sa critique de Sans soleil en ces termes: "On ne s’en lasse pas: Chris Marker continue de nous envoyer des lettres du Marker-land"[31].
• Les fautes malignes, fruit du plaisir jubilatoire de Chris Marker de donner des informations trompeuses, que ce soit de personnes ou de faits. C’est le cas, par exemple, dans Sans soleil des collaborateurs Michel et Sandor Krasna ou d’Hayao Yamaneko, alias de l’auteur que certains critiques ont pris pour de vraies personnes, qu’ils disent avoir même connues et rencontrées dans un festival ou autre. Ce qui bien sûr amuse grandement Marker. Mais d’autres, comme un certain F. F. de L’Express, vont plus loin et doutent de tout. Ce dernier débute son article par: "Sans soleil, à priori, est une pièce de musique que Moussorgski composa en 1874, entre Boris Godounov et Où es-tu, petite étoile? Le détail vaut la peine d’être vérifié, car le film de Chris Marker (qui porte le même titre) ressemble fort aux mensonges ingénieux que Borges invente pour mieux égarer le lecteur". Et le critique de conclure: "Sans soleil, qui est chef-d’oeuvre d’ironie et d’écriture, est aussi un souk où on trouverait tout. Sauf Moussorgski"[32].
Autre comparaison, avec un réalisateur, cette fois. Ayant beaucoup collaboré avec François Reichenbach, la critique voit en la sortie de Sans soleil de Chris Marker l’occasion de le comparer avec le dernier documentaire de Reichenbach sur le Japon, sorti quelques semaines auparavant, au titre évocateur: Le Japon de François Reichenbach (1982), parfois mentionné sous le titre Le Japon insolite en souvenir de L’Amérique insolite (1960) du même homme, dont Marker écrivit le commentaire. Quel qu’en soit l’auteur, la critique est toujours en faveur de Marker. Michel Mardore, du Nouvel observateur, a même intitulé son article "L’anti-Reichenbach, Sans soleil de Chris Marker". Pour lui, "l’un et l’autre se gargarisent de l’équivalent nippon de nos fêtes à Neu-Neu, avec défilés de bêtassons déguisés et d’orchestres folklos. Seulement, Reichenbach avait laissé à un indigène réac et pontifiant le soin de coiffer son dépliant touristique en répétant sur tous les tons : "Nous z’autres, Japonais, sommes incompréhensibles". Chris Marker part d’une conviction inverse. Pour lui, tout est compréhensible. Ou alors rien au monde n’est compréhensible, ce qui revient au même. [La vision de Marker] donne une impression de vivacité d’esprit, d’intelligence, dont on commençait à perdre l’habitude"[33].
Pour ce qui est des thèmes, la quarantaine de critiques journalistiques à notre disposition traite à peu près toutes des mêmes:
• La Mémoire est le premier d’entre eux et le plus souvent mentionné par les critiques (et les thésards), pour la simple et bonne raison que le mot lui-même apparaît 26 fois dans le commentaire du film, de même que "souvenir" (substantif et verbe conjugué confondus) apparaît 17 fois. Et certaines phrases sur ces mots très proches sont tellement fortes et précises qu’il est difficile de passer outre. Elles captent irrémédiablement l’attention du spectateur. Aussi, Joshka Schidlow, de Télérama, écrivit: "Sans soleil n’est pas seulement une méditation sur le politique, c’est aussi, c’est peut-être surtout une méditation sur la mémoire. Cette mémoire qui transforme, atténue ou magnifie le souvenir. Tel ce plan subjectif, image de la mémoire, qu’on retrouve en ouverture et en clôture du film, de trois enfants éclatants de blondeur qui semblent gaiement cheminer dans le soleil éperdu de l’été islandais. Chris Marker rêve que la réalité ait cette douceur"[34].
• L’image est le deuxième, non seulement à cause du travail de Hayao Yamaneko qui parsème Sans soleil, mais aussi parce que certains voient dans le film l’annonce de la mort du cinéma au profit de la télévision ou du moins, la mise en avant de la rivalité dangereuse entre cinéma et vidéo. C’est le cas de Gérard Lefort, de Libération, qui écrit: "Si la mémoire collective a un sens aujourd’hui, elle passe fatalement par la télévision, un déluge d’images ininterrompues contre lequel la parcimonie du cinéma n’a plus aucune chance. (…) Sans soleil est entre deux régions d’images: le cinéma qui s’en va et la vidéo qui bouffe tout"[35].
• La représentation du réel et le rêve ne sont pas en reste. "Où est la réalité, où est la fiction? Partout et nulle part car toute image enregistrée est déjà un souvenir et l’histoire, dans ce film, est une suite des jeux de la mémoire individuelle ou collective. (…) Sans soleil parle d’un monde, parle à un monde qui fait encore semblant d’exister. La méditation sur le souvenir conduit à la mort. (…) Quoi qu’il en soit, le film de Marker met en état d’hypnose, un état dont, pour un peu, on aimerait ne pas se réveiller" écrit Jacques Siclier, dans Le Monde[36].
• La "lutte" des classes ou autre, n’est pas en reste. Ainsi Ignacio Ramonet écrit-il dans Le Monde diplomatique: "Sans soleil, nous dit simplement, suavement, que les luttes continuent, l’héroïsme en moins, et que l’exaltation gauchiste d’hier mène à de paradoxales attitudes présentement. (…) Sans soleil n’est point, malgré son titre, une oeuvre nocturne. Avec une grâce bien rare, une aérienne émotion (…), Chris Marker a filmé ces ténèbres de la raison qui conduisent un monde à imploser de ses outrances et un autre, à exploser de ses privations"[37].
Ce sont là les principaux thèmes. On laissera aux plus curieux le soin de découvrir les autres en parcourant les dites critiques cinématographiques, à l’exception d’un seul groupe: les critiques négatives. Elles sont rares, mais elles existent, et comme d’habitude, la plus dure émane des Cahiers du cinéma, car les Cahiers du cinéma n’aimaient pas Marker, pas plus que son oeuvre. Dès le départ, même si Marker a collaboré aux Cahiers au tout début de sa carrière, ces derniers trouvent le cinéaste surfait et prétentieux. Il faudra attendre la toute fin du XXe siècle pour que leur opinion commence à opérer un changement. Pour Sans soleil, c’est un certain Yann Lardeau qui s’y colle. En lisant sa critique, on se pose la question: a-t-on bien vu le même film? Ainsi il parle d’un "enfant de Guinée-Bissau à la jambe déchiquetée par une explosion", ou encore
d’une "éruption volcanique survenue l’année suivante [de la prise de vue des 3 enfants en Islande], filmée par Haroun Tazieff, et cause déjà du séjour du cameraman en Islande"[38]. Ce qui nous fait dire que par ce seul article, Yann Lardeau montre la parfaite véracité des dire de Marker dans Sans soleil: "on ne se souvient pas, on réécrit la mémoire comme on réécrit l’Histoire!". Et si l’on considère l’énumération des scènes proposées par l’auteur des deux pôles extrêmes de la survie que sont le Japon et le Cap-Vert/Guinée-Bissau, on comprend très bien que Yann Lardeau n’a rien compris au film. À le lire, on comprend qu’il n’apprécie guère Marker qu’il considère vaguement comme un communiste d’outre-tombe, entiché de vieilles thèses stalinienne dont il "ne s’est jamais départi et qui est le fond constant, invarié de son cinéma, avant, pendant et après 68". Et donc dans sa critique, il ne mâche pas ses mots et parlant de la fameuse scène du regard de la femme capverdienne, dont la version traitée par Hayao Yamaneko clôture le film, il écrit: "En réalité cette scène est beaucoup moins bien que je ne l’ai dit, et ce bonheur volé frustrant finalement: Chris Marker a eu la maladresse de tout nous dire avant, de tout nous enrober dans un commentaire qui, à force de nous prévenir, de nous prendre en charge et de nous expliquer le comment et le pourquoi, tarit complètement la source de telles émotions, les images. Cet échec de la
dernière image, celle qui en fin de compte justifie toute l’entreprise du film, est l’échec même du film". Il poursuit, après une longue diatribe des plus discutables, par: "la vérité, c’est que Marker est un impénitent bavard. (…) Chaque fois qu’il pointe son museau et qu’il faudrait au cinéaste prendre son temps, se laisser aller, s’aligner sur la lenteur, la répétition, voire le statisme de ces rites, de ces cérémonies, il a pour réaction de le barrer, de le combler, de s’en protéger comme de sa propre bêtise, d’en justifier l’apparition par une rhétorique visuelle et quelques formules savantes, la nécessité par quelque raison supérieure. Toutes ces citations et cautions culturelles, ce besoin compulsif d’interprétation chargent l’image et la vident de sa liberté, lui dénient sa vitalité, l’intensité propre de son rien de contenu. À l’arrivée, il ne subsiste rien du fait brut et des affects qui lui sont attachés. La rencontre tant annoncée, tant espérée, trop sans doute, n’a pas eu lieu. Se succèdent alors des images de rituels montées à la diable, dans une composition fluide certes, mais qui n’évite pas l’écueil des effets de coupe et des analogies faciles, alors qu’un rituel, une cérémonie sont d’abord des scansions du temps". On ne peut pas plaire à tout le monde!
Notes
[25] Annie COPPERMANN, "Sans soleil", Les échos, n° 13'833, 09 mars 1983.
[26] Le Festival dei popoli de Florence a été fondé en 1959. Sans soleil obtint le Premier prix, ex-aequo avec Budapest de Miklos Jancso et First Contact de Robin Anderson et Bob Connolly. Notons que Pierre Kast était membre du jury. http://www.festivaldeipopoli.org/24-festival-dei-popoli/?lang=en
[27] Le Festival du film de Londres (connu sous le nom de London Film Festival (LFF) ou BFI London Film Festival), fondé en 1956, est le plus grand festival cinématographique britannique. "Depuis 1958, le Sutherland Award est remis au "réalisateur du film le plus original et imaginatif (premier ou deuxième long métrage) présenté au National Film Theatre dans l’année.""
https://www.bfi.org.uk/newsopinion/news-bfi/features/lff-62-history-london-film-festival-awards-competition
[28] Michel PEREZ, "Sans soleil de Chris Marker. La goutte d’eau dans le flot du temps", Le matin, 09 mars 1983.
[29] Didier GOLDSCHMIDT, "Sans soleil de Chris Marker", Cinématographe, n° 87, mars 1983, p. 39.
[30] François WEYERGANS, "Chris en Israël", Cahiers du cinéma, n° 115, janvier 1961, p. 40.
[31] Michel BOUJUT, "Sans soleil de Chris Marker", Les nouvelles littéraires, 03 mars 1983.
[32] F. F., "Chris Marker: le grand jeu de l’imaginaire", L’express, n° 1 653, 11 mars 1983, p. 22.
[33] Michel MARDORE, "L’Anti-Reichenbach. Sans soleil de Chris Marker", Le nouvel observateur, n° 956, 04 mars 1983.
[34] Joshka SCHIDLOW, "Sans soleil. L’histoire se bouche la mémoire", Télérama, n° 1 729, 02 ou 05 ? mars 1983, p. 25-26.
[35] Gérard LEFORT, "L’archipel Marker fait chaud", Libération, 04 mars 1983.
[36] Jacques SICLIER, "La voix qui parle au monde", Le monde, 05 mars 1983.
[37] I. R., "Sans soleil, un film de Chris Marker", Le monde du dimanche, 04 avril 1983.
[38] Yann LARDEAU, "L’empire des mots", Cahiers du cinéma, n° 345, mars 1983, p. 60-61. Note: ce genre de critique n'est pas qu'ancienne. À la sortie de ce coffret DVD - Blu ray, les critiques ont été dans l'ensemble excellentes, à l'exception d'une seule parue dans le n° 722, d'avril 2021, de la revue Positif, pourtant respectable et grande amatrice de l'oeuvre de Marker depuis ses débuts. L'idée clairement annoncé dans l'édito de Michel Ciment était de lancer une polémique, mais tout est tombé à plat, tant Pascal Binétruy et son "eschatologie exténuée" atteignaient un niveau de vacuité et d'inepties à la mode Trump que, malgré les "pressions", nous avons refusé d'y répondre. Quand on parle d'un film, il faut le voir ou le revoir et ne pas se contenter de ses souvenirs lointains et obscurs, très obscur dans le cas du critique précité. Quand on critique un texte, il faut le lire, le relire et le relire encore. Cela évite d'écrire des idioties et de faire dire à l'auteur(e) des choses qu'il n'a pas dites. Mais au final, la liberté d'expression étant le plus important, Pascal Binétruy peut livrer sa pensée à tout un chacun. Et tout un chacun est libre de la suivre ou de l'ignorer!
Chris Marker, l'art du bricolage numérique (2018)
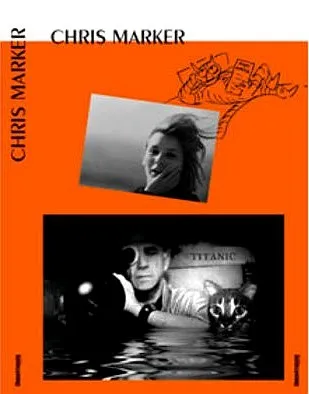
À l'occasion de la rétrospective présentée par la Cinémathèque française, du 2 mai au 29 juillet 2018, nous avons eu l'opportunité de participer à la rédaction du catalogue à travers un article imposé.
"L'art du bricolage numérique"
(Christine van Assche / Raymond Bellour / Jean-Michel Frodon (dir.), Chris Marker (cat. expo du 2 mai au 29 juillet 2018, Cinémathèque française), Paris: Cinémathèque française, 2018, p. 372-375)
À la fin des années 1970, Chris Marker, fidèle à lui-même, toujours à l’affût des innovations technologiques, se prend de passion pour l’informatique alors balbutiante. Outre la programmation, son principal intérêt se porte sur la retouche numérique de l’image qui dès lors parsèmera toute son œuvre, présente ou à venir, tout autant que passée. C’est dans Sans soleil (1982) qu’il s’explique à ce sujet par l’intermédiaire de l’un de ses alias: "Mon ami Hayao Yamaneko a trouvé une solution: si les images du présent ne changent pas, changer les images du passé... Il m’a montré les bagarres des Sixties traitées par son synthétiseur. Des images moins menteuses, dit-il avec la conviction des fanatiques, que celles que tu vois à la télévision. Au moins elles se donnent pour ce qu’elles sont, des images, pas la forme transportable et compacte d’une réalité déjà inaccessible. Hayao appellele monde de sa machine: la Zone – en hommage à Tarkovski"1. Cette vision est essentielle car elle marque l’intégralité des réalisations à venir, en particulier celles liées au monde de l’Internet.
Dès la fin des années 1990, l’Internet se développe, en particulier le World Wide Web. Il servira dès lors non seulement de source à Marker, mais également de diffuseur. L’artiste le sillonnera de long en large et en travers. Non seulement il y puisera les documents dont il a besoin (en particulier des images), des informations de toutes sortes (en plus des chaînes télévisées qu’il suit sur deux ou trois postes simultanément2), mais, plus encore, il y trouvera le moyen de s’affranchir temporairement du réel avec un nouveau monde virtuel: Second Life. C’est dans le cadre d’un projet d’exposition, "A Farewell to Movies/Abschied von Kino" au Museum für Gestaltung de Zurich, au printemps 2008, que se développe l’Ouvroir (référence directe au groupe OuLiPo). Grâce à l’aide de complices autrichiens, dont Max Moswitzer, prend forme un espace évolutif comprenant un musée dédié à l’œuvre de Marker, une copie conforme du bar La Jetée du quartier de Shinjuku, à Tokyo, une salle de projection et d’autres éléments construits au gré du temps. Mais Marker ne se contente pas de ce microcosme, il s’évade sur Second Life sous le nom de Sergei Murasaki, alors que son compère Guillaume-en-Égypte, également sur ladite plateforme, bien plus qu’un alias, lui survit encore aujourd’hui.
Contrairement à ce qui est couramment fait, il ne faut pas dissocier les œuvres cinématographiques des séries photographiques, des installations ou encore des collages de Chris Marker. L’œuvre est un tout homogène et complexe. Mais après Chats perchés en 2004, l’artiste se détournera cependant du monde cinématographique, ayant atteint un but ultime comme il le confirmera au binôme de journalistes des Inrocks en avril 2008. À la question d’Iggy Atlas: "Les nouvelles technologies ont-elles modifié en quelque chose votre rapport aux images, aux sons, ce que vous en faites?", Sergei Murasaki répond: "Forcément. Pouvoir faire tout un film, Chats perchés, avec mes dix doigts, sans aucun appui ni intervention extérieurs... Et ensuite aller vendre moi-même le DVD que j’ai enregistré à la braderie de Saint-Blaise... Là, j’avoue que j’ai eu un sentiment de triomphe: du producteur au consommateur, direct. Pas de plus-value. J’avais accompli le rêve de Marx3"... et le sien par la même occasion.
Dès lors, Marker se tourne essentiellement vers la photographie. Il produit plusieurs grandes séries – Staring Back (2007), Quelle heure est-elle? (2009), Passengers (2011) – et s’amuse à les mettre partiellement en ligne sur le Web, sur des plateformes grand public mondialement connues. Ainsi sur Flickr, sous le pseudonyme de Sandor Krasna, apparaissent, dès mars 2005, quatre-vingt-trois photographies prises lors de manifestations parisiennes. On les retrouvera dès l’été 2007, dans la revue américaine Artforum (n° 44/10), avant qu’elles ne soient exposées au Wexner Center for the Arts de Columbus (Ohio), puis finalement dans l’exposition "Staring Back" (2007), elle-même éditée sous forme de livre. De manière fort amusante et dans la plus pure tradition markérienne, sur Flickr l’artiste se décrit comme originaire de Kolozsvár (ville au Nord-Ouest de la Roumanie), étant un homme célibataire, résidant actuellement à Berkeley (États-Unis) et ayant pour profession le métier de cameraman!4
On notera que toutes ces photographies, de même que les plus anciennes rééditées par la galerie Peter Blum de New York ou par d’autres5, sont systématiquement retouchées par l’entremise de logiciels, dans l’esprit d’Hayao Yamaneko. La photographie perd son statut historicisant pour devenir simple œuvre d’art et ne valoir que pour elle-même. Elles n’en restent pas moins, bien souvent, encore politiques.
Avant de réaliser la série Passengers, photographies en couleur de passagères du métro parisien prises au moyen d’appareils photographiques ou de caméras espions, Marker réalisa une autre série de photographies, en noir et blanc cette fois-ci, qu’il ne met pas sur Flickr, mais sous forme de court métrage sur YouTube: Metrotopia (2008). En effet, sur cette plateforme, il crée dès juin 2006 une chaîne sous le pseudonyme de Kosinki (et non Kosinski comme trop souvent on le lit)6. Pas moins de dix "courts métrages" se succéderont. Si Leila Attacks (2006) et Kino (2011) sont de petits films assez traditionnels, et Imagine (2011) un ovni visuel, les sept autres consistent en des sortes de "photoramas" réalisés à partir de photographies compilées sur le Web (Overnight, Tempo risoluto, 2011), de unes de journaux – The Morning After (2008), iDead (2011), Royal Polka (2011) –, de photomontages, les fameux X-plugs que l’on trouve initialement sur l’Ouvroir (Pictures at an Exhibition, 2008) ou de dessins de Marker (Guillaume Movie, 2008). Mais le plus étonnant, c’est la motivation de Marker que nous dévoile Agnès de Cayeux7. Outre le suivi immédiat de l’actualité (iDead est conçu à la suite de la mort de Steve Jobs, The Morning After après l’élection de Barack Obama, Royal Polka après le mariage de Kate et William), ces courts métrages permettent à Marker de jouer avec des logiciels découverts de-ci de-là. Ainsi, le shareware PulpMotion a permis de réaliser Pictures at an Exhibition, de la même manière que Marker s’essaie à Animoto, disponible sur le Web8, ou à iMovie.
Par ailleurs, l’artiste, tout comme il l’était avec les journaux et les télévisions9, est alors actif sur certains médias numériques, sous le nom de Chris Marker ou sous celui de son compère Guillaume-en-Égypte. Les deux plus importantes collaborations se font avec la revue poptronics.fr (collaboration qui prendra fin en 2010)10 et avec unregardmoderne.com du collectif punk parisien Bazooka. Une exposition au Brésil sera même consacrée audit Guillaume-en-Égypte, avec l’édition d’une interview et de nombreux montages-collages de Marker en 200911. Dans le même ordre d’idées, Marker n’hésitait pas à transmettre les informations qui lui plaisaient ou qu’il jugeait utiles à Daniel L. Potter, créateur et animateur du site reconnu dès lors comme officiel: chrismarker.org.
Mais le dernier projet web ou numérique le plus important pour Marker est la mise en place de son site Gorgomancy.net entre 2007 et 2013. Dans l’idée, Gorgomancy a été conçu comme un site "infini" qui devait se poursuivre bien après sa mort, un "testament". Chris Marker souhaitait y intégrer, outre son autobiographie multimédia Immemory (1997), ses films alors non distribués: La solitude du chanteur de fond (1974), Mémoires pour Simone (1986), L’héritage de la chouette (1989), Manifestation du 1er mars et Manifestation du 1er Mai (2009, reprise des images Flickr sous forme de "photoramas"), etc., ainsi que plusieurs œuvres d’autres artistes dans l’esprit de la programmation de la rétrospective "Marker mémoire" proposée à la Cinémathèque française en 1998, la seule rétrospective à laquelle il ait accepté de participer activement. Il en expliqua alors le concept en ces termes: "S’exposer à une rétrospective (même si le mot n’est écrit nulle part) de son vivant n’est pardonnable que si l’on profite de cette limousine qui vous est prêtée pour faire monter quelques auto-stoppeurs. Et il n’est pas illogique de faire figurer dans cette espèce d’autoportrait que trace à grandes lignes, willy nilly, une sélection de vos films, ceux des autres qui vous ont marqués, nourris, stimulés. Ils font partie de vous, ils disent quelquefois plus sur vous que vous-même"12. Dans le cas de Gorgomancy, les œuvres jointes sont celles de Guillaume-en-Égypte, à travers les résidus poptronics, et de son grand ami M. Chat, et quelques ersatz de dernière minute: Isaac Julien, Territories (1984); Liu Wei, A day to remember (2005) et Floating memory (2005); Manu Luksch, Faceless (2007); anonyme, Fragments d’une révolution (2009); Till Roeskens, Aida. Palestine (2009); Indira Solovieva, L’amnésie infantile (2009); école Saint-Jean-de-Braye, La récré (2009); ou encore un lien vers deux œuvres de Tim Hetherington en ligne sur Vimeo, à savoir Sleeping soldiers (2009) et Diary (2010). En effet, le temps par trop compté a empêché Marker de développer plus à plein ce projet. Quasiment oublié, celui-ci est pourtant un des plus importants de l’artiste car, comme le note Paola Soave à travers sa remarquable analyse, la seule que nous ayons d’ailleurs trouvée sur le sujet, "Gorgomancy n’est pas qu’une mémoire virtuelle, il se propose aussi d’être un instrument pour prévoir le futur. En effet, du grec gorgo qui signifie "terrible" et mantiké qui indique "l’art de la divination", Gorgomancy dénote la capacité de voir l’avenir à travers le monstrueux"13. Elle précise avec justesse que "l’on trouve à cet égard, dans la section poptronics du site Gorgomancy, la dernière contribution du chat pigiste – Chris Marker – du 1er janvier 2010. Il écrit: "Ma cervelle de chat n’arrive pas à faire tenir ensemble le constat d’échec qui s’appuie sur un calendrier inexorable, et les chances de salut dans une "gouvernance mondiale" qu’aucune utopie ne verrait arriver à temps du fait de ce même calendrier. L’humanité devra donc se passer de mes commentaires pour organiser son suicide et nous les animaux organiser notre survie"."
Pour être complet, il faut encore noter la présence de Marker sur Facebook ou des sites de musique électronique, sous le pseudo de Hayao Yamaneko14, sans pouvoir dire précisément s’il s’agit bien de l’artiste, d’un homonyme ou d’une tierce personne.
Quoi qu’il en soit, en conclusion, on peut dire que, dès la fin des années 1970, Marker se plonge corps et âme dans le monde numérique, utilisant chaque possible avec délectation pour créer, transmettre, dire ce qui lui semble important, nécessaire ou simplement amusant. L’ère numérique est dès lors partie prenante de son travail qui porte alors essentiellement sur l’Histoire passée, présente et future et la Mémoire, ou plutôt l’Immémoire, qui lui est connexe. Plus flexibles, plus libres, plus rapides, les nouveaux médiums sont une opportunité inouïe pour cet homme à la curiosité insatiable, capable en un instant de saisir les potentialités offertes et de les utiliser aux meilleures fins.
Christophe Chazalon / chrismarker.ch
1 Stalker d’Andreï Tarkovski, adapté du roman d’Arcadi et Boris Strougatski (1972), sort en 1979 et a un impact considérable et immédiat sur Marker et son œuvre.
2 À la question "Comment vous informez-vous de nos jours?", Marker répond: "Revue de presse internationale sur Internet, CNN et Al-Jazeera anglais, et ma chaîne favorite, la russe, RTR Planeta, et mes informateurs ici et là". Julien Gester et Serge Kaganski (alias Iggy Atlas), "La seconde vie de Chris Marker", Les Inrocks, 29 avril 2008 (www.lesinrocks.com/2008/04/29/cinema/la-seconde-vie-de-chris-marker-1151546/). Pour plus d’informations sur le rapport de Marker avec la télévision et Internet, voir l’interview accordée le 5 mars 2003 à Annick Rivoire et Samuel Douhaire, "Rare Marker", Libération, p. i-iv (next.liberation.fr/cinema/2003/03/05/rare-marker_457649).
3 Julien Gester et Serge Kaganski (alias Iggy Atlas), "La seconde vie de Chris Marker", op. cit.
4 www.flickr.com/photos/89096975@N00/
5 Tel l’ouvrage Coréennes paru en 1959, qui connaît une édition coréenne en 2008 intégralement retouchée, à l’image des clichés exposés par Peter Blum à partir des années 2000.
6 www.chrismarker.ch/chaine-de-kosinki-chris-marker.html
7 Agnès de Cayeux, "YouTube, la salle de cinéma de Chris Marker", Arte.tv, 17 octobre 2013 (creative.arte.tv/fr/episode/youtube-la-salle-de-cinema-de-chris-marker)
8 https ://animoto.com/
9 Marker avait pour habitude d’écrire aux journaux et aux télévisions pour leur signaler des erreurs de français ou de contenu.
10 www.poptronics.fr/2010-les-adieux-de-Guillaume-en
11 www.poptronics.fr/Guillaume-en-Égypte-au-Bresil
12 Chris Marker, "Chris Marker du 7 janvier au 1er février", Cinémathèque française. Musée du cinéma, janvier-février 1998, p. 4
13 paolasoave.com/gorgomancy-chris-marker/. On réécoutera aussi avec intérêt les propos de Jean-Pierre Vernant dans le huitième épisode de L’héritage de la Chouette, où il décrit le mythe de Gorgone avec précision et clarté, éclairant d’un nouveau regard Gorgomancy.
14 www.chrismarker.ch/la-musique-selon-chris-marker.html#i0k-mn6ge
Chris Marker, magicien du flou (2017)
"Chris Marker, magicien du flou"
in Chris Marker: pionnier et novateur / Cinémaction (sous la dir. de Kristian Feigelson), Paris, n° 165 (2017), p. 14-19
Il est habituel de reconnaître la grande diversité des médiums utilisés par Chris Marker dans son œuvre. Généralement approché en tant que cinéaste, on en oublie cependant trop souvent que l’image en mouvement n’est qu’un aperçu de son travail. Le texte tout autant que la photographie, voire la musique, sont en effet pour lui totalement indissociable du cinéma. Cette volonté d’effacer les limites des genres, des formats, des normes prend véritablement son plein essor avec l’apparition de l’informatique à la fin des années 1970 et surtout après la vision de Stalker de Tarkovski, sorti en salle en 1979. Dès lors Marker apparaît bien comme le magicien du flou par son amour inconditionnel de la Zone.
En quête de nouveauté...
Il y a donc bien une difficulté à appréhender l'œuvre de Chris Marker, à la morceler, à la compartimenter de manière rigide pour n’en prendre qu’un aspect particulier. Chris Marker est tout simplement inclassable et il a tout fait pour. Dès le départ, il écrit des textes (romans, poèmes, essais, commentaires de film, émissions de radio, etc.), mais n'hésite pas à préciser qu'il « aime la radio plus que la littérature, le cinéma plus que la radio, et la musique plus que tout »[1], tout en laissant le doute persister sur la véracité de cette proposition, considérant les inventions parsemant le reste du texte cité. Aussi, si Marker tarde à faire du cinéma, c'est essentiellement faute de moyens, comme le confirma Paul Paviot à l'occasion de Dimanche à Pékin (1952). L'écriture, elle, ne nécessite qu'une plume, un crayon ou un stylo et du papier. La photographie, de son côté, est accessible au grand public en ces années d'Après-Guerre. Marker opte alors pour le Rolleiflex et se plaît à prendre la pose avec. Il faudra attendre 1962 pour qu'un nouvel appareil le remplace. C'est encore le fruit d'un échange. Antoine Bonfanti, ingénieur du son attitré de longues années et ami de Marker, raconte : « pendant la postproduction du Joli mai, je passais souvent au montage, mais Chris refusait de me montrer les images. Un jour, en revenant d’un tournage au Cambodge, j’étais passé par Hong Kong où j’avais acheté le premier Pentax 24x36. Quand Chris a vu mon appareil, il était enthousiaste : il travaillait toujours au 6x6, donc il devait recadrer ses photos. Il me l’a emprunté et quatre mois plus tard, il est arrivé avec La Jetée. Il me demandait de passer le voir, j’arrivais à la salle de montage – clac !, il arrêtait la table pour que je ne voie rien, on parlait et j’allais faire des sons »[2].
Puis, moins de deux décennies plus tard, l'ère de l'analogique céde la place à l'ère du numérique. Dès le départ Marker s'engouffre dans la brèche et se prend de passion pour la programmation et le traitement de l'image. Aidé, suivi, soutenu par Paul Lafonta[3] ou François Helt[4], il bidouille à foison sur les premiers Apple. En 1978, apparaît un premier résultat de ce bidouillage : l'installation Quand le siècle a pris forme : guerre et révolution qui consiste en une projection multiple et simultanée d'images d'archives des années 1900-1930, retouchées sur un Spectron[5]. Dès lors les images électroniquement modifiées parsèment les films estampillés Marker mais plus encore, Marker définit sa notion de flou de l'image qui ne le quittera plus.
Dans cette même lignée numérique, Marker poursuit ses recherches sur le Web où il crée un monde virtuel sur Second Life, L'Ouvroir (2008), avec Max Moswitzer et le Museum für Gestaltung de Zurich[6]. Loin de s'arrêter là, il expérimente encore, à passés 90 ans, les caméras et appareils photos « espions ». Toujours en avance sur son temps, toujours à l'affût des nouveautés, Marker est alors le premier artiste à prendre possession de ces nouveaux instruments et réalise sa toute dernière œuvre photographique d'importance: Passengers/Passagers, une série de photographies « volées » des usagers du métro parisien, en couleur, qui sera présentée pour la première fois en avril 2011 à la Peter Blum Galery de New York, puis au festival de la photographie d’Arles dans le cadre d’une rétrospective sur son œuvre (1957-2011)[7].
Enfin, lorsque l'on s'intéresse aux « illustrations » créditées « Chris Marker »[8], on est non seulement étonné par leur diversité et leur ampleur, mais aussi par un nom qui revient à plusieurs reprises : Snark International[9]. De source variables mais véritables, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une société fondée par Chris Marker qui lui permit non seulement de distribuer ses photographies, mais encore d'avoir accès à un fond plus large d'images et de tisser de nouveaux liens[10]. Elle fait toutefois écho au travail d'archives et de mémoire de Marker, tel qu'on le trouve bien sûr dans son cédérom autobiographique Immemory (1997), mais auparavant dans son film Si j'avais quatre dromadaires (1966). Durant un peu moins de 50 minutes, Marker revient sur dix années de travail photographique (1955-1965) effectué dans pas moins de 26 pays. Marker « bidouilleur des temps à jamais perdu » s'offre une réflexion libre sur son œuvre et son occupation principale : « courir le monde et l'admirer ». Si j'avais quatre dromadaire consiste en une succession de photographies commentées par trois individus à travers un dialogue en deux mouvements totalement fictif, car rédigé intégralement par Marker. Marcos Marino a écrit très justement au sujet de ce film : « Au tout début de Si j'avais quatre dromadaire, on voit la photographie d'une sculpture ancienne, tandis que le photographe commente: "un sculpteur a éternisé un certain visage avec un certain regard." Mais il semble exister chez Marker une dimension encore plus profonde de la photographie : la capture, pas seulement d'un moment ponctuel, présent de la subjectivité, mais d'un futur virtuel caché dans l'image présente, qui va se développer dans une histoire subjective et collective. Ce n'est pas la photo comme souvenir, mais comme souvenir d'un avenir »[11], sorte de clin d'œil, au passage, au film sur la photographe Denise Bellon co-réalisé par Marker, en 2001, avec sa fille, la réalisatrice Yannick Bellon.
Du classicisme au flou artistique
La première œuvre photographique éditée et connue de Chris Marker n'est autre qu'un montage réalisé pour la couverture du numéro 3 de la revue de Peuple et Culture, parue en allemand sous le titre DOK, en 1950, avec la mention suivante : « Die Umschlamontage ist von Chris Marker ».
Dès le départ, Marker aime à modifier les images. Le photomontage - collage est un des aspects que l'on retrouvera à plusieurs reprises tout au long de sa carrière, en particulier pour des couvertures de livres, tel L'An 2000 (1975, Flammarion) ou dans l'installation Zapping Zone (1990-1994), ou encore pour la pièce d’Arman Gatti et Maurice Sarrazin, Chroniques d’une planète provisoire (1963)[12], ou pour le clip-image réalisé pour la chanson And you are there (2011) du groupe Damon & Naomi, pour ne citer que quelques exemples. Par la suite, le détournement d'images et plus particulièrement des œuvres d'art ou des affiches de film devient un jeu. Ainsi Marker a pour habitude d'envoyer aux différends cercles d'ami(e)s qu'il a soigneusement constitués des petites vignettes humoristiques ou fruits de l'humeur du moment. Une partie d'entre elles sera intégrée à une affiche éditée par le Pop'lab de la revue électronique Poptronics à l'occasion d'une exposition de Guillaume-en-Egypte au Brésil[13], en octobre 2009[14]. Pour les œuvres d'art revisitées, on en trouve une première trace dans les Xplugs [15] publiés depuis sur le cédérom Immemory, en 1997 (cf. Gorgomancy.net), ainsi que sur un site en ligne aujourd'hui inaccessible et enfin dans le musée virtuel de l'Ouvroir, sur Second Life.
Une autre modification apportée à la photographie apparaît dans la série Crush Art, exposée avec l'œuvre Quelle heure est-elle ? en 2009, à la Peter Blum Gallery de New York. Crush-Art consiste en une série de photographies de magazine représentant des portraits de femmes chiffonnés avant d'être scannés. Le résultat final obtenu est une série de portraits de fantômes froissés qui défie notre compréhension du temps et de la beauté. À côté de cela, Marker publie des ouvrages dans le plus pur classicisme (Le Dépays (1982), La Renfermé. La Corse (1981) de Marie Susini, dont les photographies de Marker ont servi en 1979 à produire des cartes postales), même s'il tente d'effacer les limites, les frontières des genres. Ainsi son premier travail de « reportage » connu, paru dans la revue Esprit en janvier 1956, s'intitule Clair de Chine. En guise de carte de vœux, un film de Chris Marker. Dans le même ordre d'idée, l'édition du commentaire du film La jetée (1962) en 1993 se voit attribuer le titre de La jetée. Ciné-roman [16]. Marker joue sur les mots et se joue des frontières traditionnelles. Ainsi La jetée, en plus d'être un film composé uniquement à partir de photographies (à l'exception d'une courte séquence) devient dès lors une sorte de « folioscope » à effeuiller par le pouce. À l’inverse les diaporamas publiés sur Youtube (The Morning after (2008), Tempo risoluto, Royal Polka, Overnight et iDead (2011)), sous l’alias de Kosinki, offrent, pour plusieurs d’entre eux, un défilé de unes de journaux ou de photographies trouvées sur internet et simplement juxtaposées.
Ce flou des frontières se retrouve dans les images elles-mêmes. Comme nous l'avons vu, la notion apparaît chez Marker avec l'avènement du numérique. Et c'est dans son chef-d'œuvre Sans soleil (1982) que l'artiste révèle sa pensée. "Mon ami Hayao Yamaneko a trouvé une solution: si les images du présent ne changent pas, changer les images du passé... Il m'a montré les bagarres des Sixties traitées par son synthétiseur. Des images moins menteuses, dit-il avec la conviction des fanatiques, que celles que tu vois à la télévision. Au moins elles se donnent pour ce qu'elles sont, des images, pas la forme transportable et compacte d'une réalité déjà inaccessible. Hayao appelle le monde de sa machine : la Zone - en hommage à Tarkovski".
Hayao Yamaneko n'est autre que Marker lui-même et cette pensée, il va l'appliquer méthodiquement jusqu'au bout. Ainsi, à l'occasion de la réédition des Coréennes (1959) en coréen parue en 2008, toutes les photographies sont retouchées et floutées par endroit, afin de mettre en évidence certaines parties et tromper l'œil, détourner le cerveau d'une interprétation trop rapide. L'image n'est plus un témoignage historique d'un moment précis de l'Histoire donné (Coréennes a été réalisés à l'occasion d'un voyage en Corée du Nord six ans après la Guerre de Corée[17]), mais redevient une image, un instantané (mi photographique – mi informatique) ou, au mieux, une représentation artistique et doit être prise comme telle, c'est du moins ce que Marker voudrait. Dans Passengers (2011), les photographies des usagers du métro parisien ont été méthodiquement, quoique peu soigneusement, retouchées grâce à un logiciel informatique, idem des photographies proposées par Marker dans Staring Back et son prémice The Revenge of the Eye (2007) ou sur le site Flickr (2006-2009), sous le pseudonyme de Sandor Krasna[18], que l’on trouve déjà dans le film Sans Soleil.
LA ZONE
On pourrait voir là une explication du refus de Marker de diffuser ses films d'avant 1962. Dans la droite lignée de l'auteur de L'Invention de Morel (1940), soit Adolfo Bioy Casares[19], Marker rejette en 1998 ses premiers travaux filmographiques non pas tant pour leur forte politisation, mais pour l'interprétation que les générations d'aujourd'hui et de demain en feront à coup sûr : une idée réductrice et sans véritable rapport avec l'œuvre originale. Marker sait alors très bien que la remise en contexte nécessaire à leur compréhension ne sera pas faite, du moins pas suffisamment pour saisir le sens et la volonté originelle. Autre preuve de cette assertion : la scène supprimée du jeune soldat engagé dans la guerre d'Algérie qui apparaît à l'origine dans le Joli mai (1962). L'autocensure, nous dit Marker, tient à ce que les jeunes d'aujourd'hui « ne peuvent pas comprendre ! ». Aussi, dès le début des années 1980, après le bilan amère du Fond de l'air est rouge (1977) sur le socialisme, Marker préfère se perdre dans la Zone d'Andreï Tarkovsky (Stalker (1979), référence qui devient incontournable et essentielle dans son œuvre, et tout particulièrement pour les images filmées ou photographiées. Sortir des clous, se départir des règles (comme également avec la durée des films de Marker qui ne respectent quasiment jamais les formats conventionnels du cinéma), transgresser la norme pour simplement exprimer son idée, sa vision, sa pensée et être libre, maître de son univers.
En guise de conclusion a ce trop bref aperçu d'un thème qui mériterait à lui seul une étude complète et fouillée, quoi de mieux que la citation d'un souvenir de femme que Marker affectionnaient tant. Au milieu des années 1950, Natacha Michel, alors adolescente, fait la connaissance de Chris Marker, qui habite dans le même immeuble et en tombe éperdument amoureuse. À défaut de raconter ses mémoires, elle a décidé de transposer l'histoire dans une fiction : Ici commence (1973). Sa description de Chris Marker, devenu Théodore, offre un regard juste et précis de son rapport à l’image.
"Théodore était un homme moderne. Il avait voulu être cinéaste, écrivain, pianiste, motocycliste, technicien, journaliste, non par dilettantisme, mais par morale. Car la modernité du monde, c'était qu'il était immense. L'immensité du monde - idée nouvelle en Europe - poussait à des tentations infinies. Le monde était si grand que le terme "mondial s'était substitué au mot "universel" qui en exprimait, jadis, la réalité. Le drame d'un jeune homme bien né, c'était d'être de son temps, la seule noblesse acceptable, la contemporanéité ; la difficulté, de savoir comment l'exprimer, puisqu'il n'existait plus, à cause de la multiplicité des choses, un seul canal, une forme unique. Et il pensait ainsi, non pas à cause de sa morale géographique, mais en vertu de la situation qui plaçait Paris et la France dans une province reculée de l'Histoire. L'actuel, selon lui, se passait toujours ailleurs. Et comme il fallait aligner les prétentions sur la réalité, après ses pérégrinations dans les métiers divers, il en revenait toujours à la photographie, parce qu'il faut commencer par se taire et que, seul, l'œil est organe du silence. Mais, en même temps qu'il se faisait modeste, il éclatait. C'était sa prise sur le monde qui éclatait : il y avait tant d'aspérités, de bouts par lesquels on pouvait le prendre. Il avait voulu être pianiste, motocycliste, technicien, journaliste, puis avait pesé l'activité centrale, celle de voir, en mettant sur l'autre plateau de la balance, tantôt le cinéma, tantôt la peinture, tantôt la photographie. Mais seule la photo, avec son mutisme, avait établi l'équilibre. Avec la photographie, il n'y avait pas de dette, de reste, de recoin où la poussière de la subjectivité puisse s'entasser, mûrir et pourrir. Avec la photo, il se sentait en équilibre avec le monde: il n'y mettait que ce qu'il en prenait. C'était à l'Histoire, au grand Je collectif de faire la synthèse. Ce n'était plus son affaire ; il était presque tranquille.
Alors, quand l'inquiétude le reprenait, quand il se demandait s'il avait raison, il recommençait son pèlerinage aux sources. Il vendait ses appareils: il s'achetait une moto... Sur les étagères, sur la cheminée, il y avait des trophées. Il avait traversé la France pour des concours de moto-cross, quelques courses gagnées, dont les triomphes, détachés de leur socle, gisaient dans les coins comme des plantes dépotées. Puis, il avait abandonné pour le piano. Car, ce qui le troublait était de savoir laquelle, parmi toutes ces occupations, était la plus active. Par l'action, on rattrape le retard; ce retard sur l'Histoire qu'il ressentait douloureusement comme le péché capital de sa génération. Mais, en fin de compte, il revenait toujours à la photographie, parce qu'il y trouvait un approfondissement, une stérilisation de ses inquiétudes. Avec la photographie, parce qu'elle est aussi une activité technique, parce que développer un cliché, le cadrer, le gommer, est partie prenante de la création, les illusions sont impossibles; si on ne possède pas la loi de l'action par la technique, on en domine au moins le fonctionnement."[20]
Christophe Chazalon
[1 ]Troisième de couverture du Coeur net, paru aux Seuil en 1949.
[2] "Témoignage d’Antoine Bonfanti: ingénieur du son" (recueilli par Olivier Khon et Hubert Niogret), Positif, n° 433 (mars 1997), p. 92-93.
[3] Physicien et ingénieur, Paul Lafonta a rencontré Chris Marker à la FNAC. Les deux hommes ont de suite sympathisé et travaillé conjointement sur des projets. http://dialector.poptronics.fr/dialector_documents/CEntretienLafonta002.html.
[4] Développeur de programmes graphiques sur Apple II dès les années 70, François Helt raconte, en 2012, son travail avec Marker : https://vimeo.com/45351756.
[5] http://www.chrismarker.ch/expositions-et-installations-de-chris-marker.html#YSa7ZNnn
[6] http://www.gorgomancy.net/images/ouvroir/ouvroirSecondLife.html.
[7] http://www.chrismarker.ch/passengers-de-chris-marker-2011.html.
[8] http://www.chrismarker.ch/photographies-et-illustrations-de-chris-marker.html.
[9] Ce nom fait sans aucun doute possible référence à La Chasse au Snark de Lewis Caroll (1876).
[10] http://www.eyemagazine.com/feature/article/the-image-as-evidence .On retrouve à ses côtés Agnès Varda, William Klein et plus tard Jean-Claude Seine. Une étude reste à faire sur cette société.
[11]Coeur de chat. Si Chris Marker m'était conté, Genève: Activités Culturelles de l'Université de Genève, 2010, p. 56.
[12] Notice BNF FRBNF39462797. Ce spectacle s’est tenu au Théâtre du Capitol à Toulouse le 3 octobre 1963.
[13] Guillaume-en-Egypte est un dédoublement de Chris Marker, plus qu'un alias comme l'explique la dite revue.
[14] http://www.poptronics.fr/IMG/pdf_Poplab_GEE-Brazil.pdf.
[15] http://www.cyberbohemia.com/o.w.l./exp.html.
[16] Sur le statut d’image-générique dans La jetée, voir Philippe Dubois, « La jetée de Chris Marker ou le cinématographe de la conscience », in Théorème 6, Recherches sur Chris Marker, PSN, Paris, 2002, p 8-44.
[17] Sur le récit de ce voyage en Corée du Nord avec Marker, voir Claude Lanzmann, Le Lièvre de Patagonie, Gallimard, Paris, 2009.
[18] https://www.flickr.com/photos/89096975@N00/.
[19] On n'a d'ailleurs jamais fait, à notre connaissance, entre les mondes de L'invention de Morel et La jetée, quand bien même les sujets sont proches. Marker a surtout évoqué The Most Dangerous Man Alive (1961) d'Allan Dwan, en plus de Vertigo (1958).
[20] Natacha Michel, Ici commence, Paris: Gallimard, 1973, p. 99-100.
Description d'un combat (2017)
Dans le cadre de la sortie d'un coffret DVD comprenant Description d'un combat de Chris Marker et Description d'un souvenir de Dan Geva, aux Éditions Tamasa, nous avons co-rédigés un livret avec Éric Le Roy, Florence Dauman d'Argos film et l'équipe de Tamasa. Des échanges plaisants et extrêmement enrichissants culturellement parlant dont on garde un excellent souvenir. Merci à tous, une fois encore pour cette aventure.
On retrouve le PDF complet du livre sur le site de Tamasa (ou ici, en cliquant sur le mot PDF).
"Description d'un combat ou la prophétie d'une lutte sans espoir"
Chris Marker, Description d'un combat & Description d'un souvenir, un film de Dan Geva, Paris: Tamasa / Argos Films, 02/2017, p. [25-48]
Description d’un combat naît à l’occasion d’une rencontre au Festival international du Film de Moscou1. Aux premiers jours d’août 1959, alors que le festival renaît de ses cendres2, les époux Lia et Wim van Leer font la connaissance de Chris Marker, venu faire la promotion de son dernier film, Lettre de Sibérie3. Le courant passe rapidement entre les trois festivaliers et l’idée d’un film sur Israël émerge alors, un peu à l’image de ce qui s’était passé quelques années auparavant pour Dimanche à Pékin. En effet, à l’occasion d’une réunion de l’association française des ciné-clubs, Chris Marker, qui s’apprêtait à partir pour la Chine, y avait fait la connaissance du jeune réalisateur Paul Paviot. Convergences des idées et des approches, Paviot avait alors immédiatement proposé à Marker de lui fournir, par l’entremise de sa société Pavox Films, une caméra 16 mm et de la pellicule kodachrome pour pouvoir tourner le film que celui-ci avait en tête4. Une époque où, semble-t-il, il suffisait de vouloir pour pouvoir !
Quoiqu’il en soit, en janvier 1960, Marker se rend en Israël pour effectuer, à l’aide d’un scooter offert par les Van Leer5, "un repérage poussé" de cette Lettre de Tel-Aviv, qui, écrit l’auteur, "permit de tracer les grandes lignes d’un scénario dont le tournage (mai-juin) ne tint absolument aucun compte, et de remplacer l’improvisation hâtive des autres films par une improvisation tranquille"6. Outre le scénario oublié, pas moins de 400 photos furent prises, qui serviront directement, pour nombre d’entre-elles, à la réalisation du film7.
Description d’un combat est finalement achevé durant l’automne 1960 et sort sur les écrans français, en programme commun avec La pyramide humaine de Jean Rouch, fin avril 19618. Marker pris soin de préciser, non sans humour, que si à l’origine, le film était prévu pour le Festival de Moscou, de "hautes instances israéliennes estimèrent que la proportion de Juifs mal rasés y dépassait la cote d’alerte de la contre-propagande". Aussi, les dites instances préférèrent-elles "solliciter les lauriers de Berlin-Ouest", où finalement le film obtint l’Ours d’or du film documentaire et du court-métrage en juin 19619, ainsi que le Prix de la jeunesse du Sénat.
Un film faussement évident
La première question que l’on peut logiquement se poser est tout simplement: de quoi parle Description d’un combat? Et tous en cœur de répondre: Israël. Bien. Mais plus précisément de quoi est-il vraiment question? Description d’un combat est-il un simple documentaire sur un pays tout fraîchement apparu sur la mappemonde? Un regard sur les gens qui font ce pays, leurs habitudes, leurs coutumes? A-t-il une visée didactique? Est-il, pour reprendre une définition accessible sur le Web, "une vision d’un auteur, proposant une lecture créatrice du réel"?
Pour le savoir, il nous faut remonter dans le temps. Pas très loin en fait. Partons de 1946. Christian Bouche-Villeneuve, à peine sortie de l’armée américaine et de la Seconde Guerre mondiale, écrit des textes et des recensions pour la revue française Esprit. Dans le numéro d’octobre, il s’attache avec enthousiasme à un livre de Pierre Schaeffer intitulé Amérique nous t’ignorons. Chris Marker signe alors Chris Mayor et a 25 ans. Et cette recension est essentielle à la compréhension de son œuvre à venir.
"Parvenu au bout de ce second voyage en Amérique qu’a été pour lui la rédaction de son livre, écrit le jeune Marker, M. Schaeffer est pris de scrupules plus vifs qu’à son retour. Est-il décent, se demande-t-il, de livrer aux lecteurs des jugements aussi personnels sur un pays que l’on a mis tout juste six mois à parcourir? (...) En tout cas, rien dans son livre qui sente la caravane, les réceptions et les tournées de propagande. Peu de statistiques. Pour ainsi dire pas de "politique". Mais des couleurs. Des sons. Des gens, rencontrés au hasard. Il est très documenté sur le board de l’essence, mais c’est parce qu’il a eu une panne. Il découvre les liens profonds unissant vendeurs et marchands de costumes, mais sa coquetterie en est la cause. Il flâne, il discute avec les mille M. Truman qui peuplent l’Amérique. (...) Et de tout cela sort un tableau de l’Amérique qu’aucun sociologue, aucun historien, aucun reporter n’aurait pu faire si vivant. Il faut bien que M. Schaeffer ait été choisi par les dieux qui président à la légende des États-Unis, puisque même ses erreurs le servent. (...) C’est que M. Schaeffer sait distinguer les choses sérieuses des balivernes. Il nous parle peu de politique, presque pas de littérature et pas du tout de philosophie, parce que ce sont là détails négligeables. Mais il nous parle d’Orson Welles, du lait pasteurisé, des cinémas pour automobiles et de Coney Island. (...) Le livre, très habilement, tout en évitant l’ordre chronologique, épouse cependant les trois phases de la réflexion de l’auteur: enthousiasme au début, enthousiasme à base de couleur de cravates, de jambes de filles, de petits déjeuners catapultés et de chanteurs de radio (...), lassitude au bout d’un certain temps, parce que trop de ressemblances, trop de nivellement, trop de satisfaction - et, au retour, entre la joie et le dégoût, cette espèce de lancinement d’amours perdues qu’il ex-prime très bellement: "New York aux beaux soirs de soie grège / Mon cœur se serre à tes boulons"10.
Tous ceux qui connaissent l’œuvre de Chris Marker comprennent l’intérêt de cette recension. Dimanche à Pékin (1956), Lettre de Sibérie (1958), Coréennes (1959) ou encore Le mystère Koumiko (1965), pour n’en citer que quelques unes, autant d’œuvres qui suivent ce modèle: le regard, par les chemins de traverses, d’un artiste curieux, à travers lequel l’anecdotique à plus d’intérêt que les clichés éculés, l’inattendu que la pensée mainstream, le subjectif que l’objectif officiel. Et c’est d’ailleurs bien là le principe de la collection à succès de guide de voyage "Petite Planète", parue aux éditions du Seuil et créée et dirigée par Chris Marker de 1954 à 1958, et suivie de très près par ses soins jusqu’en 1963.
Aussi, à la première vision, Description d’un combat s’inscrit parfaitement dans ce cadre: un melting-pot de séquences, toutes plus inattendues les unes que les autres, disparates, incongrues et qui laissent une sensation de superficialité légère, mais non déplaisante. On y parle bien entendu du désert conquis, des Juifs orthodoxes du ghetto, de l’histoire biblique, de l’aventure de l’Exodus, du Mur des Lamentations, du Sabbath, des kibboutz ou encore des faciès pittoresques. Toutes autant d’images d’Épinal rattachées aux Juifs d’hier ou d’aujourd’hui. Certains se plaindront toutefois qu’on n’y parle pas suffisamment de la Shoah, des camps de concentration, pas plus que des Palestiniens, et que Marker, tout comme pour les goulags dans Lettre de Sibérie, fait simplement l’impasse sur ce qui dérange. Oui, c’est vrai. C’est vrai si l’on regarde Description d’un combat comme un simple film documentaire sur Israël, sur ce jeune pays en devenir, et que l’on se dit que le réalisateur a offert un regard purement subjectif, empli de clins-d’œil et parsemé il est vrai de références culturelles abondantes, peut-être même trop, faisant de Marker, d’après certains, un être prétentieux, désireux d’exhiber son savoir à tout va. Dans ce sens, François Weyergans, des Cahiers du cinéma, écrivit à ce sujet: "Les films de Marker sont des films-conversations. Pleins d’allusions, de parenthèses, d’anecdotes, d’exclamations sur des amis communs (...); films où quelqu’un parle, et à la première personne! C’est pourquoi Marker devrait appeler ses œuvres: Chris à Pékin, Chris en Sibérie, Chris en Giralducie11, Chris en Corée, Chris en Israël"12.
Mais ce n’est là qu’apparence. Une apparence trompeuse, car si Description d’un combat se laisse voir et a été vu comme un simple documentaire sur Israël, dans les faits, il en va tout autrement. Description d’un combat est un film mûrement réfléchi, complexe, exigeant et très brillamment construit. Tout le monde peut le voir et en tirer quelque chose, découvrir ou confirmer une idée sur le pays ou les gens qui le peuplent, mais rares sont ceux qui peuvent saisir toute la portée de ce film et sa profondeur.
Sur les traces d’une narration
Avant d’aller plus loin, peut-être serait-il bon de décrire précisément, en quelques mots, pas à pas, le contenu du film. Cela n’est pas la coutume, mais la complexité de la structure du film l’impose. Description d’un combat commence par les signes13, hypocentres du sens et de la communication des Anciens et des Modernes, en passant par une bifurcation sur un zoo biblique, puis par une rapide localisation géographique de la nouvelle Nation en plein devenir, puis au jeune Ali d’Haïfa et ses rêves olympiques, qui nous introduit tout naturellement sur l’enfance d’Israël, entendez par là, les enfants d’Israël, d’hier et d’aujourd’hui, tout en un, et les autres aussi. Les enfants sont l’avenir, sorte de tautologie consensuelle. De là, le film se poursuit sur la langue, ou plutôt le Verbe, si essentiel, si caractéristique, si prégnant dans l’univers judaïque. Les touristes sont alors les dindons de la farce. Eux qui croyaient prendre un instant de réel fantasmé sur papier glacé sont, au final et à leur insu, source de l’intérêt des Israéliens eux-mêmes, objet de spectacle et divertissement, mais plus encore ils permettent, à travers leur voyeurisme touristique souventefois décrié par Marker14, de réfléchir sur la représentation et plus encore sur la saisie de l’instant que sont les photos, témoins historiques d’un temps passé et dont il manque alors l’essentiel de la substance: le présent, le contexte. Un petit intermède de M. Klein, "un Juif ami des chattes" divertit le spectateur, avant de se pencher sur Noah Rosenfeld, le joueur d’échecs du kibboutz, qui vit, lui, hors de toute emprise du monde réel, sorte de symbole d’un impossible idéal à suivre. Arrive alors une confrontation du passé et du futur. En un jeu de rapprochements cher à l’auteur, la Mer Morte et ses secrets passés refont surface pour rivaliser avec l’agriculture contemporaine. Qu’est-ce qui a le plus d’importance? Grand Dieu, ni l’un ni l’autre. La véritable question, le véritable enjeu souterrain illustré ici est: "mais à qui appartient cette terre?". Aux Arabes ou aux fils d’Israël? Au final, nous dit Marker, peu importe, les miracles sont là pour ça et les Juifs s’y connaissent en miracles, n’est-ce pas l’essentiel? Plus encore, précise-t-il, "Israël se cherche un passé autre que celui de la résignation et du martyr". C’est alors que vient le temps rêvé des kibboutz. Le réalisateur s’attarde longuement sur une assemblée générale. Les propos, non traduits en sous-titre, le sont dans l’édition papier des Commentaires parus au Seuil, à la fin de l’année 1961. Au spectateur de suivre, de s’intéresser, s’il le veut. Telle est la grande magnanimité de l’auteur. Plus encore, il faudra attendre 2006 et le film de Dan Geva, Description of a Memory, pour apprendre que la cheffe d’orchestre de la dite assemblée n’est autre que la sœur d’un certain Isaac Rabin. Mais cela était-il important? Au final, ce que d’aucun pourrait prendre pour une longue digression anecdotique, s’avère tout bonnement être le point central du film. Et Marker de préciser: "les kibboutzim sont une minorité en Israël, mais une minorité conquérante, exemplaire". Rien ne va plus, les jeux sont faits. La minorité arabe apparaît enfin, car oui, Israël lutte non seulement avec les pays arabes voisins (Egypte, Syrie, Transjordanie, Liban...), mais possède également une forte minorité arabe en son sein, celle "qui est l’épine dans la chair d’Israël, qui donne mauvaise conscience aux meilleurs" et ce n’est pas la couronne d’épine du Christ qui dira le contraire. Ce passage ultra-rapide sur les Arabes en a choqué plus d’un. Mais, quitte à insister lourdement, Description d’un combat n’est pas un film sur Israël et ses opposants, mais sur Israël tout seul. Alors pour contrepoint, Marker poursuit avec la vie miraculeuse, tant elle est difficile, de la jeune Mouna, dont le seul prénom nous apprend qu’elle est de ces Arabes injustement oubliés. Fille aînée d’une famille de sept enfants, elle gère la petite maison de Nazareth avec une ardeur pleine de vie qui ne se dément pas. Rien n’y fait. La pauvreté et l’adversité n’ont pas prise sur son moral... L’avenir irradie en elle. Il ne peut donc être que radieux. Alors s’abat l’ombre du conflit, juste mentionné: "un incident de frontière a éclaté hier soir" nous dit le narrateur en voix off. Oui, la guerre n’est pas loin. C’est aussi ça Israël, un pays fondé sur la guerre, mais les habitants n’en ont cure ou feignent de ne s’en point soucier. Ainsi les bédouins parlent de chevaux, les jeunes filles de danses et de beaux professeurs, quand d’autres se retrouvent dans une cave "essentialiste" pour boire un verre et philosopher. Demain, une partie d’entre eux ira se battre, mais cela, c’est demain...Vient alors le temps de la conclusion. Douze ans d’existence et après? L’enfance d’Israël s’achève, arrive l’adolescence et la lutte non pas avec l’Ange (source, souvenons-nous, du nom d’Israël) mais avec l’autorité des Pères. Qu’adviendra-t-il d’Israël? Qu’adviendra-t-il de ses enfants? Quel sera leur chemin? Au détour d’une citation de Malraux15 dont l’importance ne saute pas aux yeux quand bien même elle est centrale, Marker fait une nouvelle digression en direction du passé. "Et nous, qu’avons nous fait pour qu’il en soit autrement?" L’épisode de l’Exodus apparaît à l’écran, extrait du film de Meyer Levin, Les illégaux, qui, lui-même, les a empruntées à Bertrand Hesse, de Pathé-Journal. Ceux qui connaissent l’Histoire dans ses détails comprennent alors ce que Marker veut dire, les autres absorbent ce nouveau segment – autre image d’Épinal de l’histoire juive – sans se douter de rien. La conclusion apparaît avec une jeune fille qui dessine, appliquée, symbole, à elle seule, d’Israël au moment du tournage, un Israël métaphysique en quête de prophétie. "Il faut la regarder. Son existence, sa liberté, c’était l’enjeu du premier combat. C’était le temps des miracles. Mais les miracles meurent [aussi]16 avec ceux qui les ont vus. Un deuxième combat commence". Et l’injustice de poindre son nez, une injustice qui "sur la terre d’Israël pèse plus lourd que partout ailleurs, parce que cette terre elle-même est la rançon de l’injustice". Cette injustice tue, c’est la Palestine, qui apparaît enfin, cachée par les mots, alors que le film s’achève.
Un titre peut en cacher un autre
En suivant ainsi le film, pas à pas, on s’aperçoit déjà que son centre, son sujet, ce n’est rien qu’Israël, et son peuple aux visages multiples. Mais plus encore, une partie d’Israël y est mise en avant et c’est sur elle que s’interroge Chris Marker. Aussi, si la projection de la pellicule est trop rapide, trop fugace pour saisir cela, il est toujours possible de se reporter aux Commentaires édités avec soin par l’auteur, pour plonger plus longuement et précisément au cœur de l’œuvre.
Cela dit, il est un autre élément dont nous avons volontairement repoussé l’analyse jusqu’ici. Tout historien, tout critique qui se respecte sait que lorsque l’on étudie une œuvre, il faut s’intéresser au titre, car le titre contient en son sein si ce n’est l’essence de l’œuvre, du moins l’idée directrice.
Dans ce cadre, Description d’un combat laisse penser que l’auteur va analyser un combat. Sachant qu’il s’agit d’Israël, on aurait pu penser (aujourd’hui plus qu’en 1960) qu’il s’agirait du conflit israélo-palestinien. Mais, comme l’analyse pas à pas du film vient de nous le montrer, il n’en est rien. Il faut préciser ici que l’État d’Israël a été fondé sur la Palestine ottomane, devenue la Palestine mandataire à la chute de l’Empire ottoman. Sous mandat britannique dès 1920, il a été décidé par l’ONU, le 29 novembre 1947, à travers l’adoption de la résolution 181, de diviser la Palestine en trois, à savoir une partie juive (qui deviendra Israël), une partie arabe (qui deviendra la Palestine) et Jérusalem qui se trouve dès lors sous contrôle international. Malgré les fortes migrations des Palestiniens, sur le territoire d’Israël, on trouve diverses peuplades arabes (les Arabes « israéliens ») dont les Druzes ou les Bédouins, qui cohabitent tant bien que mal avec les Juifs. Ce sont eux qui sont filmés dans Description d’un combat, non les Palestiniens de la bande de Gaza ou de Cisjordanie (issue de la Transjordanie).
Toujours nous intéressant au titre, des pistes laisseraient alors penser que Marker s’intéresse à la naissance d’Israël, soit les douze années qui suivent la déclaration d’indépendance de 1948. Mais là encore, il n’en est rien. Marker mentionne des éléments, mais n’en fait pas l’analyse méthodique et progressive. Alors de quel combat s’agit-il et qu’entend le réalisateur par "description"? Il faut se référer à un élément situé à la fin du film pour avoir une première piste: le commentaire déclamé sur l’image de la jeune fille dessinant. Citons-le de nouveau: "Il faut la regarder. Son existence, sa liberté, c’était l’enjeu du premier combat. C’était le temps des miracles. Mais les miracles meurent avec ceux qui les ont vus. Un deuxième combat commence". Le texte est on ne peut plus clair. Marker fait donc la description du deuxième combat à venir ?17. La preuve tient à l’omniprésence de la jeunesse tout au long du film, cet avenir d’Israël. Par ailleurs, le film commence par des signes et pas n’importe lesquels: des restes de moteurs d’avion de chasse ou de carcasses de tanks. La première étape de la naissance d’Israël est achevée. La guerre n’a plus lieu sur les terres d’Israël, mais aux pourtours. Les signes ne trompent pas. Mais pour bien comprendre le sujet du film de Marker sur Israël, il faut en fait se reporter au titre hébreu, car oui, il existe un second titre à ce film: Hatzad Hashlishi Shel Hamatbaya, soit La troisième face de la pièce. La véritable raison de ce changement de titre tient avant tout au fait qu’en hébreu, il n’existe pas de mot pour signifier le "combat" dans un sens figuré18.
Quoiqu’il en soit, nous avons essayé de comprendre quel rapport il pouvait y avoir entre les deux titres et plus encore entre ce second titre en hébreu et le film. Cela paraît évident après coup, mais il nous a fallu un certain temps pour comprendre ce qu’il signifiait réellement. Nombre de propositions nous ont été faites, par des gens de tous horizons, et puis un jour, eureka! Enfin, la solution est apparue.
Il faut considérer la traduction anglaise, peut-être plus évocatrice: The third side of a coin. Le coin anglais, c’est une pièce de monnaie, voire une médaille. On joue à pile ou face. Jusque là, rien de très original. Mais ce que l’on oublie souvent, pour ne pas dire toujours, c’est qu’une pièce de monnaie à non pas deux, mais trois "faces": l’avers (côté "face" ou le "droit", qui comporte le l’effigie ou le motif principal), le revers (côté "pile") et... la tranche. Cette dernière n’a certes pris corps que vers la fin du XVIIe siècle, en particulier pour éviter aux rogneurs et autres faux monnayeurs de raboter les pièces et ainsi récupérer indûment du métal19. Mais d’une manière plus générale et plus théorique, la tranche sert surtout et avant tout à relier le côté pile au côté face.
Dans le cas de Description d’un combat, la troisième face de la pièce équivaut ainsi à l’utopie des pionniers, soit ce que l’on pourrait appeler le "socialisme sioniste". La troisième face de la pièce, ce n’est autre que le présent qui tente tant bien que mal, dans son idéal tout du moins, de relier le passé d’Israël (le peuple élu, la Judée, la Torah20, la Shoah21, etc.) à son futur (un état-nation à part entière, fortement occidentalisé, consumériste, mondialisant et laïc). Entre les deux, les pionniers, rappelons-le, les véritables fondateurs du nouvel État d’Israël22.
Description d’un combat apparaît alors non plus comme un film sur Israël à proprement parler, ni sur l’histoire de sa naissance, mais bel et bien un film sur une utopie socialiste en pleine action. Pour rappel, car avec Chris Marker, il faut toujours prendre soin de remettre les choses dans leur contexte, le mouvement sioniste est apparu à la fin du XIXe siècle, à la suite des pogroms et autres violences subis par les Juifs en Russie, en Allemagne, en Autriche ou encore en Roumanie. Ses membres visent alors la création d’un "foyer national juif", tel que le décrira Léo Pinsker dans son Auto-émancipation en 1882, et plus encore Théodor Herzl dans son État des Juifs en 1896. Mais ce que l’on oublie un peu trop souvent, c’est que le mouvement sioniste est aussi une réponse des Juifs pauvres aux abus des Juifs riches et puissants. Il a une portée très hautement sociale. Si les dirigeants ou les décideurs juifs voulaient maintenir un judaïsme orthodoxe, tout à leur avantage, les Juifs les plus pauvres visaient un judaïsme plus ouvert, plus moderne et à tendance laïcisante. Chaïm Weizmann, premier président d’Israël de 1949 à 1952, ayant vécu sous la Russie des pogroms, décrit la situation en ces mots: "Les masses juives s’élevaient contre le paternalisme de leurs "notables", leur chtadlonim, hommes riches et influents qui avaient toujours pris sur eux de représenter les besoins des Juifs vis-à-vis de l’autorité gouvernementale. Leur point de vue était celui d’une classe, et il était caractérisé par la crainte innée de troubler le status quo, ou par celle de mettre en péril tels privilèges dont ils jouissaient en vertu de leur situation économique"23. De là naîtront les kibboutz, communautés de partage total, proche des kolkhozes soviétiques, sous l’influence des idées d’un socialisme associatif.
Aussi, se demande Marker, que deviendra cette utopie, tiraillée entre le judaïsme traditionnel ou orthodoxe, d’une part, et la liberté si puissante de la société de consommation à l’occidentale, dont l’avènement semble inévitable, d’autre part? Quel chemin choisira la jeune fille qui clôture le film, symbole d’Israël en plein devenir, concentrée sur sa tâche mais somme toute insouciante, dans sa grande jeunesse, des périls de l’âge adulte raisonné et cartésien?
C’est à travers ce schéma que le titre français prend alors son sens. Un titre qui n’a rien d’original, comme cela est coutumier chez Marker. Description d’un combat, c’est au départ un des très rares écrits à la première personne de Kafka. L’auteur y décrit, à travers une promenade nocturne, un combat entre deux hommes, entre réalité et imaginaire, sur des plans aussi variés que la philosophie, la morale, l’éthique... Mais au final, il apparaît que les deux hommes ne font qu’un. La nouvelle de Kafka, c’est l’histoire d’un combat d’un homme contre lui-même. De la même manière, Description d’un combat de Chris Marker, c’est l’histoire du combat que l’utopie socialiste des pionniers mène contre elle-même, et ce, au moment même où le film est tourné, dans ce présent du regard du cinéaste.
Bien loin d’un banal récit de voyage d’un globe-trotter, d’une Lettre de Tel-Aviv consensuelle ou non, on comprend dès lors en quoi Description d’un combat se rattache au reste de l’œuvre de Marker de la première période: Dimanche à Pékin, Lettre de Sibérie, Cuba Si à venir ou encore son livre Coréennes, que l’auteur décrit comme un "court-métrage où l’on souhaite voir apparaître un genre distinct de l’album et du reportage, qu’on appellerait faute de mieux ciné-essai comme il y a des ciné-romans"24. Tous sont les réflexions d’un artiste sur des nouveaux modes de gouvernance d’obédience socialiste. Et Marker sent, s’il ne le sait déjà, que leur durée de vie est compromise, ce qui sera confirmé quelques années plus tard avec son film somme Le fond de l’air est rouge (1977).
Ode à la jeunesse
Ayant jeté les bases de son film, Marker s’attache alors spécifiquement à la jeunesse. En effet, ce qui frappe à la vision du film, c’est l’importance accordée aux enfants. Mais là encore, les surprises se dévoilent au contact de l’analyse profonde. On peut classer ces enfants en deux groupes très clairement distincts: les Juifs d’un côté et les Arabes de l’autre, tous cependant "Israéliens". Une distinction plus importante qu’il n’y paraît. En effet, les jeunes Juifs semblent uniquement passifs ou du moins sans objectifs, comme perdus, privés d’avenir ou en attente ou sans intérêt pour leur futur. Ils n’apparaissent jamais au travail. Ainsi, la jeune fille en fin de film apprend à dessiner, avec des camarades qui se démultiplient d’année en année, d’autres jeunes filles parlent de danse et surtout discutent de la beauté de leur instructeur, d’autres enfants se baignent dans une fontaine sous le regard des adultes amusés, alors que les enfants du ghetto jouent dans la rue, d’autres tout droit tirés du mouvement scout se rebiffent contre l’autoritarisme zélé d’un de leurs aînés, d’autres demandent à être pris en photo (forte charge symbolique s’il en est), un autre, champion d’échec issu du kibboutz, ne se soucie guère du monde ou de demain, d’autres encore sont sur une plage du côté de Tel Aviv, le futur lieu d’un Israël mondialisé et vendu au tourisme de masse. La voix off commente la situation en ces mots: "aurions-nous la nostalgie un peu vaine de ce matin, de ces filles aux voix aiguës, du garçon qui traînait son fusil et de celui qui priait sur une balançoire?" Aussi que deviendront ce jeune "soldat" israélien pas encore convaincu par la cause ou ce jeune "religieux" pas encore soumis à la politique des partis? La réponse est à venir. Plus encore, Marker confirme sans ambage le déclin des kibboutz.
"Depuis que la vie au kibboutz est devenue relativement plus confortable, le recrutement a baissé, ce qui n’est paradoxal qu’en apparence. On recrute plus facilement pour le combat que pour l’exercice. Et s’il est normal que l’expérience évolue, que les formes changent, beaucoup s’inquiètent de la direction de ces changements. Héritiers d’un idéalisme intransigeant au milieu d’un monde dont l’évolution est quelque peu différente, isolés dans leur propre pays, isolés du socialisme mondial, combien de temps sauront-ils conserver leur pureté?"
En contrepoint, Marker met en avant deux jeunes Arabes d’Israël, qui connaissent l’abnégation tout en allant de l’avant. S’il rêve de gloire olympique, le jeune Ali n’en travaille pas moins dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Glissant sur les pentes du mont Carmel, à Haïfa, il en oublie un instant la dureté de la tâche qui est la sienne: convoyer des marchandises sur son kart au sommet du mont Carmel. Il en est de même de la jeune Mouna, du souk de Nazareth. Sœur aînée d’une famille de 7 enfants dont le père est à l’asile et la mère à l’Hôpital, elle affronte le quotidien sans broncher. Malgré l’adversité qui la frappe et cette pauvreté qui en vaincrait plus d’un, elle avance, jour après jour, et élève ses frères et sœurs avec le peu de moyens à disposition. La promesse d’un nouveau logement, tout autant que son amour pour la danse, se mêlent à un cadeau de la Vie, que Marker décrit comme "cette petite flamme indestructible sur son visage". Toujours souriante, Mouna avance vers son futur sans faiblir ni douter. Quelle différence avec la jeunesse juive montrée dans Description d’un combat!
Les signes et les pistes
La particularité des films de Chris Marker, c’est une abondance de références, doublée d’humour. Si Dimanche à Pékin et Lettre de Sibérie étaient truffés d’un humour potache et enfantin, Description d’un combat est plutôt teinté d’un humour noir. Malgré tout, les références les plus immédiates, identifiables par la grande majorité des spectateurs, poussent irrémédiablement ces derniers à sourire avec complicité, que l’on prenne Zazie dans le Néguev (clins-d’œil à l’héroïne de Queneau), ou les enseignes Varda ou Ali Baba (nom d’une amie célèbre mêlé à celui d’un personnage littéraire), ou encore le « prie-dieu à roulettes » d’Ali. Plus encore, pour les Israéliens, à qui était avant tout destiné Description d’un combat, les extraits des chansons d’amour qui parsèment le film sont autant de points positifs et plaisants, rompant avec le pessimisme à peine caché de l’auteur25.
Le jeu sur les mots et sur les images, lui, n’est pas en reste. Marker s’amuse, comme à son habitude, à joindre des bouts qui normalement ne se joignent pas. Telle est le cas de ce passage: "Tant de signes ne sont pas faits seulement pour l’œil. Dans le mouvement de la rue du Carmel, qui est la rue Mouffetard de Tel-Aviv, ils expriment un besoin vieux comme les Juifs et neuf comme la soif", alors que l’image montre des volants de jupes flotter au vent. À quoi il ajoute encore, de ci de là, des extraits de dialogues de films américains ou autre.
Quoiqu’il en soit, d’autres références sont plus obscures, car Marker, fidèle à ses habitudes, ne cite pas toujours mot pour mot, mais s’amuse à transformer, à modifier la citation, demandant toujours plus au spectateur cultivé et prêt à l’effort. Ainsi la référence à Oscar Wilde s’avère, en fait, être une variation d’un passage du Petit Prince de Saint-Exupéry.
Dans le même temps, cependant, certaines citations sont reprises telles quelles, peut-être pour leur importance. Vers le fin du film, Marker fait un constat sur les risques de la modernité. "Dans l’échelle des désirs, le décor du bonheur prend la place du bonheur: radio, réfrigérateur – bientôt télévision. Ce qui naît où les valeurs meurent, et ne les remplace pas"26. Pour cette citation, Marker précise dans ses Commentaires, en marge: "Malraux". En cherchant bien, on découvre qu’il s’agit d’une citation tirée des Voix du silence dudit Malraux et qui concerne "l’art d’assouvissement", qui correspond en quelque sorte au triomphe du matérialisme (pour ne pas dire mercantilisme) sur le spirituel. Pour Charles-Louis Foulon, "l’assouvissement représente le point ultime d’une société matérialiste qui a vaincu la transcendance"27. C’est là peut-être l’écueil le plus important auquel la jeunesse d’Israël est confronté à l’aube de ce deuxième combat (on ne saurait dire qu’il n’y en a que deux, d’où l’emploi de "deuxième" et non de "second"). Plus encore, cette phrase fait écho à un autre passage, au début du film, alors que Marker parle du quartier orthodoxe de Mea Sharim, à Jérusalem.
"Mais au-delà de ces façades repoussantes, écrit-il, de ces enfants apeurés, il y a la conscience et le besoin d’une chose qui s’appelle l’Esprit. Et la question que pose Mea Sharim, Israël est bien forcé de l’entendre: cinquante ans de liberté aboutiront-ils à ce que deux mille ans de persécutions n’ont jamais pu obtenir: l’oubli de la Loi?"
Revient alors en mémoire une des principales différences entre les Juifs orthodoxes et le mouvement sioniste: les premiers refusent dans leur majorité de revenir sur les terres d’Israël tant que le Messie n’est pas revenu, alors que les seconds sont revenus sans hésitation et de toute leur volonté sur ce qu’ils considèrent comme la terre de leurs ancêtres. Le ghetto de Mea Sharim apparaît donc bien comme un îlot d’irréductibles perdus au milieu des pionniers et qui servent dès lors de garde-fou spirituel.
De Description d’un combat à Description of a Memory
Il est à noter que si Description d’un combat a connu un certain intérêt en France à sa sortie, très rares sont les études ou critiques qui lui ont été consacrées depuis. Souvent superficielles, basées uniquement sur le film, sans considération de la richesse offerte par le commentaire édité, ces dernières doivent aussi, il est vrai, leur rareté à la grande difficulté, voire impossibilité de visionner le film à la suite d’une décision de Chris Marker lui-même.
Or, aux débuts des années 2000, un jeune réalisateur israélien du nom de Dan Geva proposa a Marker de travailler sur ce film. Marker donna son accord et naquit ainsi Description of a Memory diffusé en 2006. Enchanté par le résultat, Marker confirma alors l’interdiction de projeter (sauf rares exceptions) son Description d’un combat, estimant que tout ce qui est intéressant et utile se trouve dans le film de Geva. Et il est vrai qu’au final Geva s’attache aux points essentiels de Description d’un combat et quarante ans plus tard, montre le résultat du deuxième combat, tout en s’interrogeant sur la suite à venir en même temps que sur sa propre expérience. Qu’est-il advenu d’Israël? De sa jeunesse? Des kibboutz? Que reste-t-il de l’Israël de Marker? De cette utopie socialiste sioniste? Sans ménagement, bien qu’entrant dans sa propre intimité, Geva offre à voir un bilan peu réjouissant. Il va jusqu’à retrouver la jeune fille de la fin du film qui, mariée, réside alors en Angleterre. Pour l’occasion, elle retourne en Israël et retrouve ses souvenirs. Le deuxième combat est bel et bien terminé. Un autre, plus violent, plus tranché, a commencé depuis un certain temps.
Mais il ne nous appartient pas ici d’étudier ce second volet du dyptique, si l’on peut le définir ainsi. Cependant, force est de constater que Description of a Memory est une suite légitime et intelligente de Description d’un combat qui, en plus de ses qualités intrinsèques et de son développement intellectuel, permet de mettre en lumière la justesse des intuitions de Chris Marker sur le devenir d’Israël et son adolescence. Les craintes se sont réalisées et il n’est pas faux de dire que l’Israël des pionniers a perdu son âme au profit des deux extrêmes que sont l’orthodoxie religieuse aveugle et le libéralisme occidental consumériste.
Christophe Chazalon - www.chrismarker.ch
Genève, printemps 2016
1 Cette rencontre a été confirmée par Lia van Leer, à l’occasion de deux interviews récentes: l’une accordée à Elisabetta Rosaspina et publiée en ligne sur un des blogs du journal italien Corriere della sera, le 8 novembre 2013 (http://www.readperiodicals.com/201504/3710197341.html) et l’autre à Éric Le Roy, chef du service "accès, valorisation et enrichissement des collections" aux Archives françaises du film du CNC et président de la FIAF en 2011, interview publiée en avril 2015, dans Journal of Film Presevation (http://www.readperiodicals.com/201504/3710197341.html). Dans cette seconde interview, l’année de 1957 est mentionnée par erreur, le festival ne commençant qu’en 1959 (voir note suivante). Il ne nous paraît en effet pas probable que Marker ait attendu trois ans pour entreprendre ce nouveau projet. Son habitude est tout le contraire. Lorsqu’il avait une idée en tête, il la mettait en exécution, puis passait à autre chose, un autre projet, sans délai ni rémission.
2 Le festival de Moscou (MIFF) est né en 1935, avec pour président Sergei Eisenstein, mais ce n’est qu’en 1959, du 3 au 17 août, qu’il prend vraiment corps, année de conservation des premières archives. Il se tient alors en alternance, un an sur deux, avec le festival de Karlovy Vary (KVIFF), en Tchécoslovaquie, un festival fréquenté assidûment par Chris Marker. http://www.unifrance.org/festi-vals-et-marches/48/festival-international-du-film-de-moscou.
3 Sur les autres hypothèses de la genèse du film, voir le texte d’Éric Le Roy dans ce livret.
4 Paul Paviot nous a gentiment accordé, en 2011, un long entretien téléphonique au sujet de ses relations avec Chris Marker, ce dont nous le remercions très chaleureusement ici.
5 Marker n’ayant pas le permis de conduire, un scooter a paru une solution efficace pour faciliter ses déplacements.
6 Chris Marker, Commentaires, Paris: Le Seuil, 1961, p. 125. À noter que cette introduction au commentaire de Description d’un combat a été supprimée dans la réédition de 1967.
7 C’est du moins le chiffre donné par Chris Marker à Éric Le Roy. Certains critiques, biographes ou historiens évoquent le chiffre de 800, voire de 1000, sans pour autant préciser leur source.
8 L’autorisation de la censure figurant sur le contrat de production est datée du 23 mars 1961 (dossier du Registre public 37’793). Sur les collaborateurs du film et la production, lire le texte d’Éric Le Roy, dans ce livret.
9 http://www.berlinale.de/en/archiv/jahresarchive/1961/03_preistr_ger_1961/03_Preistrae-ger_1961.html. La Berlinale a eu lieu du 23 juin au 4 juillet 1961.
10 Chris Mayor, "Pierre Schaeffer: Amérique nous t’ignorons (éd. du Seuil)", Esprit, n° 126 (octobre 1946), p. 511-513.
11 Chris Marker est l’auteur d’une biographie sur Jean Giraudoux, parue en 1952 au Seuil et qui connut un grand succès et de nombreuses rééditions.
12 François Weyergans, "Petit journal du cinéma: Chris en Israël...", Cahiers du cinéma, n° 115 (janvier 1961), p. 40.
13 "La signification est le procès qui associe un objet, un être, une notion, un événement à un signe susceptible de les évoquer: un nuage est signe de pluie, le mot "cheval" est le signe de l’animal. Un signe est donc un excitant (stimulus) dont l’action sur l’organisme provoque l’image mémorielle d’un autre stimulus (se rappeler le chien de Pavlov)" (Pierre Guiraud, La sémantique, Paris: PUF, 1969, p. 1).
14 On pense en particulier à la séquence sur les photographes américains du dimanche proposée par François Reichenbach dans son film L’Amérique insolite (1960), dont le commentaire est de Chris Marker.
15 Voir ci-dessous.
16 Nous ajoutons ces crochets en guise de rapprochement avec Les statues meurent aussi, premier film de Chris Marker, co-réalisé avec Alain Resnais et Ghislain Cloquet à partir de 1950, et censuré dès sa sortie début 1953 jusqu’en octobre 1964.
17Si tel n’était pas le cas, Marker se serait attaché aux guerres avec les pays Arabes, à l’armée et les groupes armées israéliens, au mouvement sioniste et son histoire, à l’attitude des grandes Nations vis à vis de la création d’Israël etc.
18 http://www.zeit.de/1961/30/ein-volk-analysiert-sich-selbst
19 Aujourd’hui, la tranche sert aux malvoyants, en tout cas en ce qui concerne les euros (https://scribium.com/daniel-lesueur/a/la-tranche-des-pieces-de-monnaie-utilite-ou-futilite/)
20 La Torah correspond au cinq livres du Pentateuque chrétien, mais il est plus encore. Il sert de charte historique et doctrinale au judaïsme orthodoxe, et est complétée par le Talmud et la littérature midrashique.
21 La Shoah (ou Holocauste) correspond à l’extermination systématique des 2/3 des Juifs d’Europe, soit les 40% des Juifs du monde, durant la Seconde Guerre mondiale.
22 Cette idée de "troisième face" pourrait aussi trouver un écho dans celle de "troisième dimension" d’André Malraux: "L’histoire de la technique du récit depuis trois siècles, écrit-il, comme celle de la peinture, suit essentiellement la recherche d’une troisième dimension, de ce qui, dans le roman, échappe au récit; de ce qui permet, non de raconter, mais de représenter, de rendre présent. La narration exprime un passé, dont la mise en scène – en scènes – fait un présent" (Oeuvres complètes, Paris: Gallimard, t. II, p. 1193), ce que Claude Pillet décrit en ces mots: "par elle, l’oeuvre est absolument contemporaine de celui à qui elle est nécessaire, alors que l’univers historique et psychologique, et les données spatio-temporelle qui l’ont vu naître et auxquels appartient son créateur ont disparu à jamais" (Le sens ou la mort: essai sur Le miroir des limbes d’André Malraux, Bern / Berlin...: Peter Lang, 2010, p. 394).
23 Chaïm Weizmann, Naissance d’Israël, Paris : Galimard, 1957, p. 30.
24 Quatrième de couverture de Coréennes qui est le premier volume d’une nouvelle collection débutant au Seuil, intitulée "Court-métrage".
25 François Weyergans, "Petit journal du cinéma: Chris en Israël...", Cahiers du cinéma, n° 115 (janvier 1961), p. 40.
26 André Malraux, Les voix du Silence, Paris : Gallimard, 1951, p. 528.
27 Charles-Louis Foulon, André Malraux et le rayonnement culturel de la France, Paris: Editions Com-plexe, 2004, p. 107. Il précise encore: "Art fallacieux s’il en est, l’assouvissement scelle le triomphe du corps sur l’esprit, de l’agitation sur la méditation, de la satisfaction des instincts sur une conscience raisonnée de l’homme et du monde".
Planète Marker (2013)
Le dossier de presse de "Planète Marker", coffret DVD comprenant les films Lettre de Sibérie et Dimanche à Pékin, Level Five et Junkopia de Chris Marker, ainsi que Regard neuf sur Olympia 52 de Julien Faraut, reprend les deux textes que nous avons écrit pour le livret de deux autres DVD des quatres films de Marker cités ci-dessus, en les modifiant quelque peu, en particulier celui concernant Dimanche à Pékin.
On pouvait retrouver le dossier de presse en PDF sur le site de Tamasa (disparu depuis, donc proposé ICI).
Level Five - Junkopia (2013)
"Chris Marker ou la recherche de la mémoire perdue"
(Chris Marker, Level Five - Junkopia, Paris: Tamasa / Argos Films, 2013, n.p.)
En février 1997, Level Five est sélectionné pour représenter la France au Festival de Berlin, quelques jours avant sa sortie en salles dans l’Hexagone. Le succès critique est quasi unanime. Du côté du public, c’est un échec. Une seule raison semble être la cause de ce dernier: le minimalisme visuel.
Level Five raconte l’histoire de Laura, une femme qui doit achever un jeu vidéo sur la bataille d’Okinawa, à la suite de la mort de son créateur, à savoir l’homme qu’elle aimait. Une double histoire de deuil et de mémoire est ainsi imbriquée. Pour les raconter, Chris Marker fait le choix de la sobriété. Level Five, réalisé avec très peu de moyens, est tourné à deux. Laura, interprétée par Catherine Belkhodja, est l’unique protagoniste du film, une exception dans l’histoire du cinéma. L’amour-égérie de Marker y joue un rôle. Elle n’est pas le témoin privilégié ou la narratrice d’une reconstitution historique. En ce sens, on est bien dans la fiction, qui n’est, par ailleurs, pas le domaine de prédilection du réalisateur. Les seules fictions à son répertoire sont les courts métrages La Jetée (1962) et L’Ambassade (1973).
A cette partie consacrée à l’histoire de Laura, Marker ajoute une partie sur la bataille d’Okinawa dans le plus pur style documentaire, qui mêle images d’archives et témoignages, et qui elle, n’est en rien minimaliste. Le jeu vidéo est le lien entre les deux. On pourrait parler ici de "fiction documentée", le documentaire semblant servir de base à l’histoire de Laura.
Level Five est né d’une rencontre. Lors de l’un de ses voyages au Japon, Chris Marker fait la connaissance de Ju’nishi Ushiyama, fondateur de la Cinémathèque du documentaire à Tokyo. Celui-ci non seulement lui fait découvrir les films documentaires de Nagisa Oshima, mais l’invite en plus à se rendre sur l’île d’Okinawa. Aussi, c’est alors qu’il réalise A.K., en 1985, que Marker conçoit Level Five, comme il l’explique dans une interview accordée au journal Le Monde: "les premières images d’Okinawa ont été tournées en 16mm avec l’opérateur Gérard de Battista en 1985, déjà en vue de Level Five. J’ai fait plusieurs autres voyages dans l’île depuis Sans soleil (fascination personnelle), j’y suis retourné seul avec ma caméra vidéo à plusieurs reprises, toujours dans la perspective de Level Five". Marker précise par ailleurs que les images filmées par le chef opérateur Yves Angelo "proviennent d’un tout autre univers: j’avais engagé Yves Angelo pour tourner un vidéo-clip avec un groupe anglais. Ce sont des plans inutilisés qui m’ont servi quand il m’est apparu nécessaire de montrer au moins une fois Laura dans un autre contexte que celui du studio, et alors que je ne voulais aucun repère identifiable de lieu et de temps".
Si les critiques ont fait le pas pour entrer dans le film, il semblerait que les spectateurs aient été rebutés par la partie consacrée à l’héroïne. En effet, Marker et Belkhodja ont fait le choix de la raconter sous forme d’un journal vidéo, comme on pourrait en faire aujourd’hui avec une webcam. Laura est filmée uniquement en gros plan, en légère plongée, dans un seul et même espace confiné d’un appartement exigu, entre un bureau, un ordinateur et une étagère, ceci à une seule exception près. Difficile, dès lors, pour le spectateur, habitué aux mouvements de caméra toujours plus présents et au découpage des films toujours plus marqué, de suivre cette histoire et de s’identifier à l’unique personnage, tout juste contrebalancé par la voix off du cinéaste. Or, c’est l’effet contraire de ce que désirait Marker. Dans l’interview fictive avec Dolorès Walfisch, écrite de toute pièce pour le dossier de presse, Marker explique son intention: "comme j’imagine qu’il est plus facile au spectateur de se reconnaître dans la souffrance de Laura que dans celle d’un homme qui a massacré toute sa famille, je parie sur cette reconnaissance pour le faire accéder au niveau de compassion qu’elle-même atteint en plongeant dans la tragédie d’Okinawa".
Images et réalité: le mensonge infini de l’ère numérique
Level Five s’inscrit dans une période de transition importante pour l’humanité: l’ère du numérique, dont Marker voit les prodigieuses possibilités aussi bien que les dangers terrifiants, et c’est dès lors l’un des sujets principaux de sa recherche.
Tout commence à la fin des années 1970, date à laquelle Marker se détourne du cinéma collectif qu’il avait initié en 1967 avec la création de SLON et la réalisation de Loin du Vietnam. L’informatique balbutiante l’attire alors tel un aimant, avec toutes les promesses qui s’y rattachent. Marker n’est plus cinéaste. Il est cinéaste, vidéaste, artiste, programmateur informaticien, photographe, etc., partageant sa vie entre réalité et virtuel. Ainsi, en 1978, il réalise sa première installation vidéo, Quand le siècle a pris forme: guerre et révolution, en parallèle à l’Exposition Paris-Berlin 1900-1933 tenue au Centre Georges Pompidou, à Paris. Il s’agit d’un montage de séquences de films d’époque soigneusement sélectionnés dans des archives cinématographiques, traitées par informatique. Le court métrage final est projeté sur plusieurs écrans plus ou moins simultanément. A travers ce projet, Marker s’attache déjà à la modification des images, qu’il décrira à peine quatre ans plus tard dans Sans soleil, film-bilan qui marque un tournant décisif dans son œuvre. "Mon ami Hayao Yamaneko a trouvé une solution: si les images du présent ne changent pas, changer les images du passé... Il m’a montré les bagarres des Sixties traitées par son synthétiseur. Des images moins menteuses, dit-il avec la conviction des fanatiques, que celles que tu vois à la télévision. Au moins elles se donnent pour ce qu’elles sont, des images, pas la forme transportable et compacte d’une réalité déjà inaccessible". Mais Hayao Yamaneko, ce n’est autre que Chris Marker, tout comme Sandor Krasna, le protagoniste du film ou Michel Krasna, son "frère", responsable de la "bande électro-acoustique".
Toutes les installations à venir de Marker, de Zapping Zone (1990-1994) à Owls at Noon Prelude: The Hollow Men (2005), en passant par Silent Movie (1995) ou Immemory (1997: cédérom et installation), traitent directement de l’image, du contenu tout autant que du contenant, car l’ère numérique est définitivement celle de l’information tous azimuts, infinie, véhiculée par l’image avant tout. Or l’image ne dit jamais ce qu’elle est, mais prétend toujours être ce qu’elle n’est pas. L’image est une fiction, une recréation future d’un moment présent qui a été réel, mais qui n’est plus ni ne sera jamais, et ce, par le simple fait de son interprétation différée, de son positionnement sémantique dirigé (que ce soit un film, un livre, une exposition...), de notre bagage culturel propre et de nos expériences. Or, dans notre société moderne, l’image est l’élément principal de notre mémoire. Par sa concentration d’informations, par sa rapidité de lecture, par sa facilité de circulation, elle est privilégiée à toute les autres formes de transmission (écriture, langage, etc.). Elément principal ne veut pas dire meilleur élément, mais le plus utilisé, car le plus facile, le plus immédiat.
Dans ce cadre, le jeu vidéo se présente comme une métaphore du film documentaire. Dans une de ses premières réalisations, Lettre de Sibérie, Marker avait déjà proposé pour une même séquence, trois commentaires différents, à l’image d’un exercice de style de Queneau. Tous trois pouvaient être valables, mais au final aucun ne l’était. Dans Level Five, il interroge le spectateur sur ce que sont les images et sur la vérité qui les accompagne. Il prend pour cela trois exemples, que Laurent Roth décrit comme suit: "Il y a cette bande d’actualités japonaises où les femmes d’Okinawa se précipitent du haut de la falaise. L’une d’elles hésite, pourtant, voit qu’elle est filmée, et saute... Il y a ce sergent américain, décoré comme un héros après la guerre pour avoir planté la bannière étoilée sur le sol d’Okinawa au cours d’une mise en scène et sous l’objectif des photographes. On lui avait interdit de révéler la supercherie, il devint fou, se suicida... Il y a enfin ce mort en torche que l’on retrouve dans tous les montages concernant les conflits dans le Pacifique. Dans une chute (non retenue au montage) de la prise, Laura nous montre que le mort se relève, préférant vivre dans le hors-champ plutôt que mourir sacrifié dans le plan...".
Marker ne dit rien d’autre que ceci: un film documentaire, c’est un montage d’images qui de leur prise à leur assemblage retranscrivent une multitude de vérités, mais jamais la réalité. C’est d’ailleurs pourquoi il a toujours refusé le terme de cinéma-vérité pour son film Le Joli mai, lui préférant celui de cinéma-direct, inventé par Mario Ruspoli. Une fois que l’on a compris cela, on peut passer à la mémoire et son écriture.
Or, dans L’Amérique insolite, en 1960, François Reichenbach mettait déjà en avant cette attitude étrange de l’homme moderne. "Dans chaque Américain, disait le commentaire, il y a un photographe. Et dans chaque photographe, il y a toujours un touriste. Si vous le rencontrez, ne vous étonnez pas de les voir courir le monde sans le regarder. Leur kodak est leur mémoire. Une fois de retour, dans leur fauteuil, l’album sur les genoux, ils se détendront, ils se mettront à aimer le monde, ils commenceront à voyager". Marker lui aussi a les photos pour mémoire. Dans Sans soleil, il constate: "Perdu au bout du monde, sur mon île de Sal, en compagnie de mes chiens tout farauds, je me souviens de ce mois de janvier à Tokyo, ou plutôt je me souviens des images que j’ai filmées au mois de janvier à Tokyo. Elles se sont substituées maintenant à ma mémoire, elles sont ma mémoire. Je me demande comment se souviennent les gens qui ne filment pas, qui ne photographient pas, qui ne magnétoscopent pas, comment faisait l’humanité pour se souvenir...". Or, dès le début de ce film, il se posait une autre question: "Il m’écrivait: "’aurai passé ma vie à m’interroger sur la fonction du souvenir, qui n’est pas le contraire de l’oubli, plutôt son envers. On ne se souvient pas, on réécrit la mémoire comme on réécrit l’histoire. Comment se souvenir de la soif?" Comment se souvient-on? De quoi se souvient-on réellement? Qu’est-ce que le souvenir?
Sur les traces improbables du souvenir
Dans Level Five, Marker va à nouveau tenter de répondre par l’intermédiaire de Laura-Belkhodja, toujours confinée dans son espace, devant son écran, essayant de correspondre avec les morts, afin de maintenir vivant ce qui déjà s’étiole, se floute, disparaît de son esprit. C’est alors qu’elle se demande: "Si j’ai pu oublier le petit détail du chapiteau, si précis encore la dernière fois que j’étais venue, quels détails de toi, encore, vais-je perdre, un par un?"
Et le jeu des références de commencer. Son prénom évoque celui de l’héroïne d’un film éponyme d’Otto Preminger, tourné en pleine Seconde Guerre mondiale, qui connu un succès retentissant, tout autant que la mélodie qui l’accompagne: Laura (1943). Ce n’est pas un hasard si Marker, insère ce film dans Level Five. Outre la ressemblance voulue entre les deux Laura, il est aussi question du souvenir. Laura-Belkhodja se souvient d’avoir vu ce film avec celui qu’elle aimait, au Japon. Et d’ailleurs, en réalité elle ne se prénomme pas Laura, mais lui, cet homme, depuis ce jour, lui a donné ce "prénom". Elle se souvient de cela. Et puis le thème du film, elle s’en souvient, mais moins nettement. L’histoire de l’origine de ce thème est encore dans sa mémoire, mais les notes, les paroles, non. Laura a besoin de ressortir la partition éditée pour pouvoir chantonner et retrouver un semblant de temps perdu.
Level Five, même s’il n’est pas réalisé directement après, fait suite à Sans soleil. Et là, une autre référence est évidente pour tous ceux qui ont vu Sans soleil, film à travers lequel Marker part sur les traces d’un autre film, essentiel pour lui : Vertigo/Sueurs froides (1958) d’Alfred Hitchcock. Or ce film, dont l’histoire n’est pas sans rappeler celle du Laura de Preminger, fait à son tour écho à une autre œuvre clé: A la recherche du temps perdu (1913-1927) de Marcel Proust. Les fils se tissent inlassablement. Car qui parle de Proust, se souvient de sa célèbre madeleine, qui est aussi le prénom de l’héroïne de Vertigo. Mais pour Proust, ce qui déclenchait au mieux le mécanisme du souvenir, ce n’était pas la vue. Il écrivait "et tout à coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse goûté; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d’autres plus récents; peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé; les formes – et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot – s’étaient abolies, ou ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir".
De la mémoire à l’immémoire
C’est là que le jeu vidéo intervient et prend tout son sens. Certes dans Sans soleil, Yamaneko-Marker dit que "la matière électronique est la seule qui puisse traiter le sentiment, la mémoire et l’imagination". Mais, il est un fait bien plus important: l’ordinateur n’oublie pas, pas plus qu’il n’a d’humeur. Aussi, lorsque Laura essaie de lui poser des questions insensées, la réponse est toujours la même, froide et cinglante. L’évidence: pour obtenir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. La difficulté: pour obtenir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. C’est là tout le principe de ce jeu et pour Laura, l’impossible tâche, car ce jeu vidéo ne vise pas, comme la plupart des jeux vidéos, à réinventer, à réécrire l’Histoire en arrivant à de nouvelles fins, mais à réécrire strictement et correctement la vraie histoire de la bataille d’Okinawa. D’où les niveaux. Level Five ce n’est au final pas l’histoire de Laura, c’est d’abord l’histoire gardée sous silence d’un massacre et surtout une réflexion sur l’Histoire des hommes. Le massacre est un des plus importants du XXe siècle. Marker donne des pistes dans son dossier de presse. La sortie d’un cédérom américain sur la Seconde Guerre mondiale est l’un des points de départ du film. Il concluait, parlant de la bataille d’Okinawa, qu’il y avait eu environ 100 000 morts, dont de nombreux civils, ce qui est doublement faux, souligne Marker. Il y a bien eu 100 000 soldats japonais tués, mais en plus 12 000 soldats américains et surtout 150 000 civils d’Okinawa, soit le tiers de la population de l’île, qui pour la grande majorité s’est suicidée. Là est le drame. Mais, cette bataille a été à l’origine d’un drame encore plus grand, puisque son résultat a amené au largage, par les Américains, des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Or, non seulement les Américains ne font pas mention de ces morts civils okinawaïens, mais plus encore les Japonais passent ce fait totalement sous silence. Un silence honteux pour Marker, car cela revient à éradiquer l’événement de la mémoire collective. C’est pour cette raison qu’il a décidé de le mettre en avant dans son film. Et pour ce faire, il n’a pas tourné un film de fiction retraçant la bataille, mais il est allé chercher des témoins directs, qui ont participé aux suicides collectifs, ou indirects, qui tentent de ne pas oublier et de rendre hommage aux victimes.
L’Histoire des hommes et la mémoire collective ne sont au final pas bien différentes de l’histoire et de la mémoire individuelle. Lacunaires par la succession inévitable des faits, par l’oubli volontaire ou non, par la multiplicité des entrées et des points de vue. Pour bien montrer cela, au même moment qu’il réalise Level Five, Marker créé un cédérom qui n’est autre que son autobiographie, intitulée Immemory. Tout comme le jeu vidéo a plusieurs entrées possibles pour arriver à reconstituer progressivement la véritable bataille d’Okinawa, le lecteur d’Immemory a plusieurs entrées pour découvrir la vie de Marker, à un détail près, les données insérées dans le cédérom sont pour une bonne part pure invention de l’auteur. C’est la leçon à tirer de Level Five. Pour atteindre le niveau 5, il faudrait que soient entrées toutes les bonnes données dans la machine. Or, cela est impossible. D’où le niveau 5 est inatteignable! Cependant, il reste le niveau à atteindre pour mieux pouvoir envisager l’avenir, notre avenir.
Christophe Chazalon / www.chrismarker.ch
haut
Lettre de Sibérie - Dimanche à Pékin (2013)
Chris Marker, Lettre de Sibérie - Dimanche à Pékin, Paris: Tamasa / Argos Films, 2013, n.p.: livret du coffret double DVD
"La Chine, ne serait-elle pas le dimanche du monde?"
Novembre 1956, Dimanche à Pékin de Chris Marker remporte le Grand Prix du court métrage du Festival de Tours, devant douze autres concurrents dont Alain Resnais, François Reichenbach, Édouard Molinaro, Jacques Rivette ou encore Jacques Demy, pour ne citer que les plus prometteurs. Car comme l'écrit alors François Truffaut dans le journal hebdomadaire Arts: "le court métrage français se réveille enfin"1. Une nouvelle génération de cinéaste émerge qui formera dans peu de temps la Nouvelle Vague française. Et pour Truffaut, si Dimanche à Pékin est le grand vainqueur, c'est parce que cette "bande exotique vaut par le ton du récit, la beauté du commentaire et la fermeté du montage plutôt que par la qualité des image. Ce que le jury a couronné, c'est avant tout la parfaite mise en valeur d'un matériel hasardeux et forcément limité"2.
Mais revenons aux débuts de l'histoire. Dimanche à Pékin, c'est le premier film de Chris Marker distribué commercialement. Olympia 52, son premier long métrage tourné à l'occasion des Jeux olympiques d'Helsinki en 1952, n'avait pas pu être distribué, car un autre réalisateur avait obtenu l'exclusivité. Un succès d'estime cependant avait salué cette réalisation encore imparfaite, montrée dans les ciné-clubs et diffusée à la télévision.
De même, Les statues meurent aussi, co-réalisé avec Alain Resnais et Ghislain Cloquet, entre 1950 et 1952, n'avait toujours pas été projeté. Sous le coup d'une censure du gouvernement français, le film ne sera pas montré avant 1959, dans une version mutilée. La censure sera finalement levée en octobre 1964.
Aussi Marker n'a-t-il que sa seule volonté pour pousuivre sa carrière balbutiante de cinéaste. Jusque là, Chris Marker, ou plutôt Chrisian Bouche-Villeneuve, de son vrai nom, est essentiellement un écrivain, auteur d'un roman, Le coeur net (1949), d'un essai remarqué sur Jean Giraudoux (1952), de quelques traductions et de nombreux articles pour l'essentiel parus dans la revue Esprit. Il travaille également comme éditeur aux éditions du Seuil.
Évoluant dans le giron de "Peuple et Culture" et "Travail et Culture", deux associations de jeunesse socialiste issues de la guerre, il côtoie nombre d'intellectuels de gauche, dont Claude Roy et André Bazin. Et, c'est à la suite d'un voyage en Chine de Roy, effectué au début des années 1950 et décrit dans son livre Clés pour la Chine (1953), que le projet d'un nouveau voyage collectif dans l'Empire du Milieu révolutionnaire se fait jour. L'Association des amitiés franco-chinoises, liée au Parti communiste français, envoie, du 17 septembre au 3 novembre 1955, une délégation invitée au VIe anniversaire de la République populaire. Les membres de cette délégation ne sont autres que Paul Ricoeur, Armand Gatti, Michel Leiris, Jean Lurçat, René Dumont et Chris Marker, pour la plupart "amis" de la revue Esprit. Le but de ce voyage: redécouvrir la Chine, alors en pleine mutation, méconnue et non reconnue, source d'un espoir sans fin, jusqu'à ce que Mao montre son vrai visage.
À l'issue de ce voyage, la majeure partie de la délégation publiera des textes3, mais Marker se propose, lui, de rendre compte de la situation par l'image, à savoir par la photographie. Ce n'est pas l'envie d'y tourner un film qui lui manque, bien au contraire, mais le matériel. Faute de pellicule et de caméra, Marker se voit limité.
Mais cela était compter sans la chance. Et la chance, cette fois-là, prit les traits d'un jeune cinéaste français, producteur à ses heures, à savoir Paul Paviot. À l'occasion d'une réunion de l'Association française des ciné-clubs, les deux hommes se rencontrent, discutent et le miracle se produit. Paviot propose à Marker non seulement une caméra 16mm, mais également des centaines de mètres de pellicule kodachrome, devenant ainsi producteur du film les yeux fermés, au pied levé. Ne reste plus alors à Marker qu'à tourner.
Une fois sur place, se pose la question de savoir quoi filmer. La Chine est un vaste pays en pleine mutation. Tout change très rapidement. Et là, des choix s'imposent. À l'occasion de l'une de ses toutes premières interviews, accordée à Yves Benot des Lettres françaises, Marker livre quelques éléments. "J'ai été en Chine l'année dernière; sur six semaines, j'en ai passé trois à Pékin, où je m'en allais dans les rues du matin au soir, avec ma caméra d'un côté, mon appareil photo de l'autre. (...) Évidemment, j'aurais voulu montrer bien d'autres aspects de Pékin, aller filmer les usines et les ouvriers; mais cela aurait exigé des éclairages, et c'était au-dessus de mes possibilités. Alors, j'ai décidé de montrer une journée de Pékin un jour où l'on ne travaille pas - enfin où la plupart des gens ne travaillent pas. Donc, le dimanche. (...) Le problème, pour moi, c'était de me décider vite, au fil des rues et des scènes, choisir tout de suite ce que j'allais filmer ou photographier"4. En 1961, Marker précisera encore, dans sa première édition des Commentaires: "Pékin fut choisi "parce qu'il faut savoir se limiter" (pourquoi, au fait?) et Dimanche parce que les conditions du tournage, le manque d'éclairage, le manque de temps, ne permettaient pas de faire apparaître avec assez de force un élément qui joue un certain rôle dans la Chine actuelle: le travail. (...) L'auteur y faisait preuve d'une méconnaissance grandiose des lois élémentaires de la photographie, mais le coeur y était, et comme dit Giraudoux quelque part, dans le sauvetage, c'est le sang-froid qui compte, pas la nage"5.
De retour à Paris, Marker doit monter son film. Deux heures de rushes à réduire à une vingtaine de minutes. Comment s'est effectué ce choix? Marker explique à Benot "qu'il a concentré à l'extrême chaque scène, chaque aspect de ce jour de Pékin, mais sans en sacrifier aucun".
Mais à travers ces choix drastiques de sélection et de coupures, le style cinéma-topographique du jeune cinéaste prend forme. Truffaut ne décrit-il pas Dimanche à Pékin comme "la parfaite mise en valeur d'un matériel hasardeux et forcément limité"? Un style reconnaissable entre tous, très différent du style traditionnel du court métrage des générations antérieures. D'une part, Marker refuse la prééminence de l'image sur le texte et inversément. Pour lui, texte et images sont symbiotiques, inséparables, irrémédiablement liés à la production du sens.
Plus encore, le monde de Marker est un univers onirique, fantastique, où le sérieux côtoie la drôlerire sans hésitation ni confrontation. L'humour omniprésent se superpose à une ironie mordante, d'une précision tranchante et jamais gratuite.
Aussi, l'affranchissement des cadres, des codes, des normes est l'essence même de la recherche de Marker dès ses débuts. Pour lui, l'anecdotique et le subjectif prévalent sur l'objectivité du regard, toujours biaisé quelque soit l'angle que l'on prenne. L'image photographiée ou filméee est identique en ce sens où un receuil de photographies peut-être un film et inversément, un film devenir un album photographique. C'est le cas, du premier portefolio paru dans la revue Esprit à l'occasion de ce voyage en Chine, que Marker intitule Clair de Chine. En guise de carte de voeux, un film de Chris Marker6, ou encore de son moyen métrage intitulé Si j'avais quatre dromadaire (1966) qui consiste en un montage de photographies tirées de ses archives personnelles, auquel se superpose une "discussion" entre trois personnes, fictive, car totalement écrite.
En conclusion, Dimanche à Pékin est non seulement un regard particulier sur un pays en pleine révolution, un témoignage souvenir aujourd'hui du communisme balbutiant et prometteur, mais il est aussi la découverte d'un talent, d'un jeune cinéaste dont la carrière n'est pas toute tracée, mais qui pourrait devenir un grand du cinéma. Marker a séduit. Il lui reste maintenant à faire ses preuves. Et pour cela, rien de mieux qu'un nouveau voyage!
"La Sibérie: entre ours et mamouths, à défaut de chats"
Un autre évènement important, bien qu'anecdotique, a lieu à la suite de la remise du Grand Prix de Tours. Dans le train de retour vers Paris, Paul Paviot discute avec Anatole Dauman, directeur d'Argos Films, qui, enthousiaste, lui propose de participer à la production de Dimanche à Pékin, ce que Paviot accepte. Cette décision n'est pas sans suite pour la carrière de Marker, non pas tant parce que le film marche bien, mais surtout parce que Dauman va produire le prochain film du réalisateur, qui confirmera ou non son talent. Il s'agira d'un film documentaire sur la Sibérie, commandé à Dauman par l'Association France-URSS, au début de 1957.
Le contrat signé entre Marker et Argos Films donne en quelques mots les grandes lignes du projet: "les prises de vues s’effectueront en Sibérie orientale pendant toute la durée des mois de septembre et octobre 1957. Cet essai, que vous réaliserez en couleur, aura pour thème l’une des parties les moins connues de l’Union Soviétique, située aux confins de la Mongolie. L’exploration de cette région, l’étude de sa géographie humaine et économique contribuent à définir le sujet que vous vous proposez de cinématographier"7. À Marker de faire le reste. Et c’est une fois encore, dans la première édition de ses Commentaires, que l’on trouve quelques explications non seulement sur son choix de tourner ce film, mais encore sur les conditions du tournage: "L’approche de l’hiver n’est peut-être pas le moment idéal pour filmer en Sibérie. D’un autre côté, lorsqu’on a l’occasion d’aller en Sibérie, et qu’elle ne se représentera peut-être plus, comment ergoter? De même, lorsque la magnificence de trois Pieds-Nickelés8 vous permet d’envisager un long métrage, donc l’occasion d’en dire plus, peut-on s’arrêter à l’appréhension (confirmée par l’expérience) d’accoucher d’un monstre, d’un court métrage de sept bobines? Nous nous sommes donc embarqués - Pierrard, Gatti, Vierny et moi - fin août 1957, dans une aventure dont ce film et le livre de Gatti, Sibérie-moins-zéro-plus-l’infini (Editions du Seuil, vous connaissez?) donnent au moins le calque. La médaille de découvreurs, ou presque, de la Yakoutie, avait pour revers une certaine impréparation des cadres locaux au travail que nous leur demandions. De plus, nous ne jouions pas le jeu du documentaire-soviétique-d’avant-le-vingtième-congrès dont la règle était: toute image doit être, comme la femme de Staline, insoupçonnable. Positif + positif + positif jusqu’à l’infini - ce qui est au moins étrange au pays de la dialectique. D’où une certaine incompréhension, qui ne fait d’ailleurs que souligner l’exceptionnelle sportivité de nos hôtes, nous laissant, nous aidant à travailler d’une façon qu’ils ne comprenaient pas toujours, et parfois qu’ils réprouvaient. Quoi que je pense aujourd’hui de ce film, j’ai au moins une certitude: celle de ne pas les avoir trahis"9.
Le voyage semble s’être bien passé. L’ouvrage d’Armand Gatti en témoigne. Au retour, Marker passe à la phase de montage et à l’écriture du commentaire, car comme pour Dimanche à Pékin, texte et image seront indissociables. Si le titre initial du film est Baïkal, au final il devient Lettre de Sibérie. Et ce changement, lui, n’a rien d’anecdotique. En effet, en plus de l’humour, de l’ironie et de la totale subjectivité que l’on trouvait dans Dimanche à Pékin, Marker fait ici le choix du style épistolaire qui deviendra une de ses marques de fabrique. Quel meilleur moyen de raconter un pays, une contrée, une ville, un ailleurs? Pour cela, soutenu par une très vaste culture générale, Marker puise dans le recueil d’Henri Michaux, Lointain intérieur (1938), auquel il n’hésite pas à reprendre un des vers pour en rythmer le film: "Je vous écris d’un pays lointain".
Et en effet, Lettre de Sibérie est plus la description amusée et amusante d’un pays lointain, imaginaire, que le compte-rendu de voyage, à proprement parlé, d’un pays, tel qu’on le trouve dans Nanouk l’Esquimaud (1922) ou n’importe quel documentaire géographique traditionnel qui suivit. Marker respecte bien le contrat, mais à sa manière. L’étude de la géographie humaine et économique du pays n’est donc pas une succession de chiffres objectifs, ni une analyse précise et méthodique d’un mode de vie étranger, pas plus qu’une série de cartes postales de monuments célèbres, finalement mensongères, mais un mélange de scènes inattendues, de données scientifiques savamment dosées, de jeux de mots improbables, de références littéraires et historiques élégamment distilées, parsemé de dessins animés, le tout avec le concours généreux de quelques habitants sibériens à deux ou quatre pattes. Lettre de Sibérie se présente sous un ton joyeux, didactique sans être trop pédagogique ni ennuyeux, à l’image des manuels scolaires, autrement dit un ton propre à celui de l’enfance. Et bien qu’âgé de 36 ans, Marker est toujours et encore un grand enfant. Comme pour tant d’autres hommes de sa génération, grand lecteur de Jules Verne, il aborde l’U.R.S.S. non pas scientifiquement, mais avec l’innocence "présumée" de l’enfant. Pour lui, l’U.R.S.S. est avant tout le pays de l’imaginaire, un pays fascinant. Marker ne s’en cache pas. Son commentaire est des plus clairs: "Je vous écris du pays de l’enfance. C’est ici qu’entre cinq et dix ans nous avons été poursuivis par les loups, aveuglés par les Tartares, transportés avec nos armes et nos bijoux dans le Transsibérien"10. Mais, comme souvent chez Marker, cet aspect n’est qu’un niveau de lecture. Qu’on ne s’y trompe pas. Derrière ce ton, il y a un esprit critique, une intelligence en action. Rien n’est gratuit ni offert sans intention précise. Lettre de Sibérie reste un documentaire réfléchi et non dénué d’intention politique.
En effet, au milieu des années 1950, l’U.R.S.S. est un pays industrialisé, rival des Etats-Unis d’Amérique. La Guerre Froide bat son plein. Capitalistes versus Communistes: tel est l’enjeu du monde. Marker, bien que n’ayant jamais adhéré au parti, est un fervent sympathisant du communisme. Et son voyage en U.R.S.S. est aussi pour lui, et ses compagnons de route, l’occasion de voir sur place, concrètement, et non pas seulement de lire ou d’entendre ce que disent les autres, les médias, les écrivains, les cinéastes et autres intellectuels de tous horizons. Tout comme la Chine, l’U.R.S.S. est un pays gigantesque, aux confins mystérieux et inconnus des Occidentaux. Aussi Marker et sa petite équipe vont s’appliquer à rendre compte, mais plus encore à SE rendre compte de la situation réelle. Le pays du communisme, ce grand pays révolutionnaire est-il aussi moderne qu’on le dit?
C’est en ceci que Lettre de Sibérie a marqué son époque. Sous son aspect badin, empli de subjectivité, le film se dévoile comme une analyse, certes biaisée, mais critique et franche, tout autant que "vécue". On l’a vu, dès le départ, le contrat stipule qu’il devait s’agir d’un "essai" et c’est finalement André Bazin, critique français des plus écoutés et respectés, qui lui donne dès 1958, ses lettres de noblesse11. À travers plusieurs articles et adaptant librement une formule de Jean Vigo12, Bazin définit, dès sa sortie, Lettre de Sibérie comme un "essai documenté", faisant de Marker le fondateur d’un nouveau style cinématographique. "Qu’est-ce à dire? Ceci d’abord: que chez Chris Marker, ce n’est pas l’image qui constitue la matière première du film. Ce n’est pas non plus exactement le "commentaire", mais l’idée. Lettre de Sibérie est d’abord un film fait avec des idées (idées issues naturellement de la connaissance et de l’expérience directe), mais, et c’est ici que le cinéma intervient, idées articulées sur des images documentaires. Sans les images, le texte ne prouve rien, mais ce texte n’est pas non plus le commentaire des images. Il entretient avec elles un rapport dialectique et latéral. D’où une notion absolument neuve du montage. Non plus d’image à image et dans la longueur de la pellicule, mais, en quelque sorte latéral par incidence et réflexion de l’idée sur l’image. D’où, aussi peut-être, l’impression un peu déroutante de Lettre de Sibérie. Le sentiment d’une certaine pauvreté visuelle. Le luxe n’est pas pour l’oeil, il est d’abord pour l’esprit"13.
Chris Marker avait séduit avec son Dimanche à Pékin. Avec Lettre de Sibérie, il est maintenant reconnu, au même titre que ses amis et compagnons de route, Alain Resnais et Agnès Varda.
Chris Marker et le communisme
Certes Lettre de Sibérie n'a pas fait l'unanimité, à droite comme à gauche, chez les capitalistes comme chez les communistes14, mais Rohmer, qui n'aimait pas le film, a écrit avec raison: "ce film, qu'il agace ou plaise, ne laissera pas indifférent..." Malgré ses sujets, ses formats, son style, son ton, différents et non conventionnels, on le regarde, on le commente, on le critique, en bien ou en mal, on l'aime ou on ne l'aime pas. Il ne laisse pas indifférent. Il touche. Il pousse à la réflexion. Ce qui est déjà une réussite.
Cependant, pour être franc et honnête, il faut revenir sur un point: les relations de Chris Marker avec le communisme. Dans les lignes précédentes, nous avons parlé d'une analyse "biaisée" de la part de Marker. La subjectivité est certes un élément important dans son cinéma, mais elle ne doit pas induire au silence. Et parmi les critiques, Marker fut accusé d'avoir volontairement occulté, dans son film, les côtés obscurs du communisme soviétique. Les détracteurs insistèrent (et insisteront encore, à n'en pas douter), sur le fait qu'il n'est jamais fait mention, par exemple, des camps du Goulag, fondés dès 1934 et qui en 1953, à la mort de Staline, atteignaient leur point culminant, avec 476 complexes, dont une bonne partie située en Sibérie15. C'est un fait. Et Marker a très longtemps refusé de se prononcer sur ce sujet.
Or, vers la fin des années 1990, à la demande de Marker, la diffusion de ses d'avant 1962 a été suspendue, ainsi que celle de quelques films plus tardifs, dont Si j'avais quatre dromadaires (1966) et La bataille des dix millions (1970). Il s'est expliqué sur cette décision à l'occasion de la rétrospective de la Cinémathèque française de janvier 1998. "Depuis longtemps, je limite le choix des programmes qu'on a la bonté de me consacrer aux travaux d'après 1962, année du Joli mai et de La jetée, et comme cette préhistoire inclut des titres concernant l'U.R.S.S., la Chine et Cuba, j'ai capté ici ou là, avec l'émouvante empathie qui caractérise la vie intellectuelle contemporaine, l'idée qu'en fait c'était une manière de faire oublier des enthousiasmes de jeunesse - appelons les choses par leur nom: une autocensure rétrospective. Never explain, nevers complain ayant toujours été ma devise, je n'ai jamais cru utile de m'expliquer là-dessus, mais puisque l'occasion se présente, autant le dire une bonne fois: je ne retire ni ne regrette rien de ces films en leur temps et lieu. Sur ces sujets, j'ai balisé mon chemin le plus clairement que j'ai pu, et Le fond de l'air est rouge tente d'en être une honnête synthèse. Mais ici, c'est de cinématographie qu'il s'agit, et dire de la mienne qu'en ces temps anciens elle était rudimentaire serait une litote digne du général de Gaulle. D'où le piège: pour bien montrer que je ne retire ni ne regrette rien, infliger mes brouillons à un public qui se fiche complètement des règlements de compte historiques? La réponse est non. (...) On a le droit d'apprendre, il n'est pas indispensable d'étaler les étapes de son apprentissage"16. Ainsi Dimanche à Pékin et Lettre de Sibérie, d'oeuvre novatrices passent au statut de brouillons de jeunesse. On pourrait boire mot à mot ces paroles. On pourrait tout aussi bien les nier. Or, avec le temps, les connaisseurs des interviews et des données autobiographiques du Maître, savent que toute vérité dite par Chris Marker n'est pas bonne à croire. Et celle-ci en est une. Tout d'abord Marker aime à diriger son lecteur ou son spectateur ou encore son intervieweur. N'était-il pas né à Oulan-Bator, en Mongolie? Par ailleurs, l'interdiction ne remonte pas à "depuis longtemps" puisqu'en février 1991, à peine plus d'un an après la chute du mur de Berlin, Dimanche à Pékin et Lettre de Sibérie étaient encore programmés. Plus encore, si l'on regarde la carrière de Marker, on s'aperçoit qu'à partir des années 1980, il opère un changement important. La première période est très axées sur le communisme. La deuxième, qui commence avec la fondation de SLON et la réalisation du film collectif Loin du Vietnam, en 1967, l'est tout autant. Or, dès 1982, avec Sans soleil, Marker prend un virage marqué. Le communisme n'est plus au centre de ses préoccupations, du moins en apparence. L'expérience de L'aveu de Costa-Gavras et la rencontre avec Artur London y sont probablement pour quelque chose. À partir des années 1970, le communisme n'est plus ce qu'il était. Le côté obscur apparaît de tous côtés et Le fond de l'air est rouge en fait l'amer constat. Le monde alors change et le capitalisme semble avoir gagner la partie. Les années Reagan-Tatcher commencent. Marker, lui, se tourne vers le souvenir, entre la mémoire et l'Histoire.
Après Dimanche à Pékin et Lettre de Sibérie, en 1959, Marker avait entrepris un nouveau voyage. Il est l'une des rares personnes à pouvoir se rendre et photographier en Corée du Nord. De son voyage, il ne rapporte pas un film, mais un livre de photographies: Coréennes, l'un de ses travaux les plus remarquables. En mai 1997, à l'occasion d'une réédition de cet album, dans le même temps qu'il rédige l'introduction à la rétrospective de la Cinémathèque, Marker écrit une postface, dans laquelle il explique son attachement au communisme, à l'époque, tout en offrant quelques pistes permettant de comprendre son autocensure, en opposition avec son introduction.
"Qu'allions-nous chercher aux années cinquante-soixante en Corée, en Chine, plus tard à Cuba? Avant tout (et on l'oublie trop facilement aujourd'hui qu'on mélange allégrement ce qu'on a fourré dans ce concept incertain d'idéologie) une rupture avec le modèle soviétique. Ici la chronologie a son importance. (...) Encore ceci: dans l'U.R.S.S. elle-même, un frémissement se faisait sentir au milieu des années 1950, et les Moscovites d'aujourd'hui parlent avec une poignante nostalgie de ces années où la vie devenait vivable, où la terreur s'éloignait, où rien sûrement n'était gagné, mais où on pouvait envisager sans déraison une évolution vers la liberté. (...) On a beaucoup joué sur les ressemblances, indéniables, entre les deux totalitarismes, communiste et nazi. À ceci près que les uns ont commis leurs crimes en trahissant les valeurs sur lesquelles ils se fondaient, les autres en les accomplissant. Ce n'est pas une question de "bonnes intentions", c'est la différence entre un échec et un accomplissement également tragiques. Que certains penseurs disent que toutes les tragédies se valent, c'est leur affaire: un peu court pour des penseurs"17.
Ce qui fait peur à Marker dès les années 1980, c'est l'influence du temps sur l'écriture de la Mémoire collective et donc de l'Histoire. Les générations futures, faute d'un travail suffisant de mémoire, ne peuvent pas comprendre les situations passées. Les raccourcis trop tentants sont appliqués sans réflexion ni retenues. En ce début de XXIe siècle, tout comme en la fin du XXe, le communisme, réduit à Lénine, Staline, Mao, Pol Pot, Castro, la Corée du Nord etc., équivaut à "dictature", "état totalitaire", "camps" etc. Le capitalisme s'en sort mieux, car on a oublié que l'essentiel des dictatures mondiales a été mis en place par la CIA (Grèce, Brésil, Chili, Argentine, Uruguay, etc.) Aussi, si Marker s'est auto-censuré, c'est surtout et avant tout, car il savait très bien ce qui allait se passer par rapport à ses premiers films. L'oubli, l'absence de remise en contexte, la facilité d'une vision schématique et simplifiée, et tant d'autres raisons pousseront le sepctateur à réduire un film à un fait erroné ou à un point de vue criticable, alors qu'il n'en est rien. Un film, et plus encore un documentaire, c'est une vision du monde inscrite dans le Temps, et en tant que tel, il doit y être replacé quelques soient les difficultés à le faire. Marker a décidé d'agir, plutôt que de devoir guérir. Un autre exemple suffit à montrer cela: à l'occasion de la restauration du Joli mai, quelques mois avant sa mort, Marker demande à ce que l'on coupe une séquence concernant la guerre d'Algéie, car pour lui les nouvelles générations ne peuvent comprendre ce que ressentait et vivait un jeune à cette période. Une attitude discutable, mais légitime.
Aussi, pour que le spectateur soit pleinement en mesure de saisir la situation qui entoure les premiers films de Chris Marker et la vision qu'on pouvait avoir du communisme à l'époque, citons un dernier extrait: l'introduction au dossier de la revue Esprit, "Chine, porte ouverte", constitué à l'occasion du voyage en Chine de 1955.
"Il faut suivre René Dumont à travers les villages pour se faire une idée de cette révolution agraire, la plus rapide et la plus sagace de l'Histoire, qui fait passer plusieurs centaines de millions d'hommes du stade médiéval à des structures régies par les principes du marxisme-léninisme. (...) Paul Ricoeur, derrière ce qu'il a vu, esquisse une autre réalité: le mécanisme caché de la dictature. La révolution chinoise ne pouvait se faire sans violence. (...) On répondra que la Chine n'avait pas le choix à l'heure historique où, sortant d'une longue oppression, elle devait atteindre en quelques années le stade de développement technique, d'organisation sociale et politique, au-dessous duquel une nation moderne ne fait que dépérir. De fait, le capitalisme, qui eut l'occasion de fournir à la Chine les moyens de sa renaissance - les techniciens américains avaient parfaitement situé les problèmes chinois sans parvenir à leur proposer une solution - le capitalisme a échoué là où réussit maintenant le régime communiste. (...)
L'exemple chinois fascine aujourd'hui tout le Sud asiatique, séduira de plus en plus les populations misérables d'Amérique du Sud et attirera les regards de l'Afrique noire. Là encore, il faut bien voir que ne s'offre guère d'autre issue, du moins dès qu'on admet que le progrès humain, en ce siècle, exige comme condition préalable l'équipement technique moderne et la refonte radicale des rapports sociaux".
C'était en 1956, bien avant la Révolution culturelle, la guerre du Vietnam, les dictatures sud-américaines et africaines, la Perestroïka et la chute du Mur. Replacés dans ce contexte, Dimanche à Pékin et Lettre de Sibérie reprennent tout leur sens et le regard de Chris Marker son intégrité comme témoin essentiel de notre Histoire.
Christophe Chazalon
1. Truffaut fait ici référence au Groupe des XXX.
2. François TRUFFAUT, "Renaissance du court métrage français", Arts, n° 594 (21/11/1956), p. 3
3. Ils forment le dossier "Chine, porte ouverte" publié dans le n° 234 d'Esprit, de janvier 1956 (voir illustration).
4. "Un dimanche à Pékin au pas de Chris Marker. Interview recueillie par Yves Benot", Les lettres françaises, n° 647 (29/11/1956), p. 5
5. Paul Paviot, lors d'un entretien téléphonique en 2011, nous a précisé que "Clair de Chine" était le titre initialement prévu de Dimanche à Pékin.
7. Jacques GERBER, Anatole Dauman, Argos Films: Souvenir-écran, Paris: Centre Georges Pompidou, 1989, p. 154-155
8. Comprendre les trois producteurs de la societé Argos Films, Anatole Dauman, Philippe Lifschitz, Samy Halfon.
9. MARKER, 1961, p. 43
10. MARKER, 1961, p. 53.
11. Marker se définira par la suite comme un "essayiste" (cf. Jean-Louis PAYS, "Des humanistes agissant", Miroir du cinéma, n° 2 (05/1962), p. 5).
12. Jean Vigo parlait de "point de vue documenté" au sujet de son propre film À propos de Nice (1929).
13. André BAZIN, "Deux documentaires hors série: Lettre de Sibérie / Les hommes de la baleine", Radio cinéma télévision, n° 461 (16/11/1958), p. 45. Bazin a écrit sur ce film d'autres articles à l'époque pour d'autres périodiques. Le premier est "Chris Marker", France observateur, n° 443 (30/10/1958).
14. Quelques exemples: Éric RHOMER, "Lettre de Sibérie. Les hommes de la baleine", Arts, n° 695 (05/11/1958), p. 7; Luc MOULLET, "Pellicules au marbre", Cahiers du cinéma, n° 104 (02/1958), p. 61-62.
15. Référence tirée de http://fr.wikipedia.org/wiki/Goulag, d'après l'ouvrage de N.G. OKHOTINE et A.B. ROGINSKI, Sistema ispravitelno-troudovykh laguerei v SSR, 1923-1960: spravotchnik, Moscou, 1995.
16. "Marker mémoire", Images documentaires, n° 31 (1998), p. 78.
17. Traduction française tirée du site Rhizome.frk.com, d'après Coréennes, Columbus (Ohio): The Ohio State University / Wexner Center for the arts, 2008.
Coeur de chat: si Chris Marker m'était conté (2011)
Édito
Revue du Ciné-club universitaire, Genève, 09-12/2011, p. 0
Treize regards directs et indirects, inattendus, originaux ou essentiels sur l'oeuvre de Chris Marker, réalisateur français hors norme, qualifié à juste titre "d'auteur le plus connu de films inconnus".
Chris Marker, ce n'est pas seulement le réalisateur de La jetée, c'est avant tout un bricoleur de génie, tour à tour romancier, traducteur, essayiste, illustrateur, photographe, "bidouilleur" multimédia, artiste, éditeur, globe-trotter... Aussi, son travail filmé est toujours en dehors ou au-delà des normes du cinéma. Formats, durées, structures, approches sont autant de variables, souvent fonction des avancées technologiques, en perpétuelles réflexions et qui rendent quasi impossible une quelconque classification du personnage ou de l'oeuvre. Parmi les réalisateurs et réalisatrices, seul Jean-Luc Godard a une approche aussi originale. Dans une vision réductrice, on pourrait même dire que Chris Marker est au documentaire ce que Jean-Luc Godard est à la fiction.
Ce cycle d'automne du Ciné-club universitaire est réalisé en parallèle du projet Spirales. Fragments d'une mémoire collective. Autour de Chris Marker, qui se tiendra du 25 novembre au 4 décembre 2011 à Genève. Il offrira la possibilité à tout un chacun de (re)découvrir l'oeuvre de Chris Marker, simultanément à ceux des amis et collaborateurs avec qui il a travaillé tout au long de sa vie, à travers la projection de plus de septante films, de deux expositions, d'un colloque, d'un centre de documentation, d'ateliers et de plusieurs autres évènements (www.spirales2011.ch).
"Le court-métrage des années 1950: lutte pour une survie"
Revue du Ciné-club universitaire, Genève, 09-12/2011, p. 23-27
Le 26 octobre 1940, la loi de réglementation de l’industrie cinématographique supprimant le double programme, soit deux longs métrages par séance, accorde une existence officielle au court métrage. Si en théorie 3% des recettes brutes reviennent dès lors au court métrage diffusé en complément de programme, très rapidement, les distributeurs vont chercher les courts les moins chers possibles, laissant la qualité de côté. Plus encore, dans les faits, la rémunération sera plus souvent au forfait qu’au pourcentage1.
Or, non seulement le 6 août 1953, est votée une loi supprimant la rémunération automatique des courts métrages au prorata des recettes brutes, remplacées par des primes à la qualité qui concernent au maxi-mum quatre-vingts films par an, mais de plus le 21 août est voté un décret supprimant l’obligation pour les exploitants de projeter un court métrage français en avant-programme2. Deux décisions qui signent l’arrêt de mort du court-métrage.
Face à cette décision castratrice, réalisateurs, producteurs et techniciens du court métrage vont résister en créant le Groupe des Trente, qui dépassera très vite la centaine de membres. Parmi eux, on retrouve des personnes aussi chevronnées qu’Alexandre Astruc, Jacques Baratier, Yannick Bellon, Pierre Braunberger3, Jacques Demy, Georges Franju, Paul Grimault, Robert Hessens, Pierre Kast, Chris Marker, Jean Mitry4, Fred Orain5, Paul Paviot, Alain Resnais, Georges Rouquier, Agnès Varda...
Dans le manifeste du 20 décembre 1953, on peut lire: "À côté du roman ou des œuvres les plus vastes existent le poème, la nouvelle ou l’essai qui jouent bien souvent le rôle de ferment, remplissant une fonction de renouvellement, apportant un sang nouveau. C’est ce rôle que le court métrage n’a ja-mais cessé de jouer. Sa mort serait finalement celle du cinéma, car un art qui ne bouge pas est un art qui meurt. [...] Notre groupe refuse d’admettre qu’il soit trop tard. Il en appelle au public, aux organismes responsables, aux parlementaires. De la réponse qui va lui être donnée dépend l’existence des films français de court métrage"6.
La réaction est très rapide et le Groupe des Trente reçoit de très nombreux appuis. Frédéric Gimello-Mesplomb relève un passage qu’André Bazin écrit en soutien au Groupe des Trente, fort révélateur du clivage qui existait à ce moment-là: "Si le court métrage doit rester un spectacle, il doit aussi être fidèle à sa vocation expérimentale et continuer pour une part d’être le petit secteur marginal du cinéma où les exigences de l’art peuvent encore prévaloir sur celles de l’industrie. [...] Si l’on veut qu’il mérite de vivre, il faut en accepter les moyens"7.
Mais le Groupe des Trente n’est cependant pas une école esthétique. Le point principal de convergence est la bataille pour la qualité, en particulier pour le documentaire. Ce dernier est jugé généralement trop classique dans sa facture (quand il ne s’agit pas de vulgaire publicité déguisée) et surtout trop politiquement correct ou didactique. Le constat du Groupe des Trente, c’est que le documentaire classique est trop enclin à suivre la vision gouvernementale plutôt que de relater la vérité des faits. Le commentaire (ou texte) prend alors toute son importance. Et, une fois encore André Bazin intervient avec clairvoyance et lucidité, comme le remarque Dominique Bluher: "La qualité du texte – sa poésie, son ironie et sa prégnance – que Bazin admire si justement dans les commentaires de Marker, on la rencontre à l’époque également chez d’autres réalisateurs de "courts métrages de qualité" comme Georges Franju, Resnais, Agnès Varda ou Jean Rouch qui libèrent le commentaire de ses poncifs didactiques pour le doter d’une véritable autonomie par rapport à la bande-image, voire d’un statut de texte littéraire à part entière (dont témoignent aussi les nombreuses collaborations avec des romanciers)"8. Les exemples de courts métrages et de films documentaires sur l’art montrés dans le cadre de ce cycle en témoignent et illustrent à quel point les lois de 1953 allaient à l’encontre du travail en cours de certains réalisateurs, producteurs et techniciens.
Guernica d’Alain Resnais et Robert Hessens, réalisé en 1950, est un parfait exemple de court métrage documentaire orienté et intelligent9. Les positions engagées de Resnais sont bien connues, que l’on prenne Les statues meurent aussi (1952), un des rares films anticolonialistes français co-réalisé avec Chris Marker, Hiroshima mon amour (1959) sur la bombe nucléaire ou Muriel ou le temps d’un retour (1963) sur la guerre d’Algérie10. Et il n’est pas anodin de savoir que Chris Marker avait rencontré Alain Resnais à Travail et Culture, une des deux branches des mouvements d’éducation populaire français, plutôt communiste, l’autre étant Peuple et Culture, plutôt catholique, où Marker fit la rencontre d’André Bazin, avant que celui-ci ne fonde les Cahiers du cinéma. En fait, d’après l’interview que Chris Marker accorda en 1957 à Simone Dubreuilh des Lettres françaises, à l’occasion de la sortie de Dimanche à Pékin, on apprend qu’Alain Resnais suivait le célèbre Cours Simon à Paris et que tous deux ont tout de suite sympathisé. «Nous avions des manies communes: les comic strips, les chats et les films...». Et à la question de savoir comment fonctionna leur collaboration, Marker répond: "Nous avons vraiment tout pensé ensemble. Il s’est agi d’un jumelage assez rare. La première idée: un film sur l’art nègre, date de la fin de l’année 48 et du début de l’année 49. La conception du film, les recherches à travers les collections et les musées, le tournage, furent très longs. Le film ne fut prêt que fin 52"11, la même année où paraît l’ouvrage "révolutionnaire" dirigé par Doré Ogrizek, L’Afrique noire. Éthiopie, Madagascar, qui fait le point et revoit entièrement l’histoire de ce continent. Marker y écrit le chapitre "L’art nègre", dans lequel il expose noir sur blanc un postulat des plus provocateurs, véritable bombe en pleine colonisation: "Si l’on remarque d’autre part qu’on taxe rarement d’infantilisme des arts aussi étrangers à notre sensibilité que les arts de l’Orient, et que les véritables œuvres de l’instinct, celles des enfants et des fous, bénéficient généralement d’un préjugé favorable, il faut bien chercher une raison à cette innocence, à cette grossièreté, à ce fétichisme dont on pare si généreusement l’art africain pour en dissimuler la signification. Elle est simple: il fallait un alibi moral à l’esclavagisme et à la colonisation, et cet alibi ne pouvait être que celui d’une disgrâce naturelle du Nègre, être d’instinct, proche de la bête (bel animal, au mieux), juste bon à servir le Blanc. Il est difficile de faire la part du calcul et celle de l’aveuglement, mais la vérité est celle-ci: le Nègre n’était pas esclave parce qu’inférieur, il était inférieur parce qu’esclave. Et à l’appui de cet axiome qui lavait les consciences chrétiennes, tout ce qui témoignait d’une culture – différente certes et souvent choquante pour des Européens, mais cohérente et profonde – était nié ou défiguré. Et d’abord son art"12.
Le reste du chapitre est dans la même veine. En réalité, la volonté d’une certaine tendance, fortement ancrée à gauche, du cinéma et de la culture en général est alors de revoir le discours officiel sur tous les points, qui amèneront des films comme Le mystère de l’atelier quinze sur la médecine du travail ou plus tard, les On vous parle... Enfants de la guerre, les actants culturels de cette période iront sans aucun doute cracher sur les tombes de leurs parents et dirigeants en lesquels ils n’ont plus aucune confiance. Redécouvrir le monde, proche ou lointain, est le maître mot, et le faire découvrir aux autres, c’est-à-dire aux classes populaires, un devoir.
Parallèlement à cela, à la même époque, certains réalisateurs travaillent dans leur coin, en autodidactes, comme l’Espagnol José Val del Omar. Son succès sera d’ailleurs posthume puisqu’il n’est reconnu qu’en ce début de XXIe siècle13. Produits d’un bidouilleur infatigable, ses films sont d’un foisonnant génie créatif, sans égal. Marker lui-même, admiratif, a demandé à ce qu’un des films du réalisateur espagnol soit présenté lors d’une rétrospective à Barcelone.
Le dernier exemple, Le mystère Picasso, réunit deux grands maîtres de l’art peint et filmé: Pablo Picasso qui crée en direct sur des surfaces de verre (aujourd’hui détruites) et Henri-Georges Clouzot qui saisit l’instant, l’acte créateur, le geste du peintre en plein travail, en plan séquence, caméra fixe. La grande force et nouveauté par rapport au documentaire traditionnel sur un peintre, c’est que Clouzot ne considère dans son film que l’acte créatif. On n’apprend rien de la vie de Picasso, qu’il connaît depuis plus de trente ans, pas plus que de son œuvre. En réalité, la première proposition de faire un film ensemble date de 1952. Clouzot peint aussi et soumet ses peintures à Picasso ainsi qu’à Georges Braque. Il vient d’achever Le salaire de la peur, un succès public et critique, avec une Palme d’or et un prix d’interprétation masculine pour Charles Vanel à Cannes, et un Ours d’or à Berlin. "Des mésententes subsistent quant au bien-fondé de cette collaboration, notamment quand Picasso propose à Clouzot de lui écrire un scénario. Il se fait alors éconduire par le cinéaste qui lui explique qu’il est préférable que chacun reste à sa place et que c’est la rencontre entre les deux hommes qui l’intéresse, pas la substitution de leurs talents respectifs. [...] Le silence est de rigueur sur le plateau. Picasso travaille... Surtout ne pas distraire sa concentration... ainsi il en oublie presque la caméra... Il est tout entier dans son œuvre... Clouzot l’observe... Paradoxalement, ce sera justement l’objection que des mauvais esprits tenteront de lui faire: "Au fond, qu’a fait d’autre Clouzot à part dire moteur et coupez". Mais Clouzot témoigne ici d’une parfaite culture picturale. On sait qu’il peint à ses heures et qu’il s’intéresse de près aux choses de la peinture. En définitive, Le mystère Picasso est bien un film de Clouzot, il y a démontré tout le mécanisme créateur d’un artiste, il a conduit Picasso jusqu’à un degré extrême de tension et de fatigue"14.
1 La nouvelle loi du 29 septembre 1948 ne fait que confirmer cela. Sur le Groupe des Trente et les lois de réglementation de l’industrie cinématographique, voir François Porcile, Défense du court métrage français, Paris: Le Cerf, 1965.
2 Il faudra attendre 1983 pour que soit créée en France l’Agence du court métrage ayant pour but la promotion et le développement des moyens de distribution de ce dernier.
3 Principal producteur de la Nouvelle Vague avec Anatole Dauman et Georges de Beauregard.
4 Il participe en 1936 à la fondation de la Cinémathèque française, réalise plusieurs courts métrages et écrit des essais sur Ford, Chaplin, Eisenstein, René Clair.
5 Producteur entre autres des trois grands films de Jacques Tati et Des enfants du paradis de Marcel Carné, ainsi que plus d’une centaine de courts métrages de fiction.
6 Extrait édité dans Dominique Bluher et Philippe Pilard (dir.), Le court métrage documentaire français de 1945 à 1968. Créations et créateurs, Rennes: Presses universitaires de Rennes / L’agence du court métrage, 2009, p. 18 et n. 11. Cet ouvrage est une excellente introduction, avec une bibliographie fournie.
7 Arts, no 500 (26 janvier 1955), cf. fgimello.free.fr/enseignements/metz/histoire_du_cinema/groupe-des-trente.htm
8 Dominique Bluher, "Convergences et divergences: du documentaire de qualité à l’essai cinématographique", in D. Bluher et P. Pilard (dir.), 2009, p. 149.
9 Le choix du sujet à lui seul en est l’exemple, mais le traitement du sujet novateur et provocateur ne l’est pas moins.
10 Les années 1950 sont des années durant lesquelles Alain Resnais (co-)réalise ou monte de nombreux films sur l’art et la culture: 1948, Van Gogh, Oscar du meilleur court métrage deux bobines en 1949; 1950, Gauguin; 1956: Toute la mémoire du monde sur la Bibliothèque nationale de France, etc.
11 Les lettres françaises, no 664 (1957), p. 6. Sur les rapports Resnais-Marker, voir www. chrismarker.ch.
12 Chris Marker, "Art Noir", in Doré Ogrizek (dir.), L’Afrique noire. Éthiopie, Madagascar, Paris: Odé, 1952, p. 30-31.
13 Ce film a été présenté à Cannes en 1961, mais on ne connaît pas d’autres projections postérieures.
14 fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mystère_Picasso
"De la vériacité de l'information"
Revue du Ciné-club universitaire, Genève, 09-12/2011, p. 29-33
En septembre 2008, dans le magazine d’information de la Ville de Genève, Patrice Mugny, conseiller municipal en charge de la culture et ancien rédacteur en chef du quotidien genevois Le courrier, expliquait que la principale qualité du système démocratique suisse était la stabilité, mais que c’était aussi son principal défaut, car source d’immobilisme. Pour lui, ce système aboutit "régulièrement à une prééminence de l’opinion sur la politique et donc de l’émotionnel sur la raison. Ce phénomène induit une sensibilité extrême des élus à la moindre pétition, à la plus petite information relayée par la presse. Nous vivons sous le règne de l’opinion publique, laquelle est influencée principalement par l’immédiateté et l’actualité". Et de préciser encore que "le problème, c’est que nous vivons dans un monde où l’information se délite. [...] Il fut un temps où elle le faisait avec plus ou moins de pertinence, plus ou moins de succès, en y consacrant, généralement, le temps et les moyens nécessaires à recueillir l’information sur le terrain, puis à en expliquer les tenants et les aboutissants. Mais les choses ont bien changé, pour des raisons économiques essentiellement. Ainsi, la plupart des organes de presse renoncent souvent à entretenir des correspondants aux quatre coins du monde pour les remplacer par des envoyés spéciaux qui découvrent leur sujet dans l’avion et fournissent leurs premières informations à peine débarqués sur le tarmac. Sur le plan local, la tendance est également à restreindre le temps consacré à l’étude et à la mise en perspective des propositions ou des décisions politiques pour n’en relever que les aspects les plus médiatiques"1.
Et effectivement, le constat, aujourd’hui plus que jamais, c’est la toute-puissance de l’audimat qui fait du journal télévisé (ou téléjournal) un divertissement en quête de spectateurs, toutes chaînes confondues, publiques ou privées. L’information n’y est plus ordonnée en fonction de l’importance des sujets et de leur pertinence, mais en fonction de l’affect, de l’émotion qu’elle suscite auprès des téléspectateurs potentiels, spectateurs qu’il faut fidéliser coûte que coûte pour éviter qu’ils ne fuient vers la concurrence. Et pour ne pas qu’ils fuient, il ne faut pas qu’ils s’en-nuient. Et pour ne pas qu’ils s’ennuient, il faut les divertir. La boucle est bouclée. Mais un fait divers reste un fait divers, quelle qu’en soit l’horreur ou la violence (voir encadré), ce n’est pas en soit de l’information primordiale et essentielle. Le fait divers, c’est quelque chose qui se passe quelque part, si possible tout près, et qui ne changera pas le cours du monde, mais qui a le très très grand avantage de faire peur. Et quand on a peur, on est parti prenante de l’événement. "Et si cela m’arrivait à moi?" Et si cela vous arrivait à vous? Au contraire, la politique, l’économie, essentielles au confort de vie de tout un chacun, on s’en fiche! Comment se sentir impliqué dans le blabla des politiciens, dont on sait bien que "de toute façon, ils font ce qu’ils veulent"? En quoi la crise financière au Japon, à l’autre bout du monde, peut-elle bien m’intéresser? Or, bien que méritant les places d’honneur de par l’impact de leur contenu sur la société, ces derniers sujets doivent être entremêlés de meurtres, viols, enlèvements, tromperies en tout genre pour devenir digestes, pour ne pas se transformer en moments d’absence, source d’un possible cliquage télécommandé téléportant vers un ailleurs plus intéressant (une autre chaîne télévisée) pour le spectateur peu téméraire et vite ennuyé. Zapping Zone. La culture, quant à elle, est toujours reléguée (ou presque) en fin de journal, bouche trou des trente minutes officielles accordées à ce qui se passe dans le monde et près de chez soi.
Aussi, pour être sûr de maintenir un niveau d’intérêt du côté des récepteurs, les grands ordonnateurs du téléjournal, public ou privé, usent de tous les stratagèmes pour garder l’attention de leur public, en soignant surtout la présentation. Non contents de proposer pêle-mêle les différents sujets pour obtenir des "effets dynamiques", il faut en plus que l’on annonce à l’avance ce que l’on va pouvoir voir durant le programme (les fameux titres). Certaines chaînes, parmi les plus populaires, allant jusqu’à découper le journal en deux parties, avec deux sections de titres, pour les retardataires, les malchanceux de la pause pipi ou ceux qui savent qu’on s’amuse plus en général dans le second quart d’heure du téléjournal. Pour aider à la comprenette, on parasite l’image par toujours plus de paratexte: les bandeaux défilants (pour savoir de quoi il retourne, tant il est vrai que 50% de ce qui est dit est perdu, règle d’or du cinéma), les logos (pour être sûr qu’on regarde bien le bon téléjournal, on ne sait jamais, un téléspectateur en moins, c’est de la pub en moins, et de la pub en moins, c’est de l’argent en moins, et de l’argent en moins, c’est... pas bon!), l’horloge (pour une juste mesure du temps et de l’ennui, dans le pire des cas), les cartes géographiques (pour se rendre compte si c’est chez nous que ça se passe ou chez les autres, ça importe plus que ça en a l’air de savoir où ça se passe, pour un sommeil paisible), etc.
Bien sûr, tout ceci peut être discuté, voire est discutable. Pour favoriser la discussion, Chris Marker a décidé de proposer un remarquable court métrage reprenant le flash spécial du journal le plus regardé de l’Hexagone, consacré à la condamnation et à l’exécution des époux Ceausescu. Prenant bien soin de montrer qu’il ne s’agissait pas du journal original, le réalisateur commence par titrer une dizaine de fois sur fond noir "Ceci n’est pas la télévision", qu’on ne s’y trompe pas!2
Après un manque de professionnalisme journalistique télévisuel totalement voulu pour montrer l’état d’urgence de ce grand moment exceptionnel de télévision, le spectateur lit en lettres capitales à l’écran "TF1 SPECIAL CEAUSESCU: LES DERNIERES HEURES", suivi par les propos de la présentatrice: "Eh bien, ce soir, c’est la version historique intégrale du procès que nous sommes en mesure de vous présenter. Les images sont parfois cruelles, insoutenables presque, mais je crois qu’en vous les montrant ce soir, nous faisons tout simplement à TF1 notre métier, notre métier de journaliste, notre métier d’informateur. C’est la première fois au monde [un scoop donc, n.d.l.r.] qu’une télévision peut présenter un procès suivi d’une exécution, filmée de bout en bout. Alors nous ne sommes pas naïfs. Nous savons bien qu’il y a des élections dans un mois en Roumanie, que ce film bénéficiera peut-être à une tendance actuelle des partis politiques roumains. On a assez parlé de dé-sinformation pendant la révolution roumaine pour ne pas se demander si quelqu’un, en nous faisant parvenir ces images, ne veut pas se débarrasser d’un adversaire ou au contraire, conforter un ami. Je dirai qu’en tout cas, ce n’est pas notre problème". Petites coupures de Marker et la présentatrice de reprendre: "Alors nous n’avons pas voulu, pour des raisons que vous comprendrez, couper ce document par une publicité [...] Alors si vous voulez, une page de publicité tout de suite, très vite, et nous nous retrouvons après pour les dernières heures de Ceausescu". Et le journal de se poursuivre après une petite page de pub. Ainsi, sous couvertd’offrir une information essentielle, un scoop digne du meilleur journalisme, TF1, sans aucun scrupule n’a fait état que d’une "complaisance morbide" et d’un "voyeurisme des médias" des plus honteux, saupoudré de gangrène publicitaire. "Détour Ceausescu est une réponse impulsive, faite dans l’urgence, aux manipulations médiatiques d’une des révolutions les plus importantes de cette fin de siècle: la première à avoir été suivie en direct par le téléspectateur"3. La satire caustique de Marker ne s’arrête bien sûr pas là, mais en dénonçant l’attitude mercantile de TF1, accro à l’audimat et au financement publicitaire, le réalisateur montre sans ambages possible la totale dérive du journalisme et de l’information par la télévision, dans un cas certes extrême: on parle de TF1, une chaîne privée peu encline au développement culturel et intellectuel et par ailleurs première chaîne française en matière d’audimat. Nul paradoxe ici.
Pour sa part, Marcel Ophuls, dans sa Veillées d’armes, décide d’aller en profondeur, et donc de prendre le temps, dans le monde des reporters de guerre, alors en Bosnie. Un film de près de quatre heures, découpé en deux parties, cela pourrait paraître long et pourtant, Veillées d’armes se regarde sans même y penser. Avec une minutie hors du commun, Ophuls s’interroge et interroge les différents protagonistes d’une guerre toute proche de nous. Ses protagonistes n’en sont pas à leur première guerre, mais chacun a sa méthode d’approche: il y a les kamikazes qui n’hésitent pas, pour une poussée d’adrénaline, à mettre leur vie en danger et qui, de fait, rapporte une information moins officielle, mais au combien plus réelle; il y a les investigateurs qui, sans aller au combat, mais tout en prenant des risques certains, essaient de décrire le monde environnant du conflit, la vie des gens prisonniers de la guerre, et puis il y a les journalistes du dimanche (souvent les plus m’as-tu vu, ceux qui généralement parlent devant la caméra pour bien dire, j’y étais, reste à savoir où!) qui ne sortent pas de l’hôtel, se contentant de transmettre l’information officielle des armées et de ce qui se dit sur leur lieu de "résidence". Mais ce n’est là qu’une partie du propos, l’autre consiste à la remise de l’information et son traitement par les chaînes, radios ou journaux concernés. Cet intermédiaire supplémentaire n’est pas sans incidence sur l’information, bien au contraire, et même si cette dernière est de toute première qualité. En dernier recours, c’est le rédac’ en chef qui décide (ou un de ses suppléants). Les impératifs de l’audimat, du choix des images et du sujet, ainsi que du temps à disposition sont autant d’éléments déstructurants de l’information initiale et "originale". Au final, le travail d’Ophuls est absolument remarquable par la structure proposée, la réflexion offerte et le constat critique et désabusé qu’il implique.
Reste, pour conclure, à parler d’un autre court métrage de Chris Marker que la longue durée de Veillées d’armes, film ô combien essentiel pour toute personne intéressée par les médias ou le journalisme, n’a pas permis de projeter. Intitulé Le 20h dans les camps, cet autre segment de l’installation multimédia de Marker, Zapping Zone, exécutée pour le Centre Pompidou de Paris au début des années 1990 fut tourné le 13 juillet 1993 dans un camp de réfugié à Ljubljana (Slovénie). Marker montre comment de jeunes réfugiés bosniaques présentent tous les soirs un "journal télévisé" qui n’est pas diffusé sur les ondes, mais sur K7 vidéo, sans avoir rien à envier à un "vrai" journal télévisé. La particularité qui ressort et marque le travail de ces jeunes qui ont presque tout perdu, c’est leur volonté d’offrir un journal "objectif" et structuré. Aussi, travaillent-ils à partir de quatre sources d’informations d’autres journaux de provenances diverses, piratées sur la diffusion satellite. Lorsque les informations sur un même sujet sont discordantes, ils ne choisissent pas l’information qui leur paraît la meilleure ou la plus juste ou la plus assimilable par le public, ils refusent volontairement de prendre parti et offrent simplement les deux, trois ou quatre versions différentes de l’information. Le spectateur est ainsi libre de faire son propre choix sur une vérité discutée. Cet exemple est à notre sens une merveilleuse leçon de journalisme, compte tenu de la situation de ces personnes, réfugiées dans un camp d’une guerre alors encore en cours, à mille lieux des choix drastiques et dirigistes des rédacteurs et rédactrices en chef des journaux télévisés que nous pouvons voir sur nos chaînes.
1 Ville de Genéve, n° 28 (septembre 2008), p. 13.
2 Le renvoi direct à "ceci n’est pas une pipe" de La trahison des images du surréaliste René Magritte (1928-1929) est tout sauf anodine.
3 Stéphanie Moisdon, tiré de l’Encyclopédie Nouveaux Médias: www.newmedia-art.org
Trop de faits divers à la télévision? (encart, p. 32)
On dénonce souvent le relais fait par les médias des récits et des images de violence, dans la mesure où les journalistes sont soupçonnés d’attirer par ce choix un très large public. Déjà en 1977, Roger Gicquel expliquait que "c’est du fait divers qu’est née l’information" dans une analyse qu’il a tenté de faire sur la place de la violence dans l’information télévisée.
Dans l’affaire Grégory, en 1984, les journalistes ont été en partie responsables de l’emballement passionnel qu’ils ont provoqué avec cette sur-médiatisation, alors que ce drame aurait dû être cantonné aux pages des journaux locaux, au lieu de drainer sur place plus de soixante-dix journalistes venus de toute la France. Certains d’entre eux couvriront l’affaire pendant plus de dix ans.
Ainsi des événements sont choisis et isolés parce qu’ils apparaissent au journaliste comme un révélateur sociologique. Il est significatif, de plus en plus souvent, qu’ils soient traités dans les rubriques "Société" des journaux dits "sérieux". Ainsi, lorsque Le Monde ou Libération traitent un fait divers, c’est parce qu’ils le jugent exemplaire d’une certaine réalité sociale qu’ils veulent faire ressortir.Leur traitement médiatique a aussi été au cœur de la polémique autour de l’élection présidentielle et du passage de Le Pen au premier tour. Les médias ont-ils trop parlé des faits divers et de violence? Le doute a éclaté lorsque le député PS Julien Dray a accusé TF1 d’avoir "une part particulière de responsabilité" dans l’exacerbation du sentiment d’insécurité.
À la suite de quoi, Le Monde a pris l’initiative de réaliser une étude sur le nombre de sujets traitant de l’insécurité diffusés sur les télés et radios nationales et régionales. Entre le 7 janvier et la date du second tour des élections 2002, 987 sujets "faits divers-police-justice" par semaine ont été diffusés sur les soixante-cinq médias étudiés. Ce qui fait que du 1er janvier au 5 mai 2002, l’insécurité a été médiatisée deux fois plus que l’emploi, huit fois plus que le chômage, alors que, d’après les estimations du ministère de l’Intérieur, aucune augmentation sensible des crimes et délits n’a pourtant été constatée sur cette période...
Emission C dans l’air de France 5 (7 mars 2003)
web.archive.org/web/20080614214221/france5.fr/cdans-lair/D00063/274/81583.cfm
"Nostalgie de la mémoire"
Revue du Ciné-club universitaire, Genève, 09-12/2011, p. 39-41
Souvenirs, souvenirs. Le souvenir est un fragment de mémoire perdue, un fragment qui fortuitement ou par l’effet d’un rappel volontaire, revient à l’esprit, en un instant, donnant à l’individu un semblant d’existence à travers la continuité de l’espace-temps et nourrissant la nostalgie d’un passé révolu et généralement regretté. Le souvenir n’est pas qu’une image, un objet, une musique, il est aussi toutes les émotions qui l’accompagnent1. La célèbre madeleine de Proust en est l’un des plus remarquables exemples: "La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse goûté; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d’autres plus récents; peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé, les formes – et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot – s’étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir"2. Et ce n’est pas un hasard si Chris Marker a intégré cet extrait dans son autobiographie interactive Immemory3. De la même manière qu’un goût avait fait ressurgir le passé enfoui de Marcel Proust, c’est une image (ou plus exactement deux images liées) qui permet au héros de La jetée (1962) de retrouver son enfance, tel que le précise la première phrase du film, à la fois écrite sous forme d’un titrage et à la fois dite par le narrateur en voix off: "Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance". En fait, si c’est la violence de la mort de l’homme qui marqua la mémoire du protagoniste enfant, c’est surtout le visage de la femme qui va lui permettre de "réintégrer" le temps passé, comme le confirme le narrateur en expliquant que: "rien ne distingue les souvenirs des autres moments, ce n’est que plus tard qu’ils se font reconnaître... à leurs cicatrices. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s’il l’avait vraiment vu ou s’il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir".
Or, au lieu de raconter une histoire sous forme de flashbacks sur le modèle de Citizen Kane d’Orson Welles, des Fraises sauvages d’Ingmar Bergman ou encore de Casablanca de Michael Curtiz, pour ne citer que quelques exemples, Chris Marker utilise le souvenir comme un moyen technique de voyage dans le temps. Le héros ne se souvient pas à proprement parler, mais il est projeté physiquement, réintégré dans une certaine mesure "réellement" dans son propre passé, le but étant finalement de le projeter dans le futur pour aller chercher un moyen de sauver le monde. La prégnance du visage de la femme, si forte dans sa mémoire, doit lui permettre de la retrouver dans sa vie d’enfant. Ce n’est qu’une fois que son corps et son esprit seront accoutumés aux procédés du voyage qu’il pourra aller vers le futur dans lequel il n’a aucun souvenir. Car l’expérience n’est pas sans danger. Pour les cobayes de ces voyages dans le temps, "se réveiller dans un autre temps, c’est renaître une seconde fois, adulte" et le choc est souvent trop fort, entraînant la démence ou la mort. Seul un souvenir suffisamment marquant peut permettre ce voyage temporel.
De son côté, Millenium Actress (2001), anime réalisé par le japonais Satoshi Kon, suit une réflexion un peu différente. Tout comme Proust, il utilise un objet, une clé, qui sert de catalyseur pour un retour dans le passé. Mais là encore, le stratagème est différent. Les protagonistes ne sont pas réellement renvoyés dans leur passé, mais la narration et le film mêlent tour à tour l’instant présent (l’interview de Chiyoko Fujiwara, célèbre actrice âgée de septante ans, recluse dans une retraite dorée), le passé (par l’intermédiaire de ses souvenirs, qui s’avèrent être tous reliés à la recherche d’un peintre qu’elle a aimé adolescente et qui lui a remis la clé en gage de lien) et enfin, la fiction (soit les films dans lesquels Chiyoko Fujiwara a joué). Le plus étonnant, c’est que l’actrice n’est pas la seule à être projetée dans ces trois espaces-temps fictifs ou réels; elle emmène avec elle le journaliste Genya Tachibana, un ancien technicien de plateau épris d’elle, et un jeune cameraman qui fait son travail et qui n’est pas toujours d’accord de voyager d’un "tableau" à l’autre au risque de sa vie.
Le tour de force de Millenium Actress, ce n’est pas la qualité de l’animation, jugée moyenne pour un anime, mais la narration. Tout comme pour La jetée, Satoshi Kon nous offre un kaléidoscope visuel entre passé, présent et fiction d’une fluidité telle que le spectateur ne sait pas plus que les protagonistes à quel moment il s’agit de la réalité présente du tournage, d’un souvenir de la vie de Chiyoko ou d’un extrait d’un de ses films. Seule une multitude de petits détails permettent, au moment voulu, de relier les événements et de ne pas être finalement perdu dans ce flot continu du temps. Aussi "ce que dit Satoshi Kon sur le cinéma, ce n’est pas que c’est un divertissement, qu’il nous éloigne de la réalité, au contraire, il imprègne notre réalité, il en est un élément. Vie et œuvres artistiques sont si liées qu’il est impossible de les dissocier. Chacun nourrit l’autre"4.
La clé, tout autant objet que fil conducteur abstrait, est celle du souvenir, de l’amour, de cette passion d’enfance qu’une jeune fille pas encore actrice voue à un jeune peintre poursuivi par la police. Mais c’est aussi la clé du souvenir du journaliste Genya Tachibana amoureux de Chiyoko Fujiwara, une clé qu’il a gardée précieusement après avoir été perdue sur un plateau de tournage. Les souvenirs des deux protagonistes se mêlent alors et se font écho, sous le regard d’un troisième protagoniste externe qui contrebalance par petites touches l’irréalité du passé par une objectivité rationnelle du présent.
Aussi, comme l’a très bien exprimé Simone Signoret, amie d’enfance de Chris Marker, dans son autobiographie La nostalgie n’est plus ce qu’elle était: "Ce ne sont pas mes souvenirs qui ne m’appartiennent pas, c’est ma vie! Je considère qu’on n’est fait que par les autres, et à partir du moment où on se raconte, on raconte les autres. Même les options qu’on peut prendre dans la vie sont toujours dues à quelqu’un d’autre, à une rencontre ou au fait qu’on veut être à la hauteur de l’opinion de quelques-uns"5.
1 Le documentaire Afghan Memento (2010) du Suisse Jacques Matthey illustre parfaitement ce point. Il raconte l’histoire d’Olivier Brodard qui, au retour d’un périple humanitaire en Afghanistan, perd la mémoire à la suite d’un accident de voiture. Après un coma de plusieurs semaines et une rééducation, il retrouve le carnet de voyage qu’il avait tenu durant son périple et des photos. Grâce à ce dernier, il peut se reconstruire, "retrouver" des souvenirs, mais en dehors de la photo ou du texte, il explique qu’il n’y a nulle émotion. Rien avant, rien après, quand bien même il sait que c’est lui qui est sur la photo, que c’est SON souvenir.
2 Extrait du livre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swan (1913).
3 gorgomancy.net/intro.html
4 www.oomu.org/milleniumactress.html.
5 Paris: Le Seuil, 1976, p. 13.
"Django et le jazz manouche"
Revue du Ciné-club universitaire, Genève, 09-12/2011, p. 47-50
Au tout début de son autobiographie La nostalgie n’est plus ce qu’elle était, Simone Signoret, née en 1921, raconte son adolescence au cours secondaire, réservé aux filles, en parallèle du Lycée Pasteur accessible aux seuls garçons, quand bien même les professeurs qui enseignaient dans les deux établissements étaient les mêmes. Parmi le cercle d’adolescents qu’elle fréquente alors, il y a Chris Marker déjà1. Tout le monde "se retrouvait à midi, à la sortie des cours, sur l’avenue du Roule, devant une petite boutique de journaux qui s’appelait "Au sabot bleu", signalée par une énorme enseigne. On n’allait pas au café, cela ne se faisait pas du tout à l’époque. On n’avait pas le droit non plus de traverser la rue: les garçons n’avaient pas le droit de passer sur le trottoir des filles, ni les filles sur le trottoir des garçons. Le point de ralliement, c’était le "Sabot bleu", et de là commençaient des balades qui allaient de la rue d’Orléans jusque devant le magasin Julien Damoy. On faisait les cent pas, on parlait... On parlait d’abord et surtout de Charles Trenet: tous les garçons s’étaient acheté des chapeaux, des chemises bleues et des cravates blanches. Trenet, c’était terriblement important2. Et le Hot Club3. À la Maison de la Chimie4 se donnaient les premiers concerts avec Django"5.
Poursuivant la lecture, on découvre une seconde mention de Django faite par Simone Signoret à l’occasion de la tournée de chant en URSS, de son mari Yves Montand, en 1956. Le contrebassiste Emmanuel Soudieu était du voyage. "Avant d’être le contrebassiste de l’orchestre, écrit-elle, Soudieu avait été celui de Django". Mais Django était mort le 16 mai 1953 d’une attaque cérébrale, à l’hôpital de Fontainebleau.
Témoignage direct d’une époque révolue, l’autobiographie de Simone Signoret met en évidence les vedettes principales de ces années d’après-guerre aux yeux de la jeunesse: Charles Trenet "l’homme de la radio et du disque", formé à l’école du café-concert et du music-hall, pour la chanson française, et Django Reinhardt, le musicien des caves de Saint-Germain, idole d’une génération, pour le renouveau du jazz européen.
Ces images pourraient facilement être des images d’Épinal si n’existaient des témoignages, des écrits, des films pour maintenir la légende.
En fait, Django Reinhardt, célèbre guitariste et "inventeur" du jazz manouche, est avant tout un membre de la tribu des gens du voyages6 comme le montre le film de Paul Paviot. Tourné en 1957, ce documentaire est considéré comme LA biographie de Django Reinhardt, avec les seuls extraits filmés existants de Django jouant de la guitare. Le commentaire dit par Yves Montand est écrit par Chris Marker, avec une préface de Jean Cocteau qui décrit tout autant le mode de vie des Roms que celui de Django:
"Django mort, c’est un de ces doux fauves qui meurent en cage. Il a vécu comme on rêve de vivre: en roulotte. Et même lorsque ce n’était plus une roulotte de romanichel, c’était encore une roulotte. Son âme était ambulante, et sainte. Et ses rythmes lui étaient propres à l’exemple des rayures du tigre et de sa phosphorescence. Elles habitaient sa peau. Elles le rendaient royal et invisible aux chasseurs. Mais les chasseurs finissent toujours par abattre les doux fauves qui ne veulent de mal à personne. Et parmi les chasseurs il y a la fatigue, cet ogre parisien qui nous dévore. Django se dépensait pour tous avec la générosité gitane, il jetait son or par la fenêtre et cet or n’était autre que lui"-
Car la grande particularité du peuple rom, ce n’est pas son nomadisme, point essentiel de sa discrimination qui valut à ses représentants d’être exterminés dans les camps nazis au même titre que les Juifs, les homosexuels, les communistes, les opposants... Non! La grande particularité des Roms, c’est leur générosité face à la vie, leur amour de la vie et de la nature qui nous entoure. Cette insouciance, cette désinvolture qui en découle, cette attitude libertaire du non-possédant, c’est ce qui fait peur aux non-Roms, aux Autres. En tout lieu et en tout temps, "leurs valeurs et leur mode de vie différents les ont toujours soumis aux pressions assimilatrices de la population majoritaire". Aussi les Roms ont-ils du mal à s’intégrer, à s’assimiler où qu’ils soient, laissant en leur être une plaie béante qu’ils ne peuvent refermer, si ce n’est par la musique. Car la musique manouche, dont Django est, sans conteste possible, le plus grand représentant, lui qui a insufflé un nouveau souffle à tout un art, cette musique, malgré son allégresse apparente, n’exprime pas la gaîté des Roms, leur goût pour la vie, mais bien au contraire: "c’est une musique qui crie la peur et la douleur d’un peuple qui a mal à son âme. C’est pour ça que la musique tsigane est belle. Sinon musicalement elle part dans tous les sens, c’est plein de fausses notes, les instruments sont bricolés avec n’importe quoi. Mais cette musique est un cri de douleur, de douleur ancestrale qui vient de l’âme de tout un peuple. C’est la révolte pure, rien n’est fabriqué, tout est crié"7.
Cette vision est celle d’un autre chantre rom, à savoir Tony Gatlif, le seul aujourd’hui à pouvoir parler de ce peuple et à obtenir une oreille attentive de la part des Autres. Ce réalisateur français d’origine kabyle et gitane s’évertue au travers de ses films à décrire la diversité du peuple tsigane et tout particulièrement les multiples facettes de la musique gitane. De Latcho Drom (1993) – documentaire où l’on suit musicalement le périple gitan partant de l’Inde, d’où ils sont originaires, et se poursuivant en Égypte, en Turquie et en Roumanie pour finir en Andalousie – à Swing (2002) qui confronte Max, un jeune garçon français, à un enfant manouche de son âge qui l’initie à la musique, à une autre culture et à l’amour, en passant par Gadjo Dilo (1997) consacré aux Tsiganes de Roumanie, ou Vengo (2000) sur les influences arabes et espagnoles du flamenco des gitans d’Andalousie, Gatlif explore, décrit, chante et honore le peuple rom4.
Dans Swing, il s’arrête sur l’héritage de Django, sur ce qui fait la force et la particularité de cette musique issue de l’Amérique noire, du jazz de Duke Ellington à Charlie Parker, de Louis Armstrong à Thelonious Monk.
L’exemple de Django est d’autant plus fort que, malgré les adversités de la vie, il parvient à force de volonté et de courage à toucher au génie. En effet, le 26 octobre 1928, sa roulotte prend feu et Django est gravement atteint à la jambe droite et à la main gauche. "Celle-ci cicatrisant très difficilement, il reste près de 18 mois à l’hôpital". Les médecins sont septiques quant à sa possibilité de rejouer de la guitare. Malgré la perte de l’usage de deux de ses doigts, Django s’obstine, travaille sans relâche et, après six mois, développe une nouvelle technique de jeu, confirmant ainsi qu’un Rom peut vivre sans maison ni terre, mais ne peut vivre sans musique.
1 Tous deux sont nés en 1921.
2 Dans l’édition de 1954, de l’ouvrage collectif Regards neufs sur la chanson, l’importance de Charles Trenet pour la chanson française et auprès des jeunes de l’époque est unanime: si Brassens, Mouloudji, Léo Ferré, Juliette Gréco, les Compagnons de la Chanson sont parvenus à interesser un vaste public, "c’est parce qu’avant le "Fou Chantant" avait désencanaillé, désembourgeoisé, assoupli, perfectionné, libéré ce magnifique moyen d’expression: la Chanson de France" (p. 7-8). Trenet trouvera un digne successeur avec Yves Montand, mari de Simone Signoret et grand ami de Chris Marker, et auquel les pages 91-98 sont consacrées.
3 Il s’agit du Hot Club de France, quintette de jazz fondé en 1934 par Stéphane Grappelli, Louis Vola, Django Reinhardt, son frère Joseph et Roger Chaput. Ils transforment le jazz américain en une nouvelle forme, le jazz manouche, qui remporte un succès immédiat dans toute l’Europe et surtout dans les caves de Saint-Germain à Paris, dont il devient un des symboles auprès de la jeunesse.
4 La Maison de la Chimie est un lieu de congrès et de conférence créé en 1934 dans le 7e arrondissement à Paris.
5 Paris: Le Seuil, 1976, p. 32-33.
6 Cette expression est utilisée afin de ne pas désigner une catégorie spécifique de Roms présente sur le territoire français. Dans la pratique administrative, l’expression est souvent employée pour désigner les Tsiganes de France, bien qu’ils ne soient itinérants que pour environ 15% d’entre eux, et que, parmi la population itinérante en France, ils ne soient qu’une minorité.
7 Extrait de la bande originale de Gadjo Dilo de Tony Gatlif.
8 Définitions tirées de www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/tsiganes.htm. Voir aussi Michel Malherbe, Les langages de l’humanité, Paris: Robert Laffont, 1995, p. 197-198.
"Tourner un film selon Chris Marker"
Revue du Ciné-club universitaire, Genève, 09-12/2011, p. 51-53
Cette séance du Ciné-club est réalisée en collaboration avec le projet Spirales. Fragments d’une mémoire collective. Autour de Chris Marker, intégrée dans une journée spéciale Japon comprenant trois séances: la première projette Narita: le printemps de la grande offensive, film collectif sur la lutte paysanne contre l’agrandissement de l’aéroport de Tokyo, et Kashima Paradise, co-réalisé par Yann Le Masson et Benie Deswarthe, avec un texte de Chris Marker, qui porte sur une autre lutte populaire japonaise des années 1970 contre l’installation d’une industrie à Kashima. La deuxième séance propose Sans soleil, l’un des films majeurs de Chris Marker, dans lequel le réalisateur réfléchit à ses thèmes de prédilection: la mémoire, le souvenir, l’Histoire et son écriture, par l’entremise de lettres d’un cameraman free-lance qui "s’interroge sur la représentation du monde dont il est en permanence l’artisan, et le rôle de la mémoire qu’il contribue à forger", en prenant pour centre d’intérêt deux "pôles extrêmes de la survie": le Japon et la Guinée Bissau / les îles du Cap Vert.
Le Japon, et plus précisément Tokyo, sont au centre de cette séance, mais ce n’est point là l’essentiel. Le Japon y est ici un prétexte. Ce qui importe avant tout, c’est le travail de création et de réflexion, à l’image du cameraman free-lance. Comme l’a très bien montré Bernard Eisenschitz, "les films de Marker n’existeraient pas si n’était à chaque fois trouvée la solution technique, donc narrative, seule possible et qui rend unique l’histoire racontée"1. Et Marker lui-même s’en explique on ne peut plus clairement dans le livret du DVD regroupant La jetée et Sans soleil: "La pauvreté des moyens qui est (au moins dans mon cas) plus souvent question de circonstances que de choix, ne m’a jamais paru devoir fonder une esthétique, et les histoires de Dogme me sortent par les yeux. C’est plutôt à titre d’encouragement pour jeunes cinéastes démunis que je mentionne ces quelques détails techniques: le matériel de La jetée a été créé avec un appareil Pentax 24/36 et le seul passage tourné "cinéma", celui qui aboutit au battement d’yeux, avec une caméra 35 mm Arriflex empruntée pour une heure. Sans soleil a été tourné intégralement avec une caméra Beaulieu 16 mm, muette (il n’y a pas un plan synchrone dans tout le film) avec bobines de 30 mètres – 2’44’’ d’autonomie! – et un petit magnétophone à cassettes – même pas un walkman qui n’existait pas encore"2. Pour Tokyo Days, fragment de l’imposante installation multimédia Zapping Zone du Centre Pompidou à Paris, il s’agit d’une simple caméra vidéo. Marker filme caméra à l’épaule, comme un touriste, allant de droite à gauche, à hauteur d’homme, dans une apparente simplicité, déambulant dans les rues aux côtés de son amie Arielle Dombasle qui raconte ses dernières péripéties, sautant du coq à l’âne, pour le plus grand plaisir amusé des spectateurs. C’est ça le cinéma. Chris Marker l’explique noir sur blanc dans une de ses rares interviews accordées aux journalistes: "la démocratisation des outils affranchit de beaucoup de contraintes techniques et financières, elle n’affranchit pas de la contrainte du travail. La possession d’une caméra DV ne confère pas par magie du talent à celui qui n’en a pas ou qui est trop flemmard pour se demander s’il en a. On pourra miniaturiser tant qu’on veut, un film demandera toujours beaucoup, beaucoup de travail. Et une raison de le faire. C’est toute l’histoire des groupes Medvedkine, ces jeunes ouvriers qui dans l’après-68 entreprenaient de faire des petits sujets sur leur propre vie, et que nous tentions d’aider sur le plan technique, avec les moyens de l’époque. Qu’est-ce qu’ils râlaient! “On rentre du boulot et vous nous demandez encore de bosser...” Mais ils s’accrochaient et il faut croire que là encore, quelque chose a passé, puisque trente ans plus tard on les a vus présenter leurs films au festival de Belfort, devant des spectateurs attentifs. Les moyens de l’époque, c’était le 16 mm non synchrone, donc les trois minutes d’autonomie, le laboratoire, la table de montage, les solutions à trouver pour ajouter du son, tout ce qui est là aujourd’hui, compacté à l’intérieur d’un bidule qui tient dans la main"3.
Avec Tokyo Days, Marker ne fait rien d’autre que de concrétiser ce qui est dit ci-dessus. Pour faire un film, il faut un minimum de moyens et une idée, soit quelque chose à dire ou à montrer. Et le Japon est un terrain fertile pour un Occidental, ou plutôt un non-Japonais, dans la mesure où la culture japonaise offre de nombreuses images relativement "exotiques" suffisamment attractives et qui font sens par elles-mêmes, du moins en apparence. Cependant, dans son ouvrage Le dépays, recueil de textes et de photos sur le pays du Soleil levant, Marker met en garde: "inventer le Japon est un moyen comme un autre de le connaître. Une fois dépassées les idées reçues, une fois contournée l’idée reçue de prendre le contrepied des idées reçues, mathématiquement les chances sont les mêmes pour tous, et que de temps gagné. Se fier aux apparences, confondre sciemment le décor avec la pièce, ne jamais s’inquiéter de comprendre, être là – dasein – et tout vous sera donné par surcroît. Enfin, un peu"4.
C’est ce qu’ont bien compris Pascal Greco et Charles Hieronymi dans leur film Tokyo Streets. Grâce à une bourse de la Confédération suisse de quelques milliers de francs obtenue dans le cadre d’un autre projet au Japon, le voyage à Tokyo a été possible. Une caméra DV Canon grand public achetée d’occasion trois jours avant le départ et une idée en tête: filmer la mode au Japon, un sujet pourtant déjà bien exploité, que ce soit le cosplay ou les takenoko. Arrivés sur place, tournage un peu au hasard des rues, "au petit bonheur la chance", et la chance, ils en ont eu, car la rue s’est trouvée remarquablement riche en événements et en matériel. À cela les deux réalisateurs en herbe, autodidactes, grâce à quelques contacts, ont pu ajouter quelques séquences de défilés de mode tournés sur place durant le séjour et ont même organisé une séquence de shooting photo, en extérieur avec un modèle, coiffée et maquillée par un professionnel suisse s’étant installé à Tokyo, dans l’idée de faire l’affiche du film qu’ils étaient en train de tourner. Le résultat final, malgré le peu de moyen, est remarquable. La séquence de shooting, même si elle a connu quelques petits déboires ou surprises tantôt bonnes, tantôt mauvaises, donne un résultat qui résume à lui seul le projet, faisant la transition entre la mode de la rue et la mode des podiums.
Tokyo Streets apparaît comme un parfait exemple de la vision de Marker décrite précédemment. Même si politique ou revendication sociale, qui devaient "faire de la caméra une arme", ne rentrent pas en ligne de compte ici, la mode ne pouvant être politique, le regard porté par Greco et Hieronymi sur une culture trop différente pour être assimilée ou comprise sonne juste et fait écho dans les consciences par la simplicité de leur traitement. Or, la simplicité n’est ici qu’apparence, car en effet, s’il était aussi simple de filmer dans la rue, nous serions submergés d’images de qualité, ce qui n’est de loin pas le cas.
En conclusion, faire un film, selon Marker, cela se résume en trois points accessibles à tout un chacun, pour un peu qu’on fasse un effort: un matériel de prise de vues, une idée et du travail, auxquels on ajoutera un zest de courage pour se lancer et une dose de chance, incontournable pour réussir.
1 "Chris Marker. Quelquefois les images", Trafic, n° 19 (été 1996), p. 48.
2 Extrait du livret du DVD La Jetée / Sans soleil, réédité dans le journal Libération du 5 mars 2003.
3 Interview par Samuel Douhaire et Annick Rivoire parue dans le journal Libération du 5 mars 2003.
4 Le dépays, Paris: Herscher, 1982, p. 2.
"La mer et les hommes"
Revue du Ciné-club universitaire, Genève, 09-12/2011, p. 59-62
Île de Sein, Bretagne, l’hiver, tel est le sujet du film La mer et les jours (1958) de Raymond Vogel et Alain Kaminker, une chronique du temps qui passe ou comment des hommes, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, décident de vivre dans des conditions extrêmes, perpétuant les traditions, luttant ensemble contre l’océan, ce même océan qui assure leur subsistance. Un rapport de force, un respect raisonné face aux éléments impitoyables pour atteindre une forme d’harmonie bien loin des côtes du continent sur lequel on ne se rend jamais si ce n’est par urgence, par incontournable obligation. La communauté de l’île de Sein sait ce qu’elle peut retirer de la mer tout autant que ce qu’elle peut y perdre. Le réalisateur du film, Alain Kaminker lui-même, est mort sur le tournage, noyé en achevant les prises de vues en mer1. Face aux dures conditions de vie, tout particulièrement en plein hiver où les tempêtes se succèdent et s’acharnent contre ce minuscule bout de rocher, le parfait équilibre ainsi élaboré sur des coutumes ancestrales est montré avec simplicité et admiration, dans une facture on ne peut plus classique du documentaire. Mais de leur côté, les hommes sont tout autant acharnés et s’obstinent à vivre dans ce territoire si peu hospitalier au regard de l’homme du continent.
En parallèle à La mer et les jours, Vive la baleine (1972) de Mario Ruspoli et Chris Marker, tourné après la fulgurante croissance économique des années 1960, relate la parfaite symbiose qui existait entre l’homme et la mer avant que le Capital ne montre le bout de son nez. La chasse à la baleine était alors un besoin pour la survie des communautés du Grand Nord2. Dans un premier temps, l’homme respectait la nature, ne prenant que le strict nécessaire, sans gâchis aucun et au prix de risques immenses, n’hésitant pas à mettre la vie des pêcheurs en danger de mort. Avec l’ère de l’industrialisation de la seconde moitié du XIXe siècle et en particulier avec l’apparition du canon-harpon, du harpon explosif et des bateaux à vapeur, la pêche ne fait que s’intensifier par pur goût du profit, décimant la faune marine sans discernement jusqu’à la quasi-extinction de ces mammifères géants aujourd’hui plus que jamais en voie de disparition. Le regard offert par Marker et Ruspoli est cependant d’une objectivité relative, fruit du bon sens et dénué d’effets spectaculaires, montrant simplement, mais avec efficacité, la perte d’humanité consécutive aux progrès techniques.
Une trentaine d’années plus tard, The Cove de l’Américain Louie Psihoyos est un film plus ambigu. Dénonçant dans un pamphlet documentaire, défini comme acte militant, le massacre des dauphins dans le Japon du XXIe siècle, ce que l’on ne saurait lui reprocher, The Cove n’en laisse pas moins perplexe, tirant sur la corde sensible, au contraire des films précédents. En effet, Psihoyos montre, non sans mise en scène et de manière brouillonne, l’horreur des massacres perpétrés en toute impunité sur l’île de Taiji, ne lésinant pas sur les moyens pour dénoncer ces vils pêcheurs japonais cupides et insensibles, soutenus par la police et les politiciens locaux ou gouvernementaux3.Or, le choix du sujet et son traitement, qui ont ravi le comité des Oscars, n’est pas anodin. Le sujet est porteur. Qui n’aime pas les dauphins, mammifères intelligents, joueurs et attachants? Qui peut subir un tel spectacle sans s’émouvoir? La véritable question est cependant ailleurs. En effet, le film montre le massacre touchant annuellement 23’000 dauphins dans la baie de Taiji, mais le spectateur sait-il que les abattoirs américains à eux seuls tuent plus de 23 millions d’animaux par jour, soit 16’000 par minutes, ou que l’homme consomme annuellement plus de 53 milliards d’animaux, chiffres qui ne cessent de croître4? Poulets, canards, porcs, lapins, dindes, moutons, chèvres, bovins et chevaux, en oubliant les poissons et crustacés, coquillages et autres fruits de mer, autant d’animaux exploités sans aucune (ou presque) considération du public. Or, sur les 92 millions de tonnes des captures globales de la pêche en 2006, 82 millions de tonnes provenaient des eaux marines, dont les principaux producteurs sont, dans l’ordre, la Chine, le Pérou et les États-Unis d’Amérique5. Alors les "barbares" japonais ont bon dos: têtes de turc, ils sont une cible facile.
En fait, l’élevage "en batterie" de tous ces animaux, leur abattage par électrocution ou suivant des rites religieux ou traditionnels peu scrupuleux du bien-être de l’animal ne sont, et de loin, pas la préoccupation première de tout un chacun. Qu’en est-il par exemple du poisson compressé à en avoir les arrêtes broyées, pêché qu’il est dans les gigantesques filets dérivants des bateaux usines occidentaux battant pavillon de courtoisie? Ou du saumon d’élevage canadien, norvégien, écossais ou d’Alaska, asphyxié à l’air libre ou sur la glace, les branchies découpées sans avoir au préalable été assommé? Ou encore des grenouilles "françaises" en provenance d’Indonésie entassées à 300 par sac, éviscérées vivantes avant d’avoir les cuisses arrachées à vif? Ou des poulets dhabiha halal ou casher égorgés sans être préalablement étourdis? Ou encore des 100’000 albatros annuellement capturés et tués par "effet collatéral" dans les filets de pêche des bateaux usines? Effectivement, un poisson, animal au sang froid, ne crie pas, pas plus qu’une grenouille, les albatros ne "servent à rien" et les poulets ne sont pas aussi sympathiques que les dauphins6, on ne va pas les voir le dimanche faire des tours et jouer devant un public ébahi. Pourtant, la procédure est la même: tuer pour commercialiser, si possible dans des barquettes sous cellophane, sans tête ni yeux pour faire oublier aux consommateurs qu’avant d’être un steak, un filet, une cuisse, il s’agissait d’un être vivant, dont la surproduction ne répond plus, et de loin, aux besoins élémentaires de la survie seule à pouvoir légitimer son abattage.
En ce sens, le film de Psihoyos est certes un film qui dénonce la barbarie de l’homme déshumanisé dans des vues mercantiles, mais le choix du sujet tout autant que son traitement sont dignes du journalisme spectaculaire et grandiloquent de ce début de XXIe siècle, ayant pour seul véritable but le succès de l’audimat. Et ça marche! On est bien loin d’un cinéma réfléchi et critique, tel que le proposait Chris Marker et ses complices, pour lesquels la dénonciation s’attachait à un tant soit peu de scrupules et relativisait les faits en vue d’une information tendant à l’objectivité. Le cinéma documentaire grand public d’aujourd’hui doit avant tout se vendre, dénonçant la paille dans l’œil du voisin plutôt que la poutre qui se trouve dans le sien, et évitant les véritables questions susceptibles de changer la société et ses modes de fonctionnement.
Christophe Chazalon
1 Avant-Scène Cinéma, n° 68 (1967), p. 61. Le scénario est édité p. 61-66, avec un portfolio.
2 Mario Ruspoli avait préalablement publié en 1955 À la recherche du cachalot (Éditions de Paris), suivi l’année d’après d’un long métrage de 90 minutes en 16 mm destiné à "Connaissance du Monde", qui devint ensuite un court métrage de 28 minutes en 35 mm intitulé Les hommes de la baleine. Ce film passa en avant-programme de Lettre de Sibérie de Chris Marker dans son intégralité, puis amputé avec À double tour de Claude Chabrol. Le scénario est édité dans Avant Scène Cinéma, n° 24 (1963), p. 46-51, accompagné d’un portfolio.
3 Nous n’approuvons pas ces massacres, qui par ailleurs ont lieu en d’autres points du globe, tels que les îles Féroé (situées entre l’Islande, la Norvège et l’Écosse, anciennement sous dépendance danoise) et les îles Salomon, situées au nord-est de l’Australie (cf. www.blog-les-dauphins.com/les-massacres-de-dauphins-iles- feroe-japon-iles-salomon). Simplement, les Américains sont responsables de "massacres" d’animaux beaucoup plus importants aussi bien écologiquement qu’éthiquement parlant et seraient donc les premiers à devoir être remis en cause.
4 Jeangène Wilmer, juriste et éthicien de l’Université de Yale, précise encore que "les animaux d’élevage représentent déjà plus de 20% de toute la biomasse animale terrestre et en Occident 98% de la totalité des animaux avec lesquels les humains sont en interaction" (Éthique animale, Paris: PUF, 2008, p. 53).
5 www.greenfacts.org/en/fisheries/l-2/01-fisheries-production.htm.6 Jeangène Wilmer, 2008, p. 53 et sq.
Screwball comedy (2011)
"Sur les traces du monde perdu de la Screwball Comedy"
Revue du Ciné-club universitaire (10 janvier au 28 mars 2011, Genève: Activités culturelles de l'Université de Genève), p. 23-26)
Les films de Woody Allen, les comédies françaises et les séries américaines télévisuelles de ces dernières années, s’inscrivent dans la continuité de la Screwball Comedy: servis par un humour et des dialogues d’une grande finesse, ils accordent une place centrale à l’amour sans perdre leur caractéristique caustique et ironique.
LES HISTORIENS DU CINÉMA S’ACCORDENT en général pour dire que la période de la Screwball Comedy commence en 1934 avec New York - Miami de Frank Capra et s’achève vers 1942. La raison de ce déclin - même si certains estiment que le genre se poursuit encore un peu, tant bien que mal, par la suite - tient essentiellement au fait que la Screwball Comedy s’ancre dans une période extrêmement mouvementée et difficile pour le peuple américain: celle de l’après-crise de 1929, du New Deal et de la Seconde Guerre mondiale. Une époque où le moral et les conditions de vie des Américains sont si désespérants que le gouvernement, par l’entremise d’Hollywood, doit trouver un moyen d’offrir à la nation une vision positive de l’avenir. Cet aspect, certes schématique, n’en est pas moins véritable et essentiel pour comprendre ce genre particulier de comédies romantiques que notre cycle propose. Plus jamais depuis, les États-Unis ni le monde occidental n’ont connu une telle situation, et c’est là la première raison de la fin de la Screwball en tant que telle, car le cinéma s’adapte à chaque nouvelle période en fonction des besoins des gouvernements et des attentes du public.
Aussi, rien d’étonnant à ce que les quelques films postérieurs qui s’en approchent le plus soient ceux d’anciens scénaristes de la Screwball ou d’amateurs inconditionnels du genre. Que l’on pense au sublime Certains l’aiment chaud tourné en 1959 par Billy Wilder, qui n’est autre que le scénariste de La huitième femme de Barbe-Bleue (1938) réalisé par Ernst Lubitsch et de La baronne de minuit (1939) de Mitchell Leisen, deux des plus remaruables Screwball Comedies. Il en va de même, plus récemment, pour les films de Woody Allen qui, comme on le sait, est un grand amateur du cinéma des années 1930, le cinéma de son enfance, dont il s’inspire allègrement dans son œuvre. On y retrouve à chaque fois ou presque des personnages atypiques et saugrenus dans des situations aux limites des convenances et de la bienséance sociales, tout particulièrement dans ses dernières réalisations, telles Tout le monde dit I love you (1996), Whatever Works (2009) ou You Will Meet a Tall Dark Stranger (2010), qui renouent pour notre plus grand plaisir avec l’humour de ses premiers films. Et la plus grande force des films de Woody Allen se trouve sans conteste dans ses dialogues foisonnants, d’une virtuosité magistrale, qui ne sont vraiment pas sans rappeler ceux de la Screwball; dialogues auxquels on peut ajouter les innombrables quiproquos et situations loufoques et drôlatiques. Que l’on se souvienne, pour s’en convaincre, du réalisateur soufflant dans le dos de l’ancienne «prettywoman», Julia Roberts, sur les bords du Grand Canal de Venise. Ce qui manque cependant à ces films pour en faire de véritables comédies screwballistiques, c’est l’humour slapstick ou l’effet burlesque, et plus encore, la thématique de la pauvreté sociale. Tous les personnages de Woody Allen prennent place dans un milieu aisé et fortement intellectuel. Il n’y a pour ainsi dire jamais de parallèles entre riches et pauvres. Woody Allen parle de son monde, de lui-même et c’est cela qui fait que, le plus souvent, son travail sonne juste. Comme on l’a dit précédemment, la Screwball Comedy est basée sur une multitude d’éléments nécessaires et incontournables. Aussi, même si ce mélange des classes est au centre de Pretty Woman (1990) de Garry Marshall, qui est une des comédies romantiques les plus marquantes du cinéma hollywoodien de la fin du XXe siècle, narrant l’amour improbable d’une prostituée et d’un millionnaire solitaire, ce véritable conte de fée moderne n’offre rien d’autre de ce qui a fait le succès de la Screwball Comedy, à l’exception peut-être d’avoir fait de Julia Roberts une des icônes de la comédie romantique. On la retrouvera par la suite dans Coup de foudre à Notting Hill de Roger Michell (1999) aux côtés d’un autre spécialiste des comédies romantiques à l’anglaise, à savoir Hugh Grant. Si la Screwball a disparu, le star-système est toujours en œuvre. Les Claudette Colbert, Carole Lombard, Katharine Hepburn, Cary Grant, Clark Gable, et autres James Stewart sont remplacés tour à tour, au fil des ans, par les Audrey Hepburn (Vacances romaines, Drôle de frimousse, Charade...), Meg Ryan (Quand Harry rencontre Sally, Nuits blanches à Seattle, French Kiss, Vous avez un message...), Sandra Bullock (L’amour à tout prix, Miss Détective...), Hugh Grant (Quatre mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, About a Boy...), John Cusack (HighFidelity, Un amour à NewYork...), Bill Murray (Un jour sans fin, Mad Dog and Glory...), pour n’en citer que quelques-uns parmi une multitude, sans que pour autant, jamais ou presque, le niveau d’humour ni la virtuosité des dialogues n’atteignent la qualité de ce qu’ils furent durant l’époque de la Screwball Comedy, avec peut-être une exception: Quand Harry rencontre Sally (1989) de Rob Reiner.
D’un autre côté, certaines comédies romantiques contemporaines prennent clairement le pas du burlesque, pour ne pas dire du lourdingue, tels les films des frères Farelly: Mary à tout prix (1998) avec Cameron Diaz et Ben Stiller, Fous d’Irène (2000) avec Jim Carrey et Renée Zellweger, ou encore L’amour extra large (2001) avec Gwyneth Paltrow et Jack Black. Mais là encore, le compte n’est pas bon. Le fait qu’il s’agisse de comédies romantiques associées à un humour loufoque et à une multitude de malentendus n’est pas suffisant pour en faire des Screwball Comedies. Les dialogues sont généralement d’une pauvreté désespérante et la portée sociale y est quasi nulle.
La comédie romantique à la française de ces dernières années en est bien plus proche. Il suffit de prendre, pour s’en convaincre, Gazon maudit (1995), réalisé par Josiane Balasko qui y joue également aux côtés de Victoria Abril et d’Alain Chabat, Ma vie en l’air (2005) de Rémi Bezançon, avec Vincent Elbaz, Marion Cotillard et Gilles Lellouche, ou encore Prête-moi ta main (2006) d’Éric Lartigau. Dans chacun de ces films, l’humour est d’une exceptionnelle fluidité, non seulement grâce aux dialogues d’une grande finesse, mais aussi par l’incroyable jeu des acteurs et actrices et de la mise en scène. Mais plus encore, ils sont au service d’une cause sociale, que ce soit l’homosexualité féminine ou masculine, le syndrome Peter Pan auquel fait face la majeure partie des trentenaires d’aujourd’hui, ou l’éclatement de la cellule familiale et de ses compromis.
Malgré tout, la Screwball Comedy est avant tout américaine, et c’est tout naturellement aux États-Unis que l’on retrouve une sorte de renouveau, non pas dans le monde du cinéma hollywoodien, mais bien au sein des productions télévisuelles, qui depuis une décennie ou deux offrent une foisonnante créativité à travers les séries. Scénarios, dialogues, casting, tout concourt à une innovation constante, une critique satirique, mais non acerbe, de la société. La télévision ayant une part toujours plus grande dans la production cinématographique, il était logique qu’elle arrive à la supplanter par sa propre production. HBO fut une des premières chaînes de télévision à offrir des séries de toute première qualité, tous genres confondus, suivie de près par les autres "majors" pour des raisons évidentes de parts de marché et de libre concurrence. Aussi, les Ally McBeal (1997-2002) de David E. Kelley , Sex and the City (1998-2004) de Darren Star, HowI Met your Mother (2005-2014) de Carter Bays et Craig Thomas, ou encore Californication (2007-2014) de Tom Kapinos sont des "comédies romantiques", développées certes parfois sous des angles inattendus, mais qui connaissent un incroyable succès au box-office. Vendues à des millions d’exemplaires dans le monde entier, elles sont en plus un véritable vivier de création, proposant des scénarios originaux, des dialogues vifs, d’un humour jubilatoire et délicieux, tout en tournant en dérision, tour à tour, la guerre des sexes, la famille, la société dans son ensemble et tous les petits travers de chacun. Leur durée, sur un terme plutôt long, permet de mettre en scène plusieurs personnages principaux, et non pas l’histoire d’un seul couple, tout en multipliant les changements de situation inattendus. On peut les classer parmi les comédies romantiques, car le plus souvent elles sont drôles, pour ne pas dire jubilatoires, et ont pour sujet central l’Amour, conjugal ou non, sous-tendant toujours la quête de l’amour idéal, qui bien sûr n’existe pas. Et tout comme pour la Screwball Comedy, il faudra le temps de toute la diffusion de la série pour que les protagonistes grandissent, s’influencent les uns les autres et soient enfin prêts, par échanges mutuels, non sans douleur, à vivre à deux, avec l’Autre tant attendu et recherché. Une fois encore, seul le contexte social de la Grande Dépression manque ici pour faire de ces séries de véritables comédies screwballistiques.
Christophe Chazalon
Wim Wenders (2010)
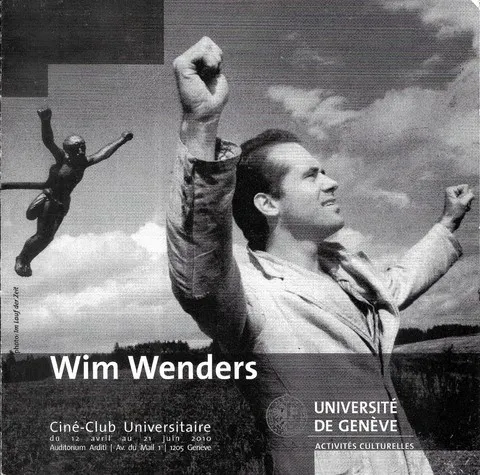
Édito
Revue du Ciné-club universitaire (12 avril au 21 juin 2010, Genève: Activités culturelles de l'Université de Genève), 2010, p. 1
La MISE EN PLACE d'un cycle de films en 35mm est chose de moins en moins aisée. La faute en revient à la difficulté de conservation des bobines et à l'avènement du DVD. "John Cassavetes", sujet du cycle initialement prévu, en a fait les frais, à notre grand regret. En remplacement, il a fallu trouver un réalisateur reconnu pour son travail et dont la production en pellicule pouvait être facilement réunie. "Wim Wenders" est l'heureux élu. L'auteur de Paris, Texas (1984) et Der Himmel über Berlin (1987) s'est offert à nous comme une porte de salut.
D'origine allemande mais se voulant citoyen du monde, Wim Wenders nous avoue lui-même, à travers son documentaire Tokyo-Ga (1985), toute l'importance qu'a pour lui le cinéma de Yasujiro Ozu, son maître spirituel, qui est le dernier à avoir su capter le réel avec toute la justesse nécessaire. "Pour moi, dit-il en voix off sur le générique d'entrée du Voyage à Tokyo d'Ozu, le cinéma ne fut jamais auparavant , et plus jamais depuis, si proche de sa propre essence et de sa détermination même, donnant une image utile, une image vraie de l'homme du XXe siècle, qui lui sert non seulement à se reconnaître, mais surtout à apprendre de lui-même". C'est là toute la quintescence de l'oeuvre de Wenders que de chercher, à travers les médiums et les moyens d'expression actuels, à suivre les traces du réalisateur japonais, dans le monde de plus en plus déshumanisé qui est le nôtre. Il appuie sa réflexion sur quantité d'éléments: la musique, le cinéma, la photographie, la peinture, la littérature ou encore la mode.
L'apparition de la vidéo, et par la suite du numérique, lui paraît être une piste à suivre pour le renouveau du cinéma. C'est avec Lightning over water (1980) que le réalisateur allemand fait connaissance avec cette technique (et tous les possibles qu'elle apporte), mais aussi avec le documentaire, auquel il s'adonne à partir des années 1990. Au fur et à mesure de ses films, Wenders semble même de plus en plus s'attacher à la vidéo, allant jusqu'à pousser à l'extrême, dans Lisbon story (1994), l'un de ses personnages, le réalisateur Friedrich Monroe, pour qui la vidéo est le moyen de filmer les choses telles qu'elles sont, sans intervention aucune, et qui se fera finalement remettre sur le droit chemin du cinéma "classique" par son ingénieur du son. Cette remise en ordre signifie par là même le retour de Wenders à ce même cinéma dont il s'était quelque peu éloigné.
La vidéo n'est pas le seul thème récurrent du cinéma de Wim Wenders. Le plus important est sans aucun doute le déracinement. Wenders le vit pleinement. Enfant de la guerre, vivant dans l'Allemagne vaincue et détruite, il part pour les États-Unis, el dorado, terre promise pour toute une génération. Mais toujours, il revient au pays. Le retour est crucial. Il fait partie de ce que Wenders tente tant bien que mal de cerner: l'identité. Que ce soit entre les siens, aux sources ou simplement au pays, le retour permet la construction de soi, point final à l'expérience de toutes vies. Tels des enfants prodigues, ses personnages passent leur temps en voyage. Ils sont saisis et offert à notre regard de spectateur au moment même où ils décident de revenir à l'essentiel, retrouver ce ou ceux qu'ils ont quittés et aimés. Paris, Texas est peut-être le plus emblématique de ces retours, mais on pourrait citer aussi Alice in den Städen (1974) ou Don't come knocking (2005), quand bien même tous, de Die Angst des Tormanns beim Elfmeter à Palermo shooting, suivent finalement le même chemin.
De la "captation du réel"
Revue du Ciné-club universitaire (12 avril au 21 juin 2010, Genève: Activités culturelles de l'Université de Genève), 2010, p. 17-22)
Á côté de la musique, le questionnement sur l'image et la prise de vue est une préoccupation de base chez Wim Wenders. En témoignent le film Alice dans les villes comprenant trois scènes tournant autour de photos polaroids, mais aussi Nick's movie, film sur les derniers jours de Nicolas Ray, qui permet à Wenders de s'interroger sur le principe de réalité au cinéma. D'autres films, comme Tokyo-Ga ou Lisbon Story, donnent l'occasion au cinéaste de se mettre en quête de moments de vérité, à la manière de son maître spirituel, le réalisateur Yasujiro Ozu.
Lorsque Wim Wenders se souvient de ses débutsdans le cinéma, il constate que son point de départ "c'était plutôt la musique"1. Or, si celle-ci est toujours très présente dans son oeuvre, son centre de préoccupation deveint rapidement la production des images. Pourquoi produit-on des images? Et plus encore, comment doit-on produire des images? Cette question fondamentale se retrouve dans nombre de ses films, à des degrés plus ou moins divers. Le constat que l'on peut faire en les visionnant chronologiquement, l'un après l'autre, est que la réflexion de Wenders non seulement progresse en fonction de l'évolution technologique, qui le confronte à une multitude de nouveaux problèmes, vrais ou faux, mais aussi que cette réflexion nourrit considérablement l'oeuvre elle-même, avec un processus constant de renvois aux développements antérieurs.
Ce n'est qu'avec Alice dans in den Städen (1973), le film à travers lequel il trouve ses propres marques, qu'apparaît l'idée de la "captation du réel". Wenders explique qu'à l'origine du film, il y avait la chanson Memphis de Chuck Berry, les États-Unis et les polaroïds2. Et c'est tout naturellement à travers ces derniers que prennent forme les débuts de sa réflexion sur les images. Les polaroïds, photographies au développement instantané, sont le sujet de trois scènes très courtes, mais essentielles dans le film et l'oeuvre de Wenders.
La première est visible au début du film. Le personnage principal, Philip Winter, est chargé par une maison d'édition de faire un reportage sur les États-Unis. On le découvre alors qu'il achève son périple, faute de temps et d'argent. Or, au lieu d'écrire, Winter s'est contenté de prendre des polaroïds durant son parcours. Approchant de New York, il s'arrête à une station service pour faire le plein et profite de l'occasion pour prendre une photo de la voiture et de la station. Un jeune garçon apparaît alors près de la voiture et lui demande: "Eh! Monsieur, pourquoi vous prenez une photo?" Winter répond "Juste comme ça!" Changement de plan, le résultat du polaroïd apparaît à l'écran: la voiture devant la station, sans personne, autrement dit une photo différente de ce que la caméra nous a montré et de ce qui aurait normalement dû être photographié. Au volant de sa voiture, Winter mécontent s'exclame: "Elles ne montrent jamais ce qu'on a vu!". Cette simple scène est le point central de la notion de "captation du réel" que Wenders va développer, oscillant entre les notions de vérité, de réalité et de mémoire.
La deuxième scène se passe dans l'avion. Winter sort son appareil polaroïd et prend une photographie de l'aile à travers le hublot. Alice qui l'accompagne se saisit de la photo et râle parce qu'il n'y a rien dessus. Aussi Winter lui explique qu'elle doit attendre un petit peu et que l'image apparaîtra. Une minute passe et Alice s'écrie alors: "Une belle photo. Elle est tellement vide!" Winter sourit. Cette aile d'avion réapparaît dans plusieurs films de Wenders, photographiée quasiment toujours sous le même angle3. Elle témoigne d'une idée fortement ancrée dans son esprit, selon laquelle le cinéma et la photographie ont perdu la capacité à retranscrire la réalité. Une perte inacceptable d'autant plus qu'elle laisse place à un vide, causé par la télévision et l'avènement du numérique.
La troisième et dernière scène du film qui retient notre attention se situe dans l'hôtel près de l'aéroport, à Amsterdam. Alice et Winter occupent leur temps comme ils peuvent. À un moment, Alice décide de s'intéresser à son compagnon d'infortune et entreprend de lui poser quelques questions personnelles. Non contente des réponses, semble-t-il, elle sort l'appareil polaroïd et prend une photographie de Winter, tout en lui disant: "Pour que tu saches au moins de quoi tu à l'air!" Winter regarde la photo. Le visage d'Alice se superpose par reflet à celui de Winter photographié. Le temps d'un instant, sujet et auteur se retrouvent fondus en une même personne.
La "captation du réel" entre vérité, réalité et mémoire
Les innovations technologiques sont sources de changement, et si la vidéo apparaît dans les années 1950, il faut attendre une trentaine d'années pour qu'elle soit accessible à un plus large public. Wenders va l'expérimenter pour la première fois en 1980, lors du tournage de Lightning over water (Nick's movie). Ce film, mi-documentaire mi-fiction, relate les derniers mois de la vie du réalisateur américain Nicolas Ray (Rebel without a cause, The lusty men et Johnny Guitar), alors atteint d'un cancer en phase terminale. Au départ, l'image est normale, tournée en 35mm. On est dans la fiction. Puis, à un certain moment, Tom Farrel, qui joue son propre rôle, intervient avec une caméra vidéo d'un autre âge, reliée à un gros magnétoscope, malgré tout plus légère qu'une caméra traditionnelle. L'image vidéo est montée successivement avec l'image 35 mm. Elle représente la partie documentaire. En effet, dans les plans en vidéo, apparaît fréquemment l'équipe du tournage, au contraire des parties en celluloïd. Qui plus est, un son aigu continu et des zébrures accompagnent l'image, rarement cadrée. Cependant, à un certain moment, Wenders se joue de tout cela et entraîne volontairement une confusion de l'esprit du spectateur, posant la question de la réalité au cinéma. Est-ce qu'un documentaire est plus réel qu'un film dit de fiction? Pas si sûr.
Plus loin, Wenders regarde avec Tom les images que ce dernier a prises d'une conférence donnée par Nick le jour même. Tom se retire et Wenders poursuit le visionnement. Une fois fini, il arrête le téléviseur et dit en voix off: "J'étais vraiment confus! Quelque chose se passait dès que la caméra était sur Nick, une chose qui échappait à mon contrôle dans la caméra même. Quand je regardais Nick dans le viseur, comme un instrument de précision, elle montrait clairement et sans pitié que son temps était compté. Ca ne se voyait pas à l'oeil nu, il y avait toujours de l'espoir. Mias pas dans la caméra. Je ne sais pas comment prendre ça. J'étais terrifié". Cette scène est délicate dans le sens où l'on ignore de quelle caméra parle Wenders. Il tourne normalement en 35mm, mais vient de visionner une vidéo. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la caméra, au contraire de l'oeil humain, donne, pour le cinéaste, une représentation de la réalité sans trucage ni modification, autrement dit "vraie". Au contraire, notre perception d'humain distord le perçu par les émotions ressenties au moment de le percevoir, donnant une image faussée de la réalité. Et c'est bien là ce que nous faisons la plupart du temps. Photos de famille, souvenirs de vacances... la photographie et la vidéo en sont venues à remplacer notre mémoire et notre regard.
C'est le constat simple que fait Wenders lorsqu'il tourne son premier documentaire Tokyo-Ga (1985)4. Au début du film, avant même que le générique, toujours en voix off, il exprime cette pensée: "Je n'ai plus de mémoire, je ne me souviens de rien. Je sais, j'étais à Tokyo. Je sais, c'était le printemps 1983. Je sais, j'avais emmené une caméra et j'ai filmé. Ces images, je les exit maintenant et elles sont devenues ma mémoire, mais je pense que si j'y étais allé sans caméra, je me souviendrais mieux maintenant"5. La caméra offre une meilleure captation du réel, mais entraîne le déclin de la mémoire et de là, du vécu de chacun, ce que l'on peut appeler une forme de déshumanisation progressive de la société.
Se rendant au cimetière où repose Ozu, Wenders poursuit cependant sa réflexion sur la réalité, ravivée à la vue de la tombe du cinéaste, gravée du seul mot "vide". "La réalité, il n'y a guère de notion plus creuse et plus inutile dans le contexte du cinéma. Chacun sait, par lui-même, ce que veut dire la perception de la réalité. On voit les autres, surtout ceux qu'on aime, et on voit les choses autour de soi, et on voit les villes et les paysages dans lesquels on vit. On voit aussi la mort, la mortalité des hommes, la fragilité des choses. On voit, on vit l'amour, la solitude, le bonheur, la tristesse, la peur, bref! chacun voit par lui-même la vie et chacun connaît par lui-même le décalage, souvent ridicule, entre ses expériences personnelles et les représentations au cinéma. On est tellement accoutumé à ce décalage et il nous semble tellement évident que la vie et le cinéma se sont éloignés, que l'on retient son souffle et l'on trésaille si tout à coup, sur l'écran, on découvre quelque chose de vrai, de réel... que ce soit un oiseau qui traverse l'image ou un nuage qui projette son ombre un moment, ou le geste d'un enfant en arrière-plan... Il est devenu rare dans le cinéma d'aujourd'hui que de tels moments se produisent, que les hommes et les choses se montrent tels qu'ils sont. C'était ça l'incroyable des films d'Ozu et surtout les derniers. Ils étaient de tels moments de vérité... Non! Pas seulement des moments, une vérité étendue qui se prolongeait de la première à la dernière image, des films qui parlaient vraiment et constamment de l'âme humaine et dans lesquels les hommes mêmes, les choses mêmes, les villes et les paysages mêmes se révélaient. Une telle représentation de la réalité, un tel art, n'existe plus au cinéma. Cela était une fois... D'où le vide, ce qui règne maintenant".
Autrement dit, alors qu'aujourd'hui la caméra vidéo parvient à mieux capter le réel, l'homme à réussi le pari fou de le distordre, de le nier. Étrange paradoxe.
En 1989, Wenders repart au Japon pour son nouveau documentaire sur la mode commandé par le Centre Georges Pompidou, à Paris: Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten (Carnets de notes sur vêtements et villes). Le début du filmmontre l'uniformisation du monde "occidental". Non seulement les boulevards japonais et français sont les mêmes, mais aussi les cimetières. Plus encore, Wenders s'interroge sur l'évolution du cinéma, et par là même des images, face à l'ère du numérique: "Les images surtout changent très vite et se multiplient à toute vitesse depuis l'explosion des images électroniques, qui sont en train de remplacer la photographie. On fait confiance à l'image photographique. Le peut-on avec l'image électronique? Avec la peinture, tout était simple. L'original était unique, une copie était une copie, un faux6. Avec la photographie et le cinéma, ça se complique déjà. L'original est un négatif. Il n'existe pas sans copie, au contraire. Chaque copie est l'original. Maintenant, avec l'image électronique, bientôt digitale, il n'y a plus de négatif, plus de positif. L'idée même d'original est dépassée. Tout est copie. Chaque distinction est devenue arbitraire. Pas étonnant que l'idée d'identité soit dans un triste état". Pourtant lorsque Wenders filme dans l'atelier du couturier Yohji Yamamoto, il abandonne sa caméra 35mm au profit de la vidéo. Les raisons? Parce que la première, trop bruyante, avec bobines à charger toutes les 60 secondes, influe sur le travail de l'atelier, sur les gens, leurs gestes, alors que la seconde, plus silencieuse, se fond dans l'activité de l'atelier sans que personne n'y prête attention. Wenders est alors tiraillé entre deux langages, la tradition classique de la pellicule et le côté pratique et efficace de la vidéo, exactement comme Yamamoto qui, selon le principe même de la mode, doit toujours innover tout en restant "classique" et reconnaissable.
La solution à ce problème et la finalisation de la réflexion de Wenders sur l'emploi de la vidéo et de la caméra traditionnelle sont indirectement le sujet de son film Lisbon story (1994). Ce film commandé par la municipalité de Lisbonne devait être un documentaire sur la ville même. Il est devenu finalement une fiction. À travers l'histoire d'un ingénieur du son parti à la rescousse d'un réalisateur qui ne parvient pas à achever son film sur la capitale du Portugal, Wenders pose les derniers jalons de sa vision de la "captation du réel". Une des scènes les plus importante est un monologue sur la mémoire du réalisateur portugais Manuel de Oliveira, qui redonne à l'ensemble de l'oeuvre de Wenders un éclairage nouveau, un sens. "Dieu existe. Il a créé l'univers. Et à quoi sert l'univers? Si les hommes... si l'humanité disparaissait, l'univers serait inutile ou aurait-il en soit une fonction sans l'existence de l'homme? Nous, nous voulons imiter Dieu. C'est pourquoi il y a des artistes. Les artistes veulent recréer le monde comme s'ils étaient de petits dieux, et ils font une série... Ils repensent constamment l'histoire, la vie, les choses qui se passent dans le monde, ce qu'on croit qu'il se passe, car nous avons cru, oui! finalement nous avons cru à la mémoire, car tout a eu lieu. Et qui nous garantit que ce que nous croyons s'être passé s'est réellement passé? À qui le demander? Ce monde, dans cette supposition, est donc une illusion. La seule vérité, c'est la mémoire. Mais la mémoire est une invention. Au fond, la mémoire, je veux dire le cinéma... Au cinéma, la caméra peut fixer un moment, mais ce moment est déjà passé. Le cinéma garde la trace d'un fantôme de ce moment. Nous ne sommes plus certains que ce moment a existé en dehors de la pellicule. Ou la pellicule garantit-elle l'existence de ce moment? Je ne sais pas. Là-dessus, j'en sais de moins en moins. En fin de compte, nous vivons dans un doute permanent. Cependant, nous vivons sur terre, nous mangeons, jouissons de la vie".
Retrouver la vérité perdue
Tout au long du film, Wenders va essayer - et il réussira - de retrouver le sens du cinéma, ce besoin de moments de vérité tels qu'Ozu savait si bien donner à voir. Lorsque Philip Winter, l'ingénieur du son, arrive à Lisbonne, le réalisateur Friedrich Monroe a disparu. Il a cependant laissé derrière lui les rushes de son film et un groupe d'enfants cinéastes. En réalité au cours de Lisbon story, on apprendra que Monroe a arrêté le tournage de son film pour se lancer dans un autre projet: éradiquer les cent dernières années du cinéma. Pour cela, il a abandonné sa caméra à manivelle, pour des caméras vidéos ultra légères qu'il a distribuées aux enfants. Tout peut être filmé, tout doit être filmé, sans but, sans regard aucun. Une idée qui agace particulièrement Winter, qui s'énerve et crie après les enfants, les traitant de vidéo-touristes, de vidiots. "N'avez-vous pas d'yeux?" leur crie-t-il. Aussi, il doit ramener Monroe à la raison et le pousser à achever son film. Le cherchant dans toute la ville, Winter parvient à retrouver son ami. Celui-ci l'amène dans un vieux cinéma abandonné appelé le "Paris", et lui montre sa "cinémathèque de l'image non vue". Pour Monroe, "les images ne sont plus ce qu'elles étaient. On ne peut plus leur faire confiance. On le sait tous. Tu le sais. Avant, les images "racontaient des histoires", "mon, p. traient des choses". Aujourd'hui, elles vendent les histoires et les choses. Elles ont changé sous nos yeux. Elles ne savent plus montrer. Elles ont oublié. Les images soldent le monde et avec un gros rabais". Cette vision fait écho au constat désobligé, mais pas encore aussi radical du réalisateur Werner Herzog dans Tokyo-Ga. Du haut de la tour de Tokyo, montrant la ville de sa main, il disait: "C'est comme ça, il ne reste plus beaucoup d'images. Quand je regarde d'ici, tout est encombré, il ne reste presque plus d'images possibles, on doit creuser comme un archéologue et essayer de tirer encore quelque chose de ce paysage blessé. Très souvent, bien sûr, cela entraîne des risques et jamais je n'esquiverai ces risques. Il y a très peu de gens prêts à vraiment oser quelque chose pour cette misère où nous sommes, ce manque d'images adéquates".
Cependant, Wenders, poussant son confrère imaginaire au rejet absolu des images poubelles de notre société déshumanisée par le tout numérique, ne peut ni ne veut le suivre et propose une solution, par l'entremise de Winter.
Du besoin du subjectif dans l'objectif
Tout comme pour le polaroïd du portrait de Philip Winter par Alice vingt ans plus tôt, le Philip Winter arrivé à maturité de Lisbon story donne une réponse à son ami égaré, réponse qui conclut le film et par là-même la réflexion de Wenders sur cette idée de "captation du réel". Wenders continue après cela à tourner en 35mm, suivant la tradition cinématographique et les thèmes qui lui sont chers. Il utilise même la vidéo pour son film Land of plenty (2003), essentiellement pour des raisons de coûts, mais il n'est plus hanté par l'absence de réel ni par la vérité des images.
Voici cette réponse de Winter à Monroe: "Ceci est un message pour Friedrich, roi du bazar des images poubelles, Dziga Vertov des années 1990, Einstein de l'image non vue. T'en fais pas, il n'y a rien à voir. Rien qu'un message dans une bouteille ou plutôt dans un sac. Les sacs sont ton truc, pas vrai? Oh! Fritz! Ce que tu t'es paumé! Ces images jouets t'ont trompé et te voilà dans une rue sans issue, face au mur. Retourne-toi et fie-toi à nouveau à tes yeux. Non, ils ne sont pas dans ton dos. Fais confiance à ta vieille caméra. Elle peut encore faire des images en mouvement. Pourquoi gâcher ta vie avec des images jetables quand tu peux en créer d'indispensables avec ton coeur, sur le celluloïd magique? L'image en mouvement peut encore faire ce pour quoi elle fut inventée il y a cent ans. Elle peut encore être "mouvante". Ton ami personne, M. Pessoa, a écrit quelque chose d'e-mouvant pour moi: Au grand jour, même les sons brillent".
Christophe Chazalon
1 - Wim Wenders, Le Souffle de l'ange, Paris, 1988, p. 6
2 - Ibid, p. 13
3 - Entre autres dans Nick's movie, Tokyo-Ga et Carnets de notes...
4 - On ne considère pas ici les deux documentaires pour la télévision que sont Reverse angle et Chambre 666.
5 - Cette idée n'est pas sans rappeler le film Hiroshima mon amour (1959) d'Alain Resnais, qui réfléchissait aussi sur la mémoire, le vécu et le regard après coup, revisité, idéalisé.
6 - Cette idée renvoie au film de Wenders Faux mouvements, dont l'un des personnages est un peintre exécutant des copies de ses propres tableaux pour les revendre comme des originaux.
"Anna" de Pierre Koralnik (2008)
Dans le cadre des cycles du Ciné-club universitaire de Genève, les membres du comité en charge du cycle avait pour mission de rédiger des fiches techniques mises à disposition gratuitement auprés des publics universitaire et externe. Dans la grande majorité des cas, ces fiches filmiques consistaient en la reproduction d'un article édité par un critique ou un historien du cinéma. Lors de notre activité au sein du comité du CCU, petit à petit, les choses ont évoluées et nous avons commencé à rédiger nos propres fiches filmiques.
Ci-dessous, nous proposons l'exemple de notre fiche pour le film Anna (1967) de Pierre Koralnik, projeté dans le cadre du cycle "Let the Music(als) play" au printemps 2008.
"Anna, jeune provinciale, travaille depuis peu dans une agence publicitaire parisienne et rêve du prince charmant. De son côté, le directeur de l'agence, Sege, tombe éperdument amoureux d'une jeune femme dont il ne connaît que la photo (deux yeux et une bouche)... celle d'Anna. Une quête à travers Paris commence.
A peine un peu plus de quarante ans se sont écoulés depuis la première diffusion de la comédie musicale de Pierre Koralnik, Anna, qui n'est autre, en réalité, que le premier téléfilm couleur diffusé sur la première chaîne française, le vendredi 13 janvier 1967. Malheureusement, la grande majorité des ménages possèdent encore, à ce moment-là, un téléviseur noir et blanc, et ne peuvent profiter pleinement de toute la fraîcheur et la beauté de ce film original.
Le 17 janvier 1967, Anna est projeté en ouverture du Festival du jeune cinéma d'Hyères. Une projection qui reste sans suite! Il faut attendre la mort de Serge Gainsbourg au début des années 90 pour qu'Arte propose une nouvelle diffusion télévisuelle, car ce qui est resté d'Anna c'est essentiellement la bande originale, "d'autant que Sous le soleil exactement, interprétée par Anna Karina, est immédiatement un tube et que le titre restera, dans l'oeuvre de Gainsbourg, un avant goût de ce qu'il fera plus tard avec Bardot et Birkin"1. L'apparition d'Eddy Mitchell et de Marianne Faithfull complètent symboliquement le tout.
Et ce n'est pas un hasard si Anna est le fruit d'une collaboration très étroite entre le réalisateur et le compositeur. "Gainsbourg est venu habiter chez moi un an et demi, après s'être séparé de sa femme. C'est ainsi que nous avons écrit ensemble un film, moi le script, lui la musique" raconte Pierre Koralnik2. Il s'agit effectivement d'une période de la vie de Gainsbourg particulièrement difficile, sa carrière de "chanteur à textes" semblant tourner court, et, "en ce sens, il s'agit bien d'un témoignage sur Serge Gainsbourg lui-même. (...) Sa tournée en première partie de Barbara est un échec. Le public ne l'accepte pas. Il se lance alors avec cynisme et hargne dans la facilité de la pop musique et ses récompenses sonnantes et trébuchantes.
En 1965, après le succès mondial de Poupée de cire, poupée de son, il déclare à la télévision, au cours d'une interview réalisée par Denise Glaser: "J'ai retourné ma veste parce que de toute façon je me suis aperçu que la doublure était en vison. (...) Je suis à un âge où il faut réussir ou alors abandonner... J'ai fait un calcul très simple, mathématique... Je prends douze titres, pour moi, sur un 33 tours de prestige, jolie pochette, des titres très élaborés, précieux. Sur ces douzes titres, deux passent sur les antennes, les dix autres sont parfaitement ignorés. J'écris douze titres pour douze interprètes différents: les douzes sont un succès. (...) Je trouve qu'il est plus acceptable de faire du rock sans prétention littéraire que de faire de la mauvaise chanson à prétention littéraire. Ca, c'est vraiment pénible. (...) Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a", disait le Gainsbourg de cette époque, qui composait Dr. Jekyll et Mr. Hyde... On retrouve dans cette vision de la chanson comme "art mineur" le mélange d'attraction / répulsion pour le succès qui l'opposera bien plus tard à Guy Béart, dans une émission d'Apostrophe de Bernard Pivot. Cette attraction / répulsion pourrait alors se résumer par les lignes de Bossuet que, dans Anna, Gainsbourg cite nonchalamment à un Jean-Claude Brialy sidéré: "Qu'est-ce donc que la vie des sens, qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit, de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit"3.
Cette attraction / répulsion n'est-elle pas aussi celle qui oppose le cinéma à la télévision? En ce sens la réalisation de Pierre Koralnik est en parfaite adéquation avec la composition de Serge Gainsbourg. Preuve en est que le film, longtemps oublié, est en passe de devenir culte. De plus en plus de projections sont proposées, les vinyles sont collector, tout autant que le DVD et la copie VHS produites au Japon (les seules existantes à ce jour)4. "De cette période de la carrière de Gainsbourg surgit un Paris Sixties clinquant et sucré, le règne et la victoire de l'argent roi avec, en contrepoint, l'incroyable force poétique du visage lumineux d'Anna Karina tapissant les murs de la ville", ce qui laisse au spectateur un arrière goût de nostalgie, comme un regret de ne pas avoir connu cette époque où la vie semblait si facile, si légère, si agréable. Couleurs éblouissantes, montage spontané et dynamique, résolument "moderne" aujourd'hui encore et qui donnent à cette comédie musicale une incroyable fraîcheur dont on ne saurait se lasser".
Christophe Chazalon
1. www.ruedescollectionneurs.com/magazine/mag/anna.php
2. www.auxartsetc.ch/articles_detail.php?id=3981
3. www. forumdesimages.fr/fr/alacarte/htm/ACTUALITE/ANNA/htm
4. On peut visionner plusieurs extraits de passages chantés sur YouTube.
Road Movie (2002)
Le premier texte retrouvé a été co-écrit avec notre ami Roland Gerber. Les dinosaures toujours présents nous avaient laissé le plus gros du nonos, bien que gardant, en apparence, la main mise sur le cycle et sa direction.
Le road-movie - horizons perdus
Revue du Ciné-club universitaire (14 janvier - 25 mars 2002, Genève: Activités culturelles de l'Université de Genève), 2002, p. 3-12
Le road movie est un genre emblématique de l'Amérique et de son cinéma. Spécifique à une période, les années soixante et septante, ce cinéma reflète intensément une société en questionnement. Le film de route hérite de toute une tradition cinématographique; sa trajectoire est ponctuée de reprises et de transformations. Wim Wenders, Jim Jarmush ou Gus van Sant sont des cinéastes, marqués par le cinéma de ces années et le renouvellent. Cette introduction retrace brièvement le parcours de ce genre marquant, de ses origines à ses avatars, en évoquant quelques films essentiels.
"Le déroulement du désert est infiniment proche de l'éternité de la pellicule" - Jean Baudrillard
Des origines diverses
Le road movie est riche d'influences diverses et sa capacité à combiner les genres et à les remettre en cause sont des caractéristiques qui font son attrait et lui donnent une dimension unique. L'émergence de ce genre s'inscrit dans une longue tradition narrative, écrite et cinématographique. Le road movie a emprunté tant à la littérature de voyage, au roman picaresque qu'au cinéma dans les décennies précédant son émergence en tant que genre.
Des westerns tels que Stagecoach (1939) ou The Searchers (1956), tous deux de John Ford, contiennent une bonne part des éléments clés du road movie. Les vastes paysages sauvages de l'Amérique originaire et mythique des westerns, sont ceux que coupent les routess empruntées par les héros des road movies, non plus à cheval mais en voiture ou à moto. Les thèmes de la frontière, de la route vers l'Ouest, récurrents dans le western, sont repris dans le road movie qui donnera de nouvelles interprétations à cette frontière. Nombre de western mettent en scène des protagonistes venant de nulle part, sans origines et en rupture avec une civilisation en voie de normalisation. Cette filiation du western et du road movie culmine avec Convoy (Sam Peckinpah, 1978), western transposé sur les highways de l'Amérique contemporaine. Les films de gangsters des années cinquante incluent des éléments qui seront déterminants dans le road movie des années soixante/septante: la fuite, l'automobile, la traversée de grandes distances. Bonnie & Clyde (Arthur Penn, 1967) est à ce titre un film charnière. L'automobile y devient la figure centrale d'une fuite en avant, le symbole d'une prise de liberté contre l'autorité. Le couple en dehors de tout et hors de lui est aussi une donnée qui sera récurrente, comme dans Badlands (Terence Malick, 1973) ou nombre de road movies bien plus récents.
Toutes ces influences se retrouveront, tour à tour ou conjointement, dans le road movie à partir de la fin des années soixante.
Le bitume, l'histoire et la mythologie
Easy Rider de Dennis Hopper, sorti en 1969, semble établir le terme de "road movie" comme dénominateur d'un genre en soi. L'émergence de ce genre nouveau est intrinsèquement liée au contexte historique et social. La fin des années soixante voit fleurir nombre de films qui répondent à l'effervescence sociale que traverse la société américaine, avec les luttes pour les droits civils et l'exigence de reconnaissance des minorités raciales qui culminent. C'est aussi à partir de là que l'engagement au Vietnam commence à poser problème. Parallèlement, Hollywood vit une remise en question, son industrie devient plus flexible un moment, semble s'accorder à l'ambiance générale et à l'atmosphère d'expérimentation. Le road movie est représentatif de cette tension et de cette adéquation de la production cinématographique avec l'effervescence sociale qui se traduit par la dimension subversive de films comme Easy Rider ou Vanishing Point (Richard Sarafian, 1971). Ces films renvoient ou font écho aux tentatives et propositions de changements qui se mettent alors en place dans une frange de la société américaine. Malgré son statut d'emblème de la contre-culture, d'un refus de normes conservatrices, Easy Rider bénéficie d'une production importante et est emblématique de la situation ambiguë de la production cinématographique des années soixante/septante, partie prenante et chronique acide de son actualité.
Les road movies de cette décennie reflètent les changements contemporains et sont essentiels à la compréhension de cette période, de la culture de l'Amérique et de ses valeurs. Cette production en adéquation avec la réalité se développe et s'affirme autour des mêmes codes esthétiques. C'est l'émergence d'un "style" dans le mouvement, d'une narration "documentaire", non linéaire et proche des personnages filmés.
Structures de la route
Le road movie de cette période se structure autour d'un déplacement, un voyage qui constitue le corps du film et sa première caractéristique formelle. Le voyage permet d'introduire une série de "sketches", de saynètes organisées au gré des arrêts et rencontres du protagoniste en déplacement. Le road movie s'assume et développe une logique qui lui est propre; le voyage dans le road movie, est aussi le récit d'une quête, d'une recherche. Cette quête peut-être initialement matérielle ou triviale - il s'agit de se rendre dans un lieu, d'aller retrouver quelqu'un.
Si le déplacement est l'occasion de découvrir le monde, c'est plus encore le moyen de découvrir sa place dans ce monde. Cette démarche peut avoir pour moteur la recherche d'un endroit pour refaire sa vie, s'y réaliser professionnellement et socialement, comme l'un des deux protagonistes de Scarecrow (Jerry Schatzberg, 1973). Celui-ci, ancien détenu, prend la route pour se rendre à Pittsburgh afin d'y ouvrir une station-service. Dans le film de Clint Eastwood, Honkytonk Man (1982), le héros, musicien à la carrière anonyme, part à Nashville dans le but d'y enregistrer le disque de sa consécration. Cette dimension est également présente dans Easy Rider quand les deux héros-motards rendent visite à une communauté hippie qui tente de réinventer une micro-société dans le désert. Les deux motards errants sont sensibles à la fragile tentative de réalisation de cette utopie et veulent y croire bien qu'eux-mêmes ne peuvent envisager de se "fixer" et n'aspirent qu'à la poursuite de leur quête incertaine.
Ailleurs, le voyage ressemble souvent à une fuite en avant, parfois dictée par les circonstances. Dans The Gateway (Sam Peckinpah, 1972), dans Badlands, on suit un couple en fuite après un forfait. En cavale ou non, par la quête d'un endroit pour se réaliser autrement que d'où l'on vient, lieu des contraintes rejetées, c'est de chaînes dont on s'affranchit. Les héros mis en scène dans ces road movies sont, de fait, souvent des *décalés" par rapport aux normes de la société. Sur la route vont des personnages avec un vécu chaotique qui les a jeté dans la marginalité voire mis hors-la-loi. Consciemment ou non, ces héros fuient une société qui ne leur pas et en espèrent autre chose, une liberté qui ne leur est pas donnée là: les hors-la-lois recherchent la liberté dans le sens premier en fuyant la police et la prison mais la situation n'est pas radicalement différente pour les "échappés volontaires" qui se recherchent. Les cavaliers seuls d'Easy Rider sont en prise avec un carcan social qui les rattrape parfois, les oblige souvent à reprendre la route plus vite que prévu.
Généralement, le temps et les kilomètres aidant, le schéma narratif traditionnel se dissout, la quête initiale se perd, devient incertaine. Le voyage reste initiatique mais pas toujours de la façon voulue, à mesure que le but premier avoué s'estompe ou disparaît au profit d'un apprentissage qui prend une dimension métaphysique. Cette quête d'une place quelque part est par essence une libération, ou sa tentative. La libération ne se réalise pas une fois le voyage terminé. La confrontation a lieu pendant le voyage: le départ et le mouvement, la route et le voyage en soi sont libératoires, en raison des choix qu'ils impliquent, constamment. La liberté, dont la recherche sous-tend tout le genre, est toujours à l'horizon, difficile à atteindre et étreindre.
En bout de route, c'est souvent la mort ou une impossibilité à exister comme peut l'être la folie, à l'image du sort de Lion (Al Pacino) dans Scarecrow (Jerry Schatzberg, 1973) qui est au rendez-vous. Tous les films qui se terminent abruptement ainsi font le constat de cette difficulté de se réaliser en dehors d'une voie, statique, tracée pour nous par d'autres. Les héros de Easy Rider sont anéantis par cette société qu'ils rejettent, une société qui ne peut que considérer ces êtres différents comme une menace pour ses valeurs établies. Le couple de Badlands, bien qu'il "quitte la route" littéralement et traverse le désert à fond de train dans une apparence de liberté totale et absurde, ne fait que se cacher d'une réalité qui finit par les rattraper au milieu de nulle part. Vanishing Point propose une vision nihiliste de cette quête de soi. Kowalski, le (fil) conducteur "fou" du film, se jette librement, à fond de train, dans un mur de voitures, pour en finir. Il n'a pu trouver la libération dans sa quête de vitesse et d'oubli de soi. Dans le crash mortel, ce n'est pas de la société qu'il se libère mais de lui-même, de ses souvenirs, des échecs de sa vie passée qui lui apparaissent tout au long du film en "flashback". Le paysage, les grands espaces n'occupent qu'une place mineure dans le film et dans le champ de vision de Kowalski dont le regard se porte bien plus sur le rétroviseur de sa voiture, reflet de son passé dont il ne peut se libérer.
Un pessimisme douloureux se dégage de bon nombre de films de ces années: la mort semble être une issue inévitable, résultat presque logique de quêtes et d'envies difficiles à formuler et à mettre en oeuvre dans une société aliénante et figée.
Wim wenders: un regard contemplatif
Avec les films précités, le road movie est un genre à forte connotation de "série b". Avec Wim Wenders, le genre acquiert une certaine noblesse, vers le milieu des années septante. Dès ses premiers films, Wenders traite du mouvement, de l'errance, de la musique et surtout du regard, contemplatif. Les héros wendersiens sont des professionnels du regard: un photographe dans Alice dans les villes, un projectionniste dans Au fil du temps, un écrivain dans Faux mouvement, un metteur en scène dans l'État des choses et Lisbon Story, le créateur de la machine à rêver dans Jusqu'au bout du monde. Ils ne cherchent pas à saisir, à recontruire le monde et ce qui le compose, mais ils contemplent, attentifs, ce qui s'offre aux yeux, dans l'espoir de se trouver. D'où l'importance du détail tout autant que de l'espace infini. La route est le moyen de cette découverte, car à travers elle défile le paysage. À la question "Je veux savoie qui tu es..." de Robert, le King of the road d'Au fil du temps, son compagnon de route, le Kamikaze, répond: "Je suis mon histoire". Jeu subtil et chargé de sens que celui de être et de suivre.
Pour son premier film tourné en Amérique, qui est aussi son premier film sur un scénario personnel, Wenders se sert de sa propre expérience. Alors représentant du jeune cinéma allemand, il était venu présenter son film, L'angoisse du gardien de but (1971), au Festival de New York. Ce premier contact avec les États-Unis, trop rapide, l'avait entraîné à y retourner peu de temps après. Il avait alors décidé de voir le pays et pour cela avait loué une voiture pour trois semaines, mais à peine sorti des limites de la ville, il fut saisi d'une angoisse devant l'uniformité de ce qui s'offrait à voir. "L'Amérique était devenue un cauchemar dix minutes après avoir quitté New York".
Alice dans les villes (1973) est une sorte de carnet de route où transparaît toute l'importance que Wenders attache au regard. Il n'y a pas de découpage, mais les scènes sont filmées au fur et à mesure de la progression dans l'espace et le temps. Le tournage respecte la chronologie du récit, tout comme il le fera pour Au fil du temps (1976) ou Paris, Texas (1984). Le héros, Philippe Winter, réalise un reportage sur le paysage américain et faute d'avoir écrit la moindre ligne, dit à son rédacteur en chef: "Quand on parcourt l'Amérique, il se passe quelque chose en vous, les images vous transforment". Pourtant toutes les banlieues se ressemblent. Elles séparent les villes de la nature (forêts, montagnes, déserts, ...) ou de la campagne qui semblent être les véritables lieux d'exploration, respectivement de ses rêves et fantasmes et de soi. Mais dans Alice, ce paysage, dont le héros tente de garder le souvenir par les nombreux clichés qu'il prend, ne représente qu'un vide, qu'une absence. "C'est une jolie photo, elle est tellement vide" dit Alice regardant une photo de Winter. Ce n'est que lorsqu'il retourne dans son pays en compagnie de la petite Alice, dont il est le "dépositaire", qu'il se trouve.
Le paysage joue chez Wenders le rôle d'un révélateur des états d'âmes des protagonistes. Tout autant que la musique (le rock essentiellement, en parfaite adéquation avec le monde qu'il décrit), ou que les dialogues rares et épars, le paysage fait sens. Mais, il nécessite ce détonateur, pour être déchiffré par ceux là même qui le contemplent. Les enfants, libres interprètes, jouent souvent ce rôle. Alice après avoir pris une photo de Winter, la lui tend et lui explique: "Comme ça, au moins, tu sauras à quoi tu ressembles!".
Cette importance du paysage se retrouve dans la quasi-totalité des films de Wenders. La suite de la triologie, commencée avec Alice dans les villes, en est un exemple manifeste. Que ce soit Faux mouvement (basé sur la première partie du Wilhelm Meister de Goethe, archétype du roman de formation) ou que ce soit Au fil du temps (parcours d'un projectionniste itinérant à travers l'Allemagne ou voyage de ce qui reste du cinéma en Allemagne). Mais c'est peut-être avec Paris, Texas que Wenders parvient le mieux à exprimer sa pensée et à donner au road movie un nouvel essor. C'est un nouveau départ pour Wenders, qui ne s'attache plus à l'histoire du cinéma, mais fait du cinéma et raconte une histoire, une histoire d'amour entre un homme et une femme. De ce paysage désertique texan, surgit le héros, suivant les rails du train. Les quatre années d'errance prennent fin, le voyage commence. Ce n'est pas un hasard si Travis possède une photo d'un terrain à vendre à Paris, au Texas. Il a acheté ce bout de terre, au milieu de nulle part où il pense être né. Les racines sont un autre point essentiel chew Wenders. Dans Alice, déjà, le voyage passait par la recherche de la grand-mêre d'Alice et celle des parents de Winter.
Travis peut grâce à son frère Walt prendre un nouveau départ. Celui-ci a adopté son fils Hunter. Les retrouvailles entre père et fils sont difficiles, mais le courant finit par passer. Travis et Hunter partent alors en quête de la mère, Jane, qui travaille dans un peep-show à Houston. Le voyage, guidé par les sentiments de Travis, a pour but de réunir les deux êtres qu'il aime le plus au monde, sans pour autant pouvoir vivre avec eux. C'est pourquoi, une fois Jane retrouvée et après une longue discussion-confession sur leur vie passée, Travis finit par les abandonner à nouveau. Le voyage s'achève, la vie peut reprendre ses droits, car comme le précise Sam Shepard: "Ce qu'a découvert Travis, c'est qu'il ne suffit pas de recoller les morceaux brisés de son passé. C'est en lui-même qu'il doit rassembler ces morceaux. C'est lui-même qu'il doit maintenant retrouver. Et ça, il doit le faire seul". Cette solitude propre aux personnages de road movie, qui peuvent vivre, échanger avec des compagnons de route, mais jamais être compris d'eux, est un des éléments récurrents du cinéma de Wim Wenders. Le paysage s'associe à cette solitude et la renforce. La ville, comme symbole de l'imaginaire et de l'autre, s'oppose au vide de la nature, au désert, symbole de l'intériorité de l'être et de sa solitude.
Jim Jarmush: une vision du réel
L'errance est chez Jarmush un sujet privilégié depuis toujours. Si avec Permanent vacation (1982), son premier long métrage, il explore les déambulations d'un jeune étudiant dans New York, très il vite il sort de la ville. Stranger than paradise (1984) et Down by law (1986) sont deux films qui montrent une autre Amérique, celle de la nature, celle d'un monde sauvage parcouru par des héros en mal d'aventure ou en fuite. L'influence de Wenders est directe sur le cinéma indépendant de Jarmusch. Le refus des types et archétypes hollywoodiens, sans parler de l'usage du noir et blanc et des longs plan-séquences lents et à peine animés, sont directement tirés de l'expérience de Wenders. Tout comme lui, Jarmusch jette un regard sur son propre pays, qui, loin d'être flatteur, se veut réaliste. Les plans-séquences dépouillés marquent le temps d'un regard tout à la fois inquisiteur et bienveillant. Il se dévoile petit à petit, suivant la progression des protagonistes.
Ainsi Eva, l'héroïne de Stranger than paradise, fraîchement arrivée de Hongrie, découvre une Amérique très différente de celle qu'elle s'est imaginée, une Amérique misérable, où la vie ne chante pas tous les jours, où l'on s'ennuie. Accompagnée de deux paumés, elle parcourt la côte Est jusqu'en Floride, où elle s'apprête à prendre l'avion, mais finit par rester. De même, dans Down by law, trois prisonniers s'évadent et errent dans les marais. Alors se découvre à nos yeux, un pays bien loin de l'opulence et des merveilles promises. La pauvreté est réelle, tangible. Les États-Unis n'y échappent pas. Cependant, ici comme ailleurs, l'amour suffit à rendre heureux. Roberto (joué par Begnini) tombe amoureux de sa compatriote qui les a recueillis. Le road movie est ici détourné au profit d'une fiction documentaire. Il ne s'agit même pas d'un voyage initiatique, ni mêmem d'agrément, mais d'un voyage d'exploration qui oppose le rêve à la réalité la plus crue. Pas de quête de soi, pas d'envie de liberté ou d'affranchissement, juste la découverte d'un monde jusqu'ici rêvé ou caché par une image dorée et qui se révèle sous son vrai jour. Mystery train et surtout Dead man ne feront pas autre chose.
Gus Van Sant: le voyage intérieur
Le road movie tel que le propose Gus Van Sant suit, lui, une voie intérieure. Le paysage que ce soit dans Drugstore cowboy (1989), dans My own private Idaho (1989) ou encore dans Even cowgirls get the blues (1993) ne joue qu'un rôle de référent, au même titre que les mots "cowboy", "cowgirls" ou "Idaho", qui renvoient sans aucun doute possible au monde du western. Gus Van Sant explique qu'il est de l'Ouest, c'est pourquoi il en parle. L'Ouest c'est encore, dans l'imaginaire commun, le western, la promesse de la liberté, le monde sauvage, la ruée vers l'or, le rêve américain. Mais avec le temps les cow-boys ont disparu laissant la place aux voleurs d'opérette, les drugstore cow-boys. Plus encore, le paysage est partie intégrante du rêve. Les héros de Gus Van Sant ne vivent pleinement que par leurs visions, provoquées par la drogue (Drugstore cow-boys) ou par les évanouissements (My own private Idaho). Ce monde privé (d'où le titre de ce dernier) qu'eux seuls connaissent est un monde qui supplante la vie réelle, une vie de souffrance, à l'image du monde où s'échappe la petite héroïne du Magicien d'Oz (VIctor Flemming, 1939). Scott, dans My own private Idaho, n'a pas besoin de ce subterfuge. Fils d'une grande famille, il décide de s'opposer à son milieu, en se prostituant et en vivant dans les bas fonds de la ville, faute d'une reconnaissance paternelle. Mais au contraire de Mike, qui s'évade chaque fois qu'il est stressé en s'évanouissant, Scott décide qu'à ses 21 ans, lorsqu'il touchera son héritage, il rentrera dans le rang pour devenir l'enfant prodigue qui fera l'émerveillement de son père naturel, au détriment de son père adoptif.
La route chez Gus Van Sant est, contrairement aux autres road movies, un élément statique. Les personnages voyagent, mais la caméra ne saisit que des arrêts. My own private Idaho commence par une scène où le personnage dit, sa moto arrêtée sur le bas côté, "Je connais cette route". Et de fait, les personnages, s'y retrouvent à plusieurs reprises, mais toujours en arrêt. En réalité, ces moments d'immobilité, qu'ils soient dus à la drogue, à un évanouissement ou encore à un problème mécanique, sont le lieu du souvenir. Les personnages voyagent dans le passé. Wim Wenders est présent derrière chacun de ces instants, en particulier lors des home movies, petites saynètes (souvenirs de famille) tournées en Super 8. C'est par l'intermédiaire de ces home movies que se produit le voyage dans le temps, qui est aussi un voyage intérieur, où chaque personnage prend consistance, se dévoile au spectateur, tout autant qu'il se cherche. On le voit, le road movie se transforme en un voyage de la souffrance, intérieur, où seule reste l'implacable solitude des êtres. C'est du moins dans ce sens qu'il se développe par la suite, quittant les grands espaces américains pour des paysages du monde entier, comme le proposent Sans toi, ni loi (1985) d'Agnès Varda ou Western (1997) de Manuel Poirier, Hana-Bi (1997) de Takeshi Kitano avec parfois des rappels, comme dans Happy together (1997) de Wong Kar Wai ou Thelma et Louise (1991) de Ridley Scott.
Roland Gerber et Christophe Chazalon
Novembre 2001